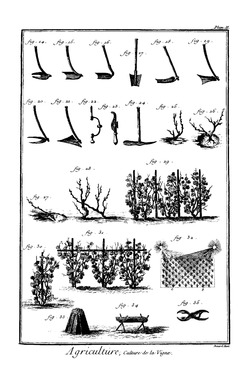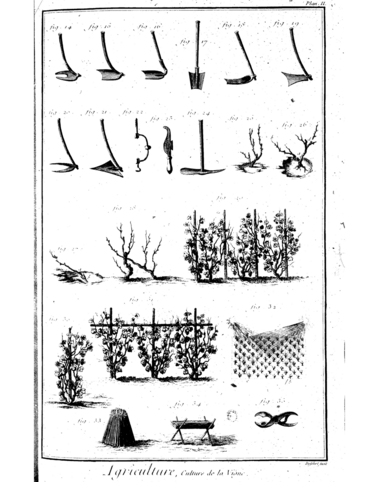-
Par Michel64a le 20 Octobre 2021 à 19:43
AUTRES PLANTES RECOLTEES EN BEARN AU XVIIIe SIECLE
1) 1) Les céréales
La plupart des céréales que nous allons aborder dans ce paragraphe correspondent à ce que l’on nomme des « céréales panifiables », outre le maïs abordé précédemment.
La farine constitue la base de l’alimentation vu que le pain est un des principaux aliments des gens. En effet, le pain, il faut le rappeler est consommé soit sous forme de pain – que l’on peut tremper dans la soupe -, de galettes ou de bouillies. Les paysans cultivent les céréales pour leur propre subsistance et de celle de leurs animaux. Le surplus sera vendu ce qui leur rapportera des revenus afin de payer les taxes, les impôts, les baux et des biens qu’ils ne peuvent pas réaliser eux-mêmes.
a- Généralités
Jean-Marie Moriceau 1 écrit que les grains servent à mesurer les taxes comme la dîme, les rentes que l’on doit au propriétaire. Ils peuvent aussi être utilisés dans la rétribution du travail accompli en tant qu’ouvriers agricoles ou même dans l’évaluation de douaires et des pensions viagères.
Or , au XVIIIe siècle, les agriculteurs doivent répondre à trois besoins. D’une part, répondre à la demande de plus en plus importante d’individus du fait de la croissance démographique, d’autre part, alimenter les centres urbains quoique modestes à l’époque mais qui prennent peu à peu de l’ampleur et, enfin, satisfaire les nouveaux modes de consommation de la part notamment de la bourgeoisie.
Lorsqu’on fait référence au froment, parfois on inclut le seigle (blat) introduit par les Germains, l’épeautre dont la balle couvre le grain, le méteil qui est un mélange de froment et de seigle. On peut ajouter l’orge (oerdi) qui est une céréale de complément ayant reculé au profit du froment mais qui est utilisé dans la fabrication du pain au moment des disettes et de la bière , le méteil (carron) et le millet (milh) qui, dans le passé , fut considéré comme l’aliment de base de la population. Mais, à la veille de la Révolution, cette dite plante connaît un rejet puisqu’on considère que le pain obtenu est indigeste et même de nocif, juste bon à lutter contre les disettes. L’avoine, réservée généralement à l’alimentation des animaux, surtout celle des chevaux, peut être consommée en période de disette.
Etienne-François Dralet 2, agronome, situe les terres à blé et au millet sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne : « sur le bord des rivières, sur les pentes douces qui avoisinent les plaines et sur celles qui s’abaissent vers les deux mers… » Se référant au froment, il écrit qu’il est : « de très bonne qualité dans les contrées dont il s’agit. Le sac de semence en rend ordinairement cinq à six. Il donne sept à huit… » dans les vallées « où les fourrages d’hiver sont assez abondants pour entretenir de nombreux bestiaux, et où l’on a conséquemment beaucoup de fumier. L’on voit que le système de culture est le même pour les premiers gradins des Pyrénées que dans les bonnes terres des plaines voisines. Quoique nous n’ayons parlé que du blé et du millet, on pense bien que le cultivateur ne néglige pas de se procurer, suivant ses besoins et la qualité du terrain, de l’orge, de l’avoine, du seigle et des pommes de terre. » S’agissant du seigle cultivé dans les Pyrénées, dans les gorges étroites et sur le flanc des monts escarpés…elles sont moins étendues…proportionnellement au nombre des cultivateurs ; elles sont donc travaillées plus fréquemment : c’est ainsi que, malgré l’infériorité de leur qualité, leurs productions seraient très considérables si le laboureur était aussi entendu que laborieux, s’il semait moins, et qu’il se procurât plus de moyens d’engrais… » Ensuite, étudiant le sarrasin appelé « blé noir », il note que l’on le trouve sur les « lopins qui se trouvent dans les intervalles que laissent entre eux les rochers escarpés…celles qui sont exposées au nord, et que l’on appelle ombrées… ». Il écrit que son nom ou celui de « mil des Maures » proviendrait du nom des peuples de l’Afrique qui nous la firent connaître dans le huitième siècle ». Sa qualité réside dans le fait qu’elle s’accommode des terrains les plus légers et les plus froids. Six semaines suffisent pour la semer et la recueillir ; elle rend jusqu’à quarante pour un, lorsque la fleur n’a pas été desséchée par les vents du midi ou gâtée par les gelées. C’est pour l’habitant des montagnes, le plus précieux des grains, et l’on peut assurer qu’il a puissamment contribué à la population de ces contrées.» Analysant le seigle, il mentionne qu’il est semé « sur les terres qui ont produit le foin rouge ou le lin, après leur avoir donné deux façons, dont la première est retardée jusqu’au mois de mai, afin de ménager le pâturage aux bestiaux… »
Toujours dans les Pyrénées, les céréales telles que l’orge, le froment et l’avoine, « sont confiées…au sol qui a produit le maïs ou la pomme de terre, sans autre façon que celle qui est nécessaire pour la semence. Le peu de froment que l’on sème dan les terres dont il s’agit rend à peine trois pour un, dans les terres où le cultivateur inconsidéré l’expose à la rigueur des froids violens ; mais dans les bons terrains, lorsqu’il n’a point été endommagé par les brouillards de la Saint-Jean, il produit jusqu’à sept… » dans les montagnes « où les étables fournissent un fumier abondant. Immédiatement après la récolte des plantes céréales, le cultivateur choisit les meilleurs terrains qui viennent d’en être dépouillés, pour y semer le lin, le foin rouge et le sarrasin, qui, à leur tour, feront place aux semences du printemps »
Mais voilà, comme le souligne l’historien Marca en 1640, la province ne couvre pas tout à fait la moitié de ses besoins en céréales. L’Intendant Lebret 3 signale que « les deux tiers de terre de Béarn sont en friche ; il semble même que la plupart de ces friches qui ne portent que de la fougère seraient très propre à porter du grain ; mais les paysans sont persuadés que cette fougère leur est absolument nécessaire pour fumer les terres qu’ils cultivent… » .
Foursans-Bourdette, M.P. 4 mentionne : « Le millet jusque-là important est en régression, il est encore cultivé dans la plaine de Nay et dans la vallée du gave d’Oloron. L’avoine est semée principalement dans la plaine de Nay et sur les coteaux (Vic-Bilh et coteaux de Monein et gan), mais ne fournit tout de même que le tiers de la consommation courante et on doit en importer habituellement de la Bigorre et de la Chalosse où elle est bien meilleure. Quant au froment, il est cultivé un peu partout, mais les meilleures récoltes en sont dans la vallée du gave de Pau (région de Lacq et Sauveterre et plaine de Nay). Toutefois, même dans les meilleures années, la moitié seulement de la consommation annuelle est couverte par la production locale. »
Quant à l’Intendant Lebret, il écrit que « Les champs de la plaine de Pau, de la vallée de Josbaigt , des plaines de Navarrenx et de Sauveterre ne se reposent jamais ; on les trouve toujours semées , tantôt de froment , tantôt de seigle, d’avoine, de lin, de millet et très souvent de maïs. Ce qui fait juger qu’elles ne paraissent pas grasses, elles sont cependant très fertiles… ». 3
Jean Lassansaa, dans sa monographie sur Billère, mentionne que « Chaque famille produisit assez de blé pour fabriquer son pain. Longtemps, le millet (milh) avait eu la prépondérance sur tous les autres grains et le pain fabriqué avec cette seule céréale. ..Au XVIIIe siècle, on sema les graines en lignes, afin que les mauvaises herbes puissent être enlevées pendant la pousse des céréales.» 5
L’abbé Roubaud précise en janvier 1774 que :« Les grains les plus abondamment cultivés dans ce pays sont le froment, le bled d’Inde et l’orge. On sème peu d’avoine. Il n’y a point presque point de millet…. ». 6
Dans les vallées montagnardes, on pratique une culture intensive avec assolement biennal vu l’étroitesse des espaces. Comme le note Jean-François Soulet « les céréales formaient la base du système agricole. Pendant des siècles, une céréale d’automne : le seigle …et trois céréales de printemps – l’orge (notamment la paumelle), l’avoine et les millets – occupèrent presque exclusivement le terrain. Puis s’ajoutèrent, le sarrazin, dont le cycle végétatif bref et les rendements élevés firent, selon Dralet, le « plus précieux des grains », et, au XVIIIe siècle, le maïs. Ce dernier, gêné par les conditions climatiques, ne progressa que lentement dans les hautes vallées. » 7
b- le seigle
Jean-Marie Moriceau analyse le seigle et le dépeint comme une plante moins exigeante en azote, acide phosphorique et potasse. Elle se développe dans les « arènes granitiques des massifs anciens ou des sols sablonneux des bassins sédimentaires. Céréale hâtive et résistante au froid, il venait assez bien en montagne. Caractéristique qui rejoint celle déjà avancée par l’agronome Dralet que nous verrons plus loin. L’auteur ajoute que le seigle se trouvait aussi dans les plaines fertiles « car sa longue paille, souple et résistante, servait à faire les liens de « glui » pour engerber la moisson, botteler le foin et échalasser les vignes.
Amoreux Pierre-Joseph écrit, après la moisson, que le seigle est battu lors de l’opération à l’aire. « On couche à plat les gerbes sur l’aire, en les déliant. On les met bout à bout, de manière que les épis des unes reposent sur l’extrémité opposée des autres, ce qui forme un lit en recouvrement, ou en manière de toit. » Le fléau est utilisé pour battre la plante. Comme pour le blé, l’aire doit être exempte de pierres, d’herbes…et de surface plane. Sa superficie est proportionnelle à celle du domaine. Sa situation n’est pas prise au hasard, elle doit être orientée face au vent («à celui du Nord sur-tout »), dans un lieu élevé bien exposé. Si ce n’est pas possible, on procède comme pour le blé en répandant de l’argile…Pour que l’aire s’affermisse d’année en année, il ne faut pas la labourer. Cela dit, les batteurs disposent les gerbes en carré long , « passent & repassent en se succédant & en se rangeant toujours par ordre deux à deux vis-à-vis l’un de l’autre...ils font enfin sortir le grain de la bale & de l’épi sans le blesser…Lorsqu’on a jugé que les épis sont dépouillés , on tourne & retourne la paille longue avec des fourches , on la repasse au fléau, on la secoue encore, en la soulevant avec les fourches & la poussant pied à pied sur une autre place. Le grain a resté sur l’aire, on le nettoie comme on fait pour le blé.» 8
c-l’épeautre
Quant à l’épeautre, Jean-Marie Moriceau note qu’il « acceptait des sols plus froids que le froment, donnait une farine presque aussi blanche encore appréciée dans certaines régions. » Il se penche aussi sur le méteil qui permettait d’obtenir un pain de ménage « moins blanc certes (« bis méteil », dans les proportions inverses) mais qui se conservait davantage. »
d- le sarrasin
Le sarrasin était la céréale du pauvre car, selon Jean-Marie Moriceau, était « peu exigeant », « poussait vite (cent jours) et, pourvu qu’il fût semé tôt – dès le début de mars en climat doux et humide -, il assurait deux récoltes dans l’année après de nouvelles semailles à la fin du mois de juin. »
Dans un article du médecin J.J. Menuret sur la jachère tiré de ses Mémoires d’agriculture, d’économie rurale et domestique publiées par la Société royale d’agriculture de Paris, on peut lire qu’il recommande le blé-sarrasin comme plante dans l’année de repos mais « même dans les pays où on l’on récolte les grains en Juin ou Juillet, il peut être semé sur le chaume, dès qu’on a coupé & enlevé les épis, il donne à la fin d’Octobre une récolte qui n’est point sans intérêt pour le Cultivateur. » Il mentionne que si la farine obtenue donne un pain nourrissant et lourd et sert dans la confection des potages, son grand mérite consiste à alimenter le bétail (volaille, dindes et cochons) en grains ou en farine.
Autre qualité, sa paille sert à la confection du fumier surtout si « on l’enterre la plante dans le tems de la floraison… » 9
Denis D’Alband 10 regrettait que le sarrasin souffre en Béarn d’une « production trop peu connue ici… » en ce qui concerne l’alimentation animale. Son constat est réalisé aux lendemains de l’épizootie de 1774.
e- le millet
Enfin, au sujet du millet « important dans le Sud-Ouest (Landes et Gascogne), Jean-Marie Moriceau écrit qu’il « était consommé en galettes ou en bouillies assez amères ».
f- l’avoine
Vis-à-vis de cette plante, voici ce qu’un agronome écrivait l’abbé Rozier 11 : « Chaque pays a ses usages, & la culture varie du plus au moins d’une province à l’autre. La nature du sol contribue pour quelque chose, & la coutume décide plus souverainement, que la valeur du terrain. Dans certains cantons, on destine les terrains maigres aux avoines ; dans d’autres, ce sont les terres fortes, & dans quelques uns où l’on alterne, …l’avoine est semée dans les bons fonds. » Il conseille, dans un premier temps, après l’hiver « un léger labour avec la charrue à versoir, afin d’enterrer les herbes » et non pas l’utilisation de l’écobuage. Selon lui, cette dernière équivaut la dépense de deux ou trois labourages mais qu’il est « démontré que la récolte sera au moins du double plus forte. » Il continue dans sa démonstration au sujet du labourage à préconiser pour l’année suivante de procéder à un labour plus profond car ainsi « les racines des plantes auront pénétré plus profondément dans la terre ; de sorte qu’au moment de semer, ce terrain auparavant si maigre, si dépouillé de principes, équivaudra à un terrain léger & bien amendé. » Au lieu de pratiquer le brûlis – « on ne rend à la terre qu’une partie de la portion saline & terreuse » -, il serait plus profitable d’enfouir le chaume lors du labourage puisque la partie saline est préservée et ceci aussitôt après avoir « passé fleur, afin de multiplier le terreau ou terre végétale ».
La jachère, selon l’auteur est bénéfique car elle permet à la terre de « recouvrer les sucs qu’elle a perdus pour substanter… » mais le fait d’enterrer les plantes est tout aussi profitable aussi puisque ces dernières « pourrissent & fermentent dans son sein. » Par contre, il déconseille l’usage de l’alternance notamment avec le blé puisque les deux peuvent épuiser les « sucs de la superficie » et laisser « intacts ceux de la couche inférieure. » A la lecture de son article, il s’avère que l’auteur est opposé à la plantation de l’avoine vu qu’elle « effrite trop la terre » et qu’il est dommageable de sacrifier des terres à froment pour leur culture. » Selon lui, il vaut mieux « Une récolte passable de froment, & même de seigle… » à la plus « superbe récolte d’avoine ».
Au sujet de la moisson, il conseille au moment : « avant sa maturité complète » de couper l’avoine avant qu’elle soit bien mûre afin d’éviter qu’elle s’égrène. « A sa maturité complète », il faut attendre que la feuille soit bien fanée et que la tige soit d’une couleur jaune doré pour la couper. A ce moment-là, il est indispensable de faire appel à de nombreux moissonneurs pour ne pas de perdre du temps et être sujet à un orage, une grêle ou une pluie trop importante qui seraient préjudiciables. Lors de ladite moisson, l’usage de la faux est pointé comme néfaste puisqu’elle égrène les graines. Il préconise d’utiliser la faucille vu que le moissonneur « en décrivant un cercle…il coupe ces tiges, sans contre-coup & sans secousse , & le grain reste renfermé dans sa balle. » Mais l’auteur déplore que cela se pratique en coupant trop l’avoine trop verte ce qui est mauvais puisqu’elle, couchée sur le sol, elle se gorge d’eau lors de la rosée entraînant des complications au bétail par la suite. Cette plante, si elle est donnée à la volaille ou aux cochons rend en ce qui concerne celui-ci « un lard doux, & d’un goût excellent… ». Pour ce qui est des vaches et des brebis, le lait est plus abondant et plus gras. Quant à l’homme, le pain obtenu à partir de l’avoine est très compact, noir foncé et amer. Pour finir, l’auteur achève de démontrer les vertus médicinales de la plante, elle calmerait la toux, la colique néphrétique due à des graviers l’asthme convulsif et tempèrerait la soif…
J.J. Menuret écrit que l’avoine et l’orge peuvent être semées dans les « jachères » au mois de mars « comme les plantes légumineuses » mais il ajoute qu’elles « nourrissent moins la terre qu’elles , soit que leurs racines ou leur manière de végéter soient trop analogues à celle du blé, soit qu’en s’élevant elles entretiennent moins d’humidité à la surface de la terre, ou laissent échapper moins de feuilles , d’insectes, &c. » 12 Il écrit encore que les grains d’avoine et d’orge semés avant l’hiver « forment dans cette saison un bon pâturage , donnent du fourrage au Printems , & peuvent , comme les autres prairies artificielles, être ensuite reversés dans la terre ; alors ils y portent un véritable engrais . Il est très-ordinaire de mêler dans cet objet de l’orge & de l’avoine à la vesce ; ils servent de soutien à cette plante, qui, de son côté entretient plus d’humidité ; leur végétation se favorise mutuellement. »
2) Les Plantes nouvelles et artificielles
Les plantes nouvelles les plus significatives sont le maïs et la pomme de terre. Cette dernière a été introduite en France plus timidement que la première. Ce qui est, a priori, incompréhensible vu qu’elle a la capacité d’alimenter cinq fois plus de gens sur une même superficie que le froment. F. Bayard et P. Guignet affirment que cette « répugnance persistante des Français pour ce type de consommation est à tout prendre le signe d’une certaine abondance alimentaire de l’ancienne France. » Cette attitude française est à comparer avec celle des flamands des Pays-Bas autrichiens où le tubercule a remplacé à 40 % la consommation céréalière.
a- La pomme de terre
Cette plante est originaire d’Amérique du Sud, plus exactement de la Cordillère des Andes (lac Titicaca) où elle pousse à l’état sauvage depuis environ 8 000 ans à l’époque néolithique. Les Incas l’appellent « papa » et la domestiquent pense-t-on dès le XIIIe siècle. Elle est, avec le maïs, un des principaux aliments de base .Elle est découverte par les Européens par l’intermédiaire du conquistador espagnol Pedro Cieza de Leon lors de sa participation de la conquête du Pérou entre 1536 et 1551. Il fait référence à la plante dans ses « Cronicas del Peru , nuevamentes escrita ». Des historiens dateraient l’événement de 1534. C’est la première « vague », la « patata » se répand en Espagne (d’abord dans les îles Canaries), en Italie, dans les Etats pontificaux et en France méridionale au XVIe siècle. Elle correspond à une variété où la couleur rouge domine. On mentionne qu’elle aurait été plantée vers 1540. Ce serait l’Anglais Sir Walter Raleigh qui l’aurait apportée en Angleterre au milieu du XVIe siècle sous le règne d’Elisabeth I – ce qui correspondrait à une seconde « vague » et à une variété de couleur jaune - et delà aurait gagné l’Amérique du Nord. Antoine Parmentier, lui, écrit que c’est l’Anglais Sir Walter Raleigh qui l’a fait connaître en Amérique du Nord (Virginie). Enfin, d’autres historiens avancent l’hypothèse que les Anglais l’auraient introduite en Angleterre à la suite de leur lutte contre les Espagnols en Colombie en 1586.
La plante n’intéresse que les botanistes et les pharmaciens qui, peut-on lire dans le Mourre, lui attribuent des pouvoirs aphrodisiaques et antirhumatismaux. En 1588, le roi d’Espagne Philippe II qui a reçu quelques plantes en fera parvenir au pape Sixte V qui souffrait de la goutte. Elle se répand de façon importante en Irlande au XVIIe siècle et en Angleterre, gagne la Flandre, l’Allemagne où elle est remarquée par les soldats français lors de la guerre de Sept Ans.
Jean-Marc Moriceau 13 signale que cette plante resta en France, comme le maïs, une culture secondaire. Elle est d’abord cultivée dans les jardins. La pomme de terre se répand probablement en France « suivant deux axes… : le premier, plus ancien, d’ouest en est à travers le nord de la Flandre et le Brabant ; le second, du sud au nord, originaire des Vosges, touchant à la fin du XVIIe siècle l’Alsace et la Lorraine puis le Namurois (1740) et le sud des Pays-Bas autrichiens. » Il continue à préciser qu’elle s’est implantée de manière importante en dehors des régions où ses concurrents - le maïs, le sarrasin et la châtaigne – existaient. Aliment de substitution, elle « fut bien accueillie dans les pays pauvres et les montagnes pour répondre à la croissance démographique et remédier aux crises… » Il rajoute que les agronomes du XVIIIe siècle ne s’intéressèrent à elle vraiment que durant la seconde moitié du siècle.
La pomme de terre a été décriée pour plusieurs raisons. Vu qu’elle pousse dans la terre, elle est désignée comme une racine et, de ce fait, méprisée par les élites car trop éloignée de Dieu. En effet, dès le Moyen Age, on a établi une hiérarchie des valeurs appelée « la grande chaîne de l’être » dans laquelle les aliments sont distingués de par leur position, du haut vers le bas (feu, air, eau, terre). On pense notamment qu’elle répand la lèpre, qu’elle est responsable d’indigestion pour l’homme ; en ce qui concerne sa culture elle aurait des effets nocifs sur la terre puisqu’elle l’appauvrirait.
Olivier de Serres l’aurait fait connaître en France du Sud (il écrit le « Théâtre d’agriculture et mesnage des champs » en 1600 et la cultive dans sa ferme modèle de son domaine du Pradel) et Charles de Lescluze dans l’Est au commencement du XVIe siècle. Des historiens mentionnent que l’introduction de la pomme de terre en France serait le fait d’un moine franciscain nommé Pierre Somas qui l’aurait connu en Espagne. Il l’aurait cultivé dans ses jardins à Saint-Alban-d’Ay, commune de l’Ardèche (plus exactement au hameau de Bécuze) dont il est originaire , ceci vers 1540. A l’époque elle était nommée « truffole », mot francisé du patois « la trifolà ».14
Le jeune roi Louis XIII a l’occasion d’en manger en 1613 mais ne l’apprécie pas. La majorité des gens la dédaigne, on la donne à consommer aux animaux notamment les porcs ou on l’utilise comme plante ornementale. On lui reproche ne pas être panifiable , ceci est dû au manque du gluten.
Le contrôleur général des finances et physiocrate Turgot a bien cherché dans les provinces d’ Anjou et du Limousin, en 1740, de la répandre mais en vain. Des médecins, outre le fait qu’ils prévenaient à tort qu’elle pouvait engendrer la lèpre mais aussi des fièvres. De plus, son goût n’était pas des plus appétissants, on la trouvait amère.
La plante est analysée en 1596 par le naturaliste suisse Gaspard Bauhin dans son livre intitulé : « Pinax theatri botanici »
Son nom de pomme de terre aurait été donné par Henri-Louis Duhamel du Monceau, agronome de la Nouvelle-France.
Antoine Parmentier peut reconnaître ses qualités lors de sa captivité en Prusse, en Westphalie lors de l’expédition de Hanovre en 1757 – durant la guerre de Sept Ans (1756-1763) - en tant qu’apothicaire des armées puisqu’elle est donnée à manger par les geôliers.Il la consomme pendant deux semaines sous forme de bouillies. Il découvre ses vertus nutritionnelles. Duhamel de Monceau, en 1762, conseille également son alimentation ce qui aura comme effet positif l’éloignement de la famine dans l’Est de la France en 1770. Dans le Mourre, on peut lire que l’Académie de Besançon honora les études entreprises par Parmentier. Le sujet proposé est : "Quels sont les végétaux qui pourraient être substitués en cas de disette à ceux que l'on emploie communément et quelle en devrait être la préparation ?" Parmentier démontra alors les vertus du féculent, son potentiel à lutter contre la disette et sa substitution au blé dans la confection de pain, ceci en 1772. Il faut rappeler le contexte, la France venait de subir des disettes en 1769 et 1770. Il démontra également qu’il était possible d’extraire de l’amidon capable de nourrir à partir de plantes et de racines (davantage que le gluten). La même année la faculté de médecine de Paris décrète que la plante est sans danger ce qui contredit l’arrêt du Parlement de Paris qui avait décidé, en 1748, son interdiction dans la France du Nord. Parmentier tente de prouver que la pomme de terre n’est pas dangereuse à travers son « Examen chimique » paru en 1778 et de plus qu’elle a la capacité de bonifier les terrains jugés incultes. Notamment, pour prouver concrètement ses dires, il la cultive sur un terrain loué à des religieuses, les sœurs de la Charité administratrices de l’hôpital, près des Invalides. Il organise des dîners où assistent de grandes personnalités comme le chimiste Antoine Lavoisier et l’Américain Benjamin Franklin. Il leur fait déguster diverses préparations.
Le philosophe Voltaire écrira le 1er avril 1775 que la plante peut être transformée en un « pain très savoureux ».15
Parmentier, soucieux de son extension, propose au roi Louis XVI en mai 1786 l’autorisation de planter le tubercule dans la plaine des Sablons, au village de Neuilly près de Paris. L’année précédente la France a connu une sécheresse catastrophique. Si ce n’est pas lui qui a introduit la plante en France, il a pourtant contribué fortement à la faire connaître aux Français, à la faire cultiver et à la manger.
En 1786, le terrain militaire apparaît inculte et sec, de plus il n’est pas question d’utiliser de l’engrais et la plantation se fera avec un décalage de six semaines par rapport au calendrier agricole. Action intéressante pour les paysans vu qu’il pourrait leur permettre de mieux organiser les temps de semailles qui s’effectuent généralement à la fin du mois de février et lors du mois de mars 16 .L’opération se réalisera sur un total de 23 ha. La légende veut que son souhait était de donner l’illusion que la culture opérée était un produit rare et onéreux destiné à la table du roi et de l’aristocratie. De ce fait, il l’aurait fait surveiller durant la journée par des soldats, mais non pas la nuit ce qui aurait incité les paysans alentour à piller les plants. Le stratagème aurait réussi car les paysans planteront des pommes de terre par la suite. En réalité, s’il y a bien eu vol, cet acte ne plaisait pas à Parmentier qui avait besoin d’observer ces plants en vue de son étude scientifique. De plus, la présence des soldats militaires était normale vu le statut du terrain considéré comme un terrain militaire. Il se serait d’ailleurs exclamé : « cupides rapines ». Un an plus tard, le 24 août 1787, à la veille de la fête de Saint-Louis, le terrain est parsemé de fleurs, Parmentier en fait un bouquet qu’il amène à Versailles et le donne au roi lors de sa promenade dans les jardins. Louis XVI en accroche une à sa boutonnière et en pique une autre dans la perruque de Marie-Antoinette. Alors que les courtisans se moquaient de lui, il aurait dit au roi : « Si le dixième du territoire de la France est planté de pommes de terre, voilà du pain tout fait ». Puis il lui aurait ajouté : « La France vous remerciera un jour d’avoir inventé le pain des pauvres. ». Le roi est venu assister à la récolte. L’agronome réitère l’expérience dans la plaine du village de Grenelle sur une surface de 7 ha. Le 21 octobre 1787, il convie Louis XVI et Marie-Antoinette à un repas aux Invalides – il occupe le poste d’apothicaire des Invalides depuis 1766 - constitué essentiellement de plats à base de pomme de terre, près de vingt. C’est un succès, les a priori tombent.
Plus tard, en 1789, il rédige un traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de la patate, et du topinambour afin de démontrer aux Français que ce n’est pas seulement une alimentation pour les aliments mais qu’elle peut nourrir l’homme , selon plusieurs manières.
En ce qui concerne sa culture, il ne tarit pas assez d’éloges pour elle. Elle « se plaît à tous les climats ; la plupart des terrains & des expositions lui conviennent ; elle ne craint ni la grêle , ni la coulure, ni les autres accidents qui anéantissent en un clin d’œil le produit de nos moissons ; enfin, c’est bien de toutes les productions des deux Indes , celle dont l’Europe doit bénir l’acquisition , puisqu’elle n’a coûté ni crimes ni larmes à l’humanité. » 17 Il regrette que de tristes familles paysannes ne la plantent pas vu qu’elle écarterait toute crise de subsistance sur leurs terrains couverts de landes et de bruyères. Ils pourraient accorder autant de « considération » pour elle qu’ils en ont pour les semences légumineuses & autres plantes potagères. » Il rappelle d’autres avantages qu’elle procure, l’aisance qu’elle procure dans sa consommation : « …ils peuvent aller dans leurs champs déterrer ces racines à onze heures , & avoir à midi une nourriture comparable au pain… ». Il est conscient qu’il faudra du temps pour que les agriculteurs renoncent à leurs « préjugés », à la « routine qu’ils ont héritée de leurs pères , & qu’ils transmettent à leurs enfans… ». Il compte sur l’exemple, les conseils et les exhortations. Les seigneurs et les curés sont d’après lui, ceux qui sollicitent son aide pour parvenir aux mêmes buts. Il écrit un mémoire aux Etats de Bretagne en vantant la plante.
Dans son traité, il cite, comme les agronomes qu’ils suivront dans cette étude, les observations faites, les descriptions des différentes variétés, les qualités mais aussi les maladies qui peuvent l’affecter comme le « Pivre » , nom donné en Flandre, qui a la particularité de rendre les feuilles « repliées sur elles-mêmes , bouclées , maigres & voisines de la tige, marquées de points jaunâtres… » 18 , l’attaque d’animaux comme le ver blanc…
Au sujet de la plantation, il suggère une période qui s’échelonne du début du mois d’avril jusqu’à la fin du mois de mai. Puis, il propose plusieurs méthodes. La première consiste d’abord à herser, puis à pratiquer une raie bien droite , deux paysans suivent l’un jetant du fumier et l’autre des pommes de terre « du côté où marche la charrue », puis on trace deux raies où on ne met rien , à la troisième on recommence comme précédemment . Les plantes doivent être séparées entre elles par une distance d’ un pied et demi. 19 Lors de la seconde, le fumier est répandu uniformément avant de planter la pomme de terre. Enfin, la troisième correspond d’abord à un labourage, à un hersage et à un creusement de nombreux rangs de trous d’un pied de profondeur et de deux de largeur, l’écartement des trous est d’environ trois pieds. Chaque trou est rempli de fumier que l’on foulera et dans lequel on met une pomme de terre que l’on recouvrira de terre ensuite. La quatrième se pratique avec deux individus creusant l’un avec une bêche et l’autre avec une houe des tranchées de cinq à six pouces de profondeur et de largeur. Ceci tandis que deux autres ouvriers jettent la plante à une distance d’un pied et demi et l’autre du fumier par-dessus. Il cite une dernière consistant à « renverser , à l’aide de la charrue , trois raies l’une sur l’ autre en forme de sillons , ce qui élève le terrain, & fait des ados d’ environ trois pieds de large ; le fonds de chaque sillon est fumé & ensuite labouré à la bêche … », à l’intérieur du trou on remplit de fumier que l’on met la plante à l’aide de la houe ceci à un pied de distance, les rangs étant séparés de trois pieds et chaque plante d’un pied. Après avoir décrit ces méthodes, il ajoute que l’on peut se cantonner à deux principales. Celle qui est la plus praticable est celle où on plante après le passage de la charrue et à la recouvrir en faisant le sillon suivant, celle qui suit est la culture à bras où on « pratique en échiquier, en quinconce, par rangées droites, dans des trous, des rigoles … ». 20 La récolte s’effectue dès le commencement du mois de juillet jusqu’au mois de novembre. Cette opération se tient lorsque les feuilles jaunissent et flétrissent naturellement, ce qui se produit généralement au cours de la fin du mois de septembre et du début d’octobre. On pourrait alors dans ce cas laisser les ovins brouter le feuillage auparavant. La récolte peut se pratiquer soit à bras d’hommes ou à l’aide d’une charrue vu qu’elle « déchausse promptement les racines, & met en rigoles ou raies ce qui étoit en sillons , en jetant dehors les pommes de terre , qu’on détache des filets fibreux qui les attachent ensemble , pour les mettre dans des paniers. » 21 Cette opération peut se réaliser avec des enfants vu que ces derniers n’ont pas besoin de se pencher, se baisser . En ce qui concerne la récolte à bras d’hommes, lorsqu’elle est faite sur des terrains légers il suffit de tirer les tiges à soi pour arracher les racines et les tiges ensemble. Par contre, lorsque la terre est « forte » il est nécessaire d’utiliser un instrument, la charrue sinon il reste la bêche, la houe mais elles ont l’inconvénient « d’entamer les pommes de terre ».
La plante a le mérite de supporter une double récolte si l’on prend soin de laisser les espaces nécessaires, par exemple, au pied de châtaigniers , de vignes, de maïs …Il rajoute que la pomme de terre a la particularité de préparer la terre pour d’autres végétaux comme par exemple le froment, l’orge ,le chanvre…vu qu’elle nettoie notamment le terrain des mauvaises herbes. Donc, sa culture n’est guère « préjudiciable à celle des blés ». 22 Il cite des individus qui ont expérimenté des méthodes, qui ont écrit des ouvrages d’agronomie comme des dénommés Chancey , Duhamel…
Remarque altruiste, il conseille les grands propriétaires, les paysans « humains » de « permettre aux indigens du voisinage de planter un rang de pomme de terre au bout de leurs sillons, le long des chemins, des haies, & de tout autre objet qui termine les champs ensemencés… ». 23
J.J. Menuret 1décrit cette plante comme un « végétal admirable qui contient abondamment du corps muqueux très doux & très-développé , susceptible des assaisonnements les plus recherchés & des préparations les plus simples, propre à être transformé en mêts délicats & variés pour la table des riches & à fournir une nourriture facile & simple à tous les ordres des Citoyens… ». Elle est intéressante comme « jachère » car elle peut être ensemencée, cultivée et recueillie durant l’année de repos. De plus, cette opération peut être réalisée « sans perdre une seule année, dans l’intervalle qui s’écoule entre la coupe des blés & les semailles , & c’est ce qui a lieu dans nos contrées méridionales ; dans les pays plus froids & plus humides , cette culture renvoyée au Printems ne laisse pas très-profitable. Lorsque le terrain est maigre, il faut y ajouter un peu de fumier… » . Il continue à vanter la pomme de terre en écrivant qu’elle lui « procuré beaucoup d’avantages ; les pommes-de-terre ont abondamment fourni aux usages économiques & à la table des maîtres , des grangers, des domestiques , à la nourriture des volailles , des dindes , des cochons ; il y en a eu pour distribuer aux indigens , pour vendre , &c. » 24
M . de la Bergerie de Bleneau 25, dans ses « Observations sur la Culture et l’Emploi des Pommes de terres » de janvier 1787, constate que tout le monde, hommes qui soient riches ou pauvres et animaux, louent les bienfaits de cette plante. Ce résultat serait dû notamment à M. Parmentier et aux instructions opérées par la Société royale d’agriculture de Paris et par l’Intendance. Il cherche à démontrer que la pomme de terre peut se planter sur n’importe quelle terre, qu’elle soit sablonneuse ou qu’elle soit exposée au soleil et composée de cailloux et de pierres. La pomme de terre est associée à de la vigne qu’il a plantée au mois de mars. Il a fait mettre dans le trou creusé par un ouvrier du terreau puis deux plants de vigne en faisant attention de remplir le dit trou qu’aux deux tiers et en espaçant les différents trous de deux pieds et demi ; les rangs sont distants les uns des autres de quatre pieds et demi. Ces critères sont choisis pour utiliser les bienfaits de l’ensoleillement, optimiser le plus possible « la nourriture pour le pied » et « tirer parti du terrain qui est entre les ceps, & qui peut, en quelque sorte, dédommager des frais coûteux de façon de Vigne ». Ensuite, l’auteur a fait planter dans l’espace « intermédiaire des rangs de Vigne …alternativement des Pommes de terres & du Maïs, & des Haricots au-dessus des ceps de vigne ». Ce procédé lui donne pleine satisfaction puisqu’il ajoute : « mes végétaux m’ont donné une récolte abondante... » et l’explique par ces commentaires : « la Vigne s’est bien trouvée de l’ombrage du Haricot, la Pomme de terre de celui du Maïs, & de ce dernier des nombreux Pêchers plantés çà et là… ». Enfin, il termine par démontrer que de donner de la pomme de terre à manger à des bœufs a été dans l’ensemble probant.
L’abbé Rozier consacre vingt-quatre pages dans le cours complet d’agriculture théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire 26 , il précise que les avantages de la plante sont multiples, « elle ne craint ni la grêle, ni la coulure, ni les autres accidens qui anéantissent en un clin d’œil le produit de nos moissons …étant en l’état de mieux alimenter les cultivateurs & leurs bestiaux pendant la saison la plus morte de l’année …que la race humaine pourra elle-même s’augmenter , puisqu’il est démontré par un grand nombre d’observations que cette plante est favorable à la population… » La plante assure, en Irlande, d’après l’auteur, des bienfaits pour les très jeunes enfants en les préservant de maladies et en leur procurant une plus grande robustesse. Il recommande aux paysans de la planter dans des jardins ou des vergers pour qu’ils soient sûrs d’être assurés d’une subsistance assurée et leur éviterait la disette. Au niveau du terrain, il n’y a pas « de terrains assez arides, assez ingrats, qui, avec du travail, ne puissent convenir à cette culture… Combien de landes où de bruyères, autour desquelles végètent de tristement plusieurs familles, seroient en état de procurer la subsistance, le superflu même, à beaucoup de nos concitoyens… » En effet, donnant une sorte de « pain tout fait », les pommes de terre …cuites dans l’eau ou sous les cendres, & assaisonnées avec quelques grains de sel, elles peuvent, sans autre apprêt, nourrir à peu de frais le pauvre pendant l’hiver… ». Si la plante ne craint pas trop les aléas (si c’est le cas, la saison suivante elle rebondira), il rappelle qu’il est nécessaire pourtant d’enlever les mauvaises herbes qui pourraient « …l’affamer & de lui porter une tige haute & effilée qui ne donne que de petits tubercules. » , d’où la nécessité de sarcler. Bien sûr comme toutes les plantes, elle subit l’attaque de maladies comme la rouille qui touche également le blé et d’animaux (taupes, mulots, vers blancs…).
D’après lui sa plantation doit s’effectuer lors d’une période qui débute au 15 mars jusqu’ à la fin du mois d’avril et « même plus tard dans les provinces méridionales ». Il note qu’il existe plusieurs méthodes selon la nature du sol et l’étendue du terrain. Par exemple, une consiste à tracer le sillon avec la charrue tandis que deux individus, en arrière, y introduisent du fumier et la pomme de terre. Puis, on réalise « deux autres raies dans lesquelles on ne met rien , ce n’est qu’à la troisième qu’on recommence à fumer & à semer, & ainsi de suite jusques la fin , en sorte qu’il y ait toujours deux raies vides… ». Autre méthode qui consiste d’abord à labourer la terre, de la herser afin de l’ameublir et de procéder à la réalisation de nombreux rangs de trous « d’un pied de profondeur sur deux de largeur, éloignés les uns des autres de trois pieds environ, on remplit ce trou de fumier qu’on foule exactement, & sur lequel on place une pomme de terre ou un quartier , qu’on recouvre ensuite avec une partie de la terre qu’on en a retirée… », mais l’auteur prévient qu’elle utilise beaucoup d’engrais et, par conséquent, elle est davantage préconisée aux alentours des villes importantes. Des cinq méthodes développées, il insiste sur la nécessité de laisser une distance suffisante entre les pieds, de mettre la semence à cinq ou six pouces de profondeur. Ensuite, il est important de sarcler et butter jusqu’à la récolte qui aura lieu dès le mois de juillet jusqu’au mois de novembre. Le choix se fera d’après le climat et le terrain. L’intérêt de la plante réside aussi dans la possibilité de la diviser pour ainsi la multiplier. La sève est si importante que souvent il se forme le long des tiges aux aisselles des feuilles & aux pédoncules qui soutiennent les baies. » La récolte s’opère lorsque les feuilles jaunissent et flétrissent, ce qui advient généralement à la fin du mois de septembre et durant le mois d’octobre. Le travail se fait soit par le biais de la force humaine en l’aide de la houe à deux dents soit par l’utilisation de la charrue. Les femmes et les enfants « détachent des filets fibreux (de la pomme de terre) qui les attachent ensemble. »
D’après Jean Lassansaa aucun document écrit ne fait référence à la pomme de terre en Béarn avant 1780. 27
Les Etats de Béarn démontrèrent leur intérêt au tubercule vu qu’ils diffusèrent notamment une brochure pour sa divulgation en 1781 : « Mémoire instructif sur la culture des pommes de terre, ouvrage très propre aux propriétaires de biens et cultivateurs » paru chez l’imprimeur J.P. Vignancourt à Pau. 28 Il est envoyé aux jurats des localités telles Morlaàs, Pau, Oloron, Orthez c’est-à-dire essentiellement des lieux de marché.
Denis d’Alband dans son ouvrage - écrit après l’épizootie de 1774 - remarque que la pomme de terre a des vertus mais lui reproche la trop grande utilisation d’engrais pour la cultiver et préconise de ne pas trop l’étendre. 10
b- Le lin
Louis de Cahuzac, dans son article tiré de l’Encyclopédie de Diderot, écrit à son sujet : « genre de plante à fleur en œillet ; elle a plusieurs pétales disposées en rond, qui sortent d'un calice composé de plusieurs feuilles, et ressemblant en quelque sorte à un tuyau ; il sort aussi de ce calice un pistil qui devient ensuite un fruit presque rond, terminé pour l'ordinaire en pointes et composé de plusieurs capsules ; elles s'ouvrent du côté du centre du fruit, et elles renferment une semence aplatie presque ovale, plus pointue par un bout que par l'autre. » Quant à l’encyclopédie Wikipidia , on peut y lire : « espèce de plantes dicotylédones de la famille des Linaceae, originaire d'Eurasie. C'est une plante herbacée annuelle, largement cultivée pour ses fibres textiles et ses graines oléagineuses ». Elle est née dans le Croissant fertile durant la haute Antiquité. A son sujet, on affirme qu’il est le plus ancien textile au monde puisque sa trace - sous forme de fibre - remonterait vers l’an 36 000 ans AVJC lors des fouilles entreprises en Géorgie dans la grotte de Dzudzuanas dans le Caucase en 2009. Le lin est utilisé en Egypte dans la pratique de la momification et dans l’habillement. Au musée du Louvre on peut voir une tunique de lin plissé confectionnée en 2033-171O trouvée dans la tombe de Neferrenpet. Les Egyptiens le cultivaient dès 3000 avjc. En France, elle se développe au XIIIe siècle notamment dans les Flandres, l’Anjou et la Bretagne. Elle se généralise davantage aux XVIIe et XVIIIe siècles. 300 000 ha de surfaces de lin couvrent la France au XVIIIe siècle permettant à quatre millions d’ouvriers d’en vivre.
Le lin permet à la fois de confectionner du tissu et de fournir une huile non comestible. Le résidu des grains broyés permet de réaliser des tourteaux de lin. Il peut atteindre une hauteur de 90 à 120 cm et donne des fleurs bleues pâles. Au moment de sa récolte, si on désire obtenir de l’huile, on le laisse mûrir.
Le préfet des Basses-Pyrénées Charles Achille de Vanssay, dans son rapport daté de 1811, estime la surface consacrée au lin dans sa circonscription à 5 115 ha. Sa répartition correspond, par ordre décroissant, à 3 270 ha pour Pau, 1 300 ha pour Orthez, 380 ha pour Oloron et, enfin, 165 ha pour Mauléon.
L’abbé Rouhaud écrit que le lin « est un objet considérable de culture et de commerce pour notre Province. Les lieux qui en fournissent en plus grande et de meilleure qualité sont Gand, Lons, Lescar, et presque tous les villages placés sur la ligne jusqu’à Bayonne. On en fait des toiles, des mouchoirs, du linge de table ... ».29
En Béarn, on le plante soit dans des champs pour satisfaire la demande des tisserands, notamment palois, soit dans des jardins pour le tissage familial. Mais il faut noter également que sa culture alimentait une industrie textile domestique importante vue la durée relativement longue de l’hiver et la possibilité de recourir à des ressources complémentaires lorsque la culture des terres et l’élevage des animaux devenaient moins contraignants. Les artisans présents dans les villages œuvraient à façon pour ces paysans qui leur vendaient leur surplus. Mais dès le XVIIe siècle, les villes exerçaient peu à peu leur emprise sur ces artisans. Par le biais des « marchands fabricants », ces cités, avec leurs foires et leurs marchés, accaparaient quelque peu les productions rurales. La ville de Nay, par exemple, au XVIIIe siècle, comptait une vingtaine de ces « marchands fabricants ». Pau, pour sa part, détient dans ses murs 600 métiers de toile de lin en 1765 ce qui correspond à un tiers environ de l’ensemble béarnais. 30
La production brute s’élève à 20 000 quintaux. Le Béarn jouissait d’une grande réputation en ce qui concerne le textile. Il suffit de rappeler que ses mouchoirs et ses toiles étaient confectionnés par deux mille métiers en 1782.
La culture du lin ne suffisait pas à fournir la confection au XVIIIe siècle. Le Béarn dut au XVIIIe siècle importer des fils de lin du Bas-Maine.
Mais à la fin du XVIIIe siècle la production manufacturière ruine la production artisanale. Ce n’est pas la seule cause, l’usage des cotonnades est également responsable, de même que les tendances vestimentaires qui délaissent les tissus dits grossiers. De plus, comme le signale Christian Desplat, les manufactures souffrent d’une main-d’œuvre rare et chère, d’une matière brute devenue insuffisante à la production provoquant alors son importation de l’étranger. 31On peut également adjoindre un défaut consistant à présenter des dessins souffrant d’un manque de variété. « A peine trouve-t-on dans la province, six ou huit tisserands capables d’exécuter un dessin qui sorte de la routine ordinaire… ». 32
La plante bénéficie dans la province de bonnes conditions climatiques. Naturellement pour sa croissance elle nécessite surtout des régions tempérées et humides Elle est peu gourmande en eau et elle ne nécessite pas de travaux d’irrigation, les terres peu argileuses sont à privilégier, par conséquent limoneuses.
Le lin peut-être semé au printemps (mars-avril) afin de parer les gelées, dans ce cas-là il fleurit en juillet et connaît sa pleine maturité en trois mois. Les champs prennent alors une coloration bleu violette. S’il est semé en automne (septembre-octobre), le lin éclot au début du mois de mai.
Le travail du lin s’avère fastidieux.
Jean Poueilh 33 nous rappelle que l’ « arrachage et bargage » étaient des opérations pratiquées par les femmes et cela « réclamaient une grande force de poignet ». Lorsqu’on arrache les tiges de lin, on les ensemble en bottes (massouns) « que l’on dispose en faisceaux posés verticalement sur le sol et alignés le long des règues : elles resteront là sécher pendant un mois environ…Lorsqu’il a suffisamment séché , le lin est battu, dépiqué sur l’aire (degrua), afin d’en détacher les graines mucilagineuses (liolos, carros)…Deux opérations agricoles, le rouissage et le teillage, sont ensuite nécessaires pour rendre le lin propre au tissage. Le rouissage du lin (naia lou lin) a pour objet de dissoudre la matière gommo-résineuse qui unit entre elles les fibres textiles et la tige de la plante ou chènevotte, afin de pouvoir isoler plus aisément les premières de la seconde. Dans ce but, on immerge les bottes de lin, entièrement et pendant un certain temps, dans l’eau courante d’un ruisseau ou dans une pièce d’eau stagnante, un routoir, un bassin à rouir (nài).On l’expose ensuite au soleil sur un pré fauché, et on achève la dessiccation en le passant au four. » Puis vient le teillage qui « consiste à séparer les fibres textiles du lin roui d’avec la partie ligneuse, en broyant les chèvevottes à l’aide de la macque ou broie (bargue, bàrgo, bràgo, brègo, brégou, bargadouiro). Ce brisoir se compose de plusieurs lames de bois, cinq d’ordinaire, assujetties sur une espèce de chassis ; deux de ces lames sont mobiles et forment battoir. Les broyeuses (barguedoures, bregarellos), plaçant de la main gauche le lin sur la surface inférieure de l’instrument, actionnant vivement de la droite la partie mobile (hourrigue, manchein), laquelle, frappant les chèvenottes prises entre ces deux mâchoires, les brise sans toutefois rompre les fibres. Un second teillage, plus minutieux, est effectué avec des sérançoirs ou peignes spéciaux (barguèros, pientis de ferri). Du lin ainsi sérancé (sarrancé) , on retire la filasse, l’étoupe, dont sera chargée l’extrémité de la quenouille ‘counoulho de lî)… ».c- Le mûrier
Les mûriers sont d’après l’abbé Roubaud des arbres nouvellement introduits dans le Béarn. Il en existe deux espèces, le noir et le blanc. La première catégorie donne des feuilles plus grandes, plus épaisses et d’un vert plus foncé. Sa croissance est plus lente. C’est la seconde espèce qui est utilisée pour nourrir les vers à soie.
En France, la culture des mûriers se développe notamment lors de la période qui nous intéresse, le XVIIIe siècle et ceci dès sa première partie.
L’Encyclopédie de Diderot a cherché à inciter les particuliers à planter les mûriers blancs.Voici ce qu’on peut lire dans son article traitant le mûrier : « …il s’en fait une consommation si considérable dans ce royaume, que malgré qu’il y ait déja près de vingt provinces qui sont peuplées de mûriers, & où l’on fait filer quantité de vers à soie, néanmoins il faut tirer de l’étranger pour quatorze ou quinze millions de soies. Et comme la consommation de nos manufactures monte à ce qu’on prétend à environ vingt-cinq millions, il résulte que les soies qui viennent du cru de nos provinces ne vont qu’à neuf ou dix millions. Ces considérations doivent donc engager à multiplier de plus en plus le mûrier blanc. Les particuliers y trouveront un grand profit, & l’état un avantage considérable. C’est donc faire le bien public que d’élever des mûriers. Quoi de plus séduisant ! » 34 En province, des responsables de l’autorité royale cherchèrent eux aussi à le développer, on cite communément l’Intendant Joly de Fleury en Bourgogne.
D’après lui, ce sont les négociants oloronais qui les auraient apportés d’Espagne mais ces arbres auraient été « dédaignés ». Cela a été effectif dans le premier quart du XVIIIe siècle.
Il existait bien une pépinière à Pau, exactement dans les jardins royaux du château, elle datait du XVIe. En 1742, on plante sur ordre de l’Intendant de Sérilly une pépinière de mûriers dans un tronçon sud-ouest -dans l’ancien potager des rois de Navarre - à la suite d’une mesure prise par les Etats de Béarn en 1724 mais par la suite en raison du manque d’entretien elle se trouvait dans un triste état (dans une lettre de l’Intendant d’Etigny ce dernier mentionne qu’on y avait semé « du petit linet, des haricots, et autres menus grains et légumes ») 35 . En 1747, on distribue des mûriers pour inciter au développement de leurs cultures.
Lorsque l’Intendant d’Etigny prend ses fonctions dans la province, 1 157 pieds de mûriers (mais aussi 900 noyers) ont été ainsi alloués. Il est annoté que la pépinière a rapporté 27 livres, 17 sols et 6 deniers tandis que les dépenses s’élevaient à 510 livres et 3 sols.36
Elle sera supprimée en 1774 par les Etats qui avancèrent le prétexte suivant : « celle-ci n’ayant eu aucun succès ». 37
A travers l’action de l’Intendant d’Etigny pour développer sa culture en 1752 (augmentation d’un quart la superficie des plantations ce qui permit à la soie du Béarn de surpasser celle des autres provinces et même d’Espagne, plantation privée, fondation d’ateliers pour la fabrication de la soie à Auch), son exemple est suivi et « on vit des mûriers dans toute la Province au moins sur la lisière des champs, et les pépinières furent épuisées ». Les comptes de l’année 1752 enregistrent un succès puisque la production représente dix fois plus de celle de l’année précédente. Les mûriers sont présents aux alentours de Pau, de Sauveterre-de-Béarn et d’Oloron.
L’abbé Roubaud mentionne ensuite le nom de M. de Laclède que nous avons vu et que nous retrouverons plus tard, qui est propriétaire de plantations de mûriers dans la vallée d’Aspe. 38 Cette tentative d’introduction et d’incitation se retrouve dans d’autres généralités françaises, comme par exemple celle administrée par l’Intendant de Tours Jacques-Etienne Turgot de Sousmont (1704-1709) . Ce dernier, dans son Mémoire, relate l’échec de l’essai entrepris au XVIIe siècle pour développer l’élevage des vers à soie, ceci malgré le fait que l’on ait distribué aux gens des plants de mûriers. Il écrit, en effet, que cette action suscita « peu de curiosité de la part des habitants indifférents ». Néanmoins, il tenta lui-même à nouveau de relancer l’opération en 1722, il réussit alors à obtenir un meilleur résultat.39
L. Madel Bodel 40 dans son essai prévient que la culture réussira que si l’instigateur est un « …homme instruit & capable d’en diriger toutes les opérations… » , alors « …il est certain que dans moins de quinze ans , on y verroit la culture du Murier solidement établie, & son produit déja très-considérable… ». Il prévient toutefois que si le murier provient d’un pays chaud où on en trouve « des Forêts entieres » et « qu’il se naturalise assez bien par tout, cependant plus on s’éloigne de son véritable climat , & plus il demande pour le multiplier, une culture qui suplée à ce que la nature lui refuse.» En effet, la feuille a un « …grand penchant à dégénérer… » notamment dans les contrées où il fait froid. Il fait référence surtout, dans ce cas-là au mûrier blanc qu’il a davantage étudié en Bourgogne, durant une dizaine d’années.
Bien qu’avocat au Parlement de Navarre, Jean de Laclède délaisse sa fonction par manque de motivation. Par contre, la culture du mûrier l’intéresse et, en mars 1756, il en plante 300 dans la localité de Bedous, 200 autres près d’un an plus tard, en janvier 1757et, encore, 200 à la fin de la même année, en décembre. Quelques années plus tard, le 9 mars 1763, il prend ses fonctions de maître des Eaux et Forêts de Pau et se marie, non pas comme son père avec une aristocrate, mais avec une fille de commerçants palois, Cécille Bourbon. Son projet de culture de mûriers ne l’a pas quitté puisque toujours à Bedous le nombre de pieds s’élève à 3000. Il le poursuit à Pau où sa première tentative de soie, en 1764, se solde par un résultat mitigé car cette dernière présente des imperfections. Par la suite, la pépinière royale lui donne davantage de satisfaction vu qu’elle procure plus de deux mille plants. Pour y parvenir, il emploie des ouvriers languedociens plus spécialisés dans la sériciculture notamment des femmes. Ils jouent aussi le rôle de formateurs dans la province.
Mais il ne faut point omettre qu’il était également critique vis-à-vis de l’avenir de son projet. Il était conscient que les dividendes de l’entreprise n’assuraient guère que leur entretien et que le travail était seulement assuré durant deux mois dans l’année.
Mais cela n’empêche pas de poursuivre les démarches et, trop impatient devant leur lenteur, il a le tort également d’en adresser aussi au représentant du pouvoir royal, l’Intendant, ce qui déplaît aux Etats de Béarn, très suspicieux envers les programmes royaux, qui en prennent ombrage. Surtout que la lettre qu’il envoie au dit Intendant est une invitation à l’utilisation de l’autorité.41 Laclède voit son projet tomber à l’eau en 1768 . A cette date, il leur présente un « Mémoire sur les moyens à prendre pour multiplier les mûriers et les soyes , faire tirer les soyes , et préparer les flurets dans la province de Béarn. » 42 qui est rejeté. Les dépenses prévisionnelles selon lui sont réparties de la manière suivante : 100 000 livres seront réservées à des gratifications obtenues par des crédits d’ordre public , cette part correspondant à la majeure partie, il est prévu 2 100 livres annuels afin de rémunérer ceux qui travaillent soit 1 400 livres versés à un contrôleur , 900 livres pour des tireurs de soie et, enfin, 800 livres pour payer quatre arboristes. Un local est envisagé pour la transformation, il cite à nouveau le collège des Jésuites abandonné comme cela a été écrit. Il dresse également un bilan à long terme et envisage une dépense de 133 400 livres au bout de dix ans . Elle serait à la charge pour une moitié de l’Intendant d’Etigny qui se serait engagé et, pour la seconde partie, confiée à la province. Cette dernière récupèrerait une grande partie de son investissement préalable et n’aurait alors à débourser que 752 livres 10 sols annuellement.
Il est à noter néanmoins que plusieurs personnes appartenant à l’administration royale aient eu soin de lui délivrer des lettres de recommandations. Parmi eux nous retrouvons l’Intendant des finances Daniel-Charles Trudaine, économiste éclairé, qui écrit à l’Intendant d’Etigny, quelques années auparavant, le 17 décembre 1766 exactement : « Je verrai avec plaisir ce genre d’industrie se multiplier » et quelques mois plus tard à l’intéressé même, Laclède, le 18 février 1767 une lettre l’affirmant qu’il le soutenait et l’encourageait. 42 Autre personnage important dans la province, l’évêque Marc-Antoine de Noé, président des Etats de Béarn, alla jusqu’à proposer une somme de 1 000 Livres afin de l’indemniser. 43 Sur les dix-neuf membres présents du Grand-Corps malheureusement douze appuyèrent son projet. Les adversaires les plus radicaux se trouvaient parmi les délégués du Tiers, prétextant que sa demande se rapprochait davantage plus d’une « gratification » que d’un « dédommagement ». Cette décision d’après le baron de Navailles se rapprochait davantage d’une intrigue. En effet, ce membre du Grand Corps, regrettant ce refus, s’en explique à l’Intendant d’Aine dans une lettre du 15 septembre 1768, démontrant son regret.41 Un mémoire rédigé par un personnage - resté anonyme - auprès du pouvoir royal mentionne que : « … Tout cela est le fruit de l’intrigue, de la jalousie, des préjugés, des faux raisonnements, et du goisme… » et de rappeler que même parmi les membres du Grand Corps seuls quatre d’entre eux s’avéraient être des mûriers. Au sujet de Laclède, il dénonce le jugement porté par les opposants en affirmant qu’au contraire il a montré par «…son arrêté du 11e may 1768 son indifférence et son aveuglement pour ses propres intérêts… ». 41
Par une lettre du contrôleur général Laverdy à l’intendant d’Aine datée du 2 juillet 1768 on apprend 41 qu’il a pris l’initiative personnelle de lui allouer une dotation de 1 200 livres au titre de dédommagement.
Plus tard, en 1772, Les Etats , par le biais des députés du Tiers , refusent à nouveau le projet de Laclède et vont même jusqu’à supprimer la pépinière de Pau – trop onéreuse selon eux vu que sa charge coûte à la province 2 000 à 2 400 livres annuellement - et à décider d’allouer l’argent, lors de la délibération du 2 juillet 1768, « …à des pépinières plus utiles et plus conformes au sol de la province qu’à leur défaut aux ouvrages des chemins. » De plus, ils notent que les mûriers «….sont nuisibles parce que cette espèce d’arbres a une quantité de racines qui s’étendent au loin et qui appauvrissent beaucoup le terrain… ». 44 Il est vrai qu’en 1766 un constat dressé par Laclède lui-même fait remarquer que le nombre des pépinières est trop élevé et que la sériciculture est une pratique trop compliquée pour les agriculteurs béarnais. Il va jusqu’à écrire que l’échec est dû en partie « ….au peu d’intelligence des cultivateurs… ».
Deux ans plus tard, exactement le 4 janvier 1774, le contrôleur général donne son accord à cette décision prise lors de la délibération des dits Etats et on réunie les fonds des Ponts et Chaussées et de la pépinière. 45
Il aura toutefois la satisfaction de voir planter 103 000 mûriers près de deux ans plus tard-, en cause surtout le conservatisme de l’élite béarnaise, notamment des parlementaires qui ne daignèrent guère investir mais aussi du fait de la défaillance d’une main d’œuvre qualifiée incapable de s’occuper correctement des cocons. On fit venir des ouvriers du Languedoc que l’on dut rémunérer fortement. On réussit toutefois à réaliser une soie de bonne qualité notamment dans une filature paloise qui employait huit salariés mais ce n’était pas suffisant. Des petits exploitants agricoles tentèrent bien de leur côté d’en planter mais sans grand succès.
Beaucoup d’entre eux rechignaient à s’investir, découragés par les frais d’achat, en effet, chaque pied coûtait 2 sols et 6 deniers. 46 Ceci malgré les sollicitations et les aides octroyées comme par exemple la baisse des prix et les distributions offertes.
Christian Desplat s’inscrit en faux lorsqu’on accuse les Etats de Béarn de freiner le succès du projet et d’avancer qu’ils participèrent à hauteur de 40 000 livres dans la période qui s’échelonne de 1742 à 1773 et d’ acheter 210 000 mûriers entre 1747 et 1768. Parmi les acquéreurs on trouve des parlementaires dont le président du Parlement de Navarre lui-même. La faute de l’insuccès réside plutôt à des « carences structurelles et conjoncturelles » dont le manque de « tradition manufacturière, défaut de main d’œuvre qualifiée, difficultés postérieures à la crise des années 1770 et surtout désintérêt des principaux bailleurs de fonds de la province : les nobles ». 47
Toujours selon l’auteur, ces décideurs étaient davantage préoccupés de ne pas perturber « un équilibre de plus en plus précaire » de « l’économie sylvo-pastorale ».
D’après le même auteur les véritables « muriomanes » sont des « ruraux modestes ».
Il écrit également que « l’échec n’était pas donc technique comme ce fut le cas dans d’autres provinces ; en 1768 le produit brut des ventes de soie se montait à 21 656 livres 5 sols (en poids : 984 livres de soie) . » 49 Plus loin, il rajoute que « La démarche des novateurs comme Laclède tendait à briser les tendances autarciques et communautaires de l’économie provinciale ; elle trouvait ses limites dans la méfiance des capitaux locaux , l’absence de main d’œuvre qualifiée et la difficulté à s’intégrer au marché national sinon par pure gravité. Dans un univers où dominaient les petites propriétés mais aussi les servitudes communautaires, l’individualisme agraire, précurseur d’un véritable capitalisme agraire avait peu de chance de triompher. »
Enfin, l’abbé Rouhaud se lance dans un réquisitoire sur l’élevage du ver à soie, démontre que le climat béarnais par son irrégularité des saisons n’est pas très propice, puis, selon lui, en se référant aux mûriers, prévient : « …il ne faudroit pas que ces arbres usurpassent de bons terreins, que ces vers dévorassent les brebis, et qu’une culture très-subalterne devint une manie dominante ».
Les effets du climat seraient également responsables de l’échec de l’implantation de mûrier puisque des documents attestent que sur 210 000 arbres plantés seulement 105 000 d’entre eux survécurent. 41
Cette opposition va à l’encontre de l’avis de L. Madel Bodel qui préconise sa culture. Il constate que le murier fait la richesse « de tous les Pays où il a été transporté, & ces richesses sont d’autant plus précieuses, qu’elles ne seront jamais arrosées du sang des malheureux … », il fait référence alors aux mineurs péruviens et mexicains que l’on exploite afin d’extraire l’or et l’argent et qui succombent à la tâche, conséquence de « l’avidité de ces métaux » et qui a provoqué le dépeuplement de l’Amérique. A ces malheureux américains, il ajoute les Africains – il s’agit bien sûr des esclaves noirs touchés par le commerce atlantique - que l’on tue dans les « Colonies du nouveau Monde », provoquant aussi le dépeuplement de continent africain.50 Il cite enfin l’exemple du Languedoc qui , avec la production de céréales, de vins, de fruits, s’enrichit davantage grâce à la soie et, de ce fait, est devenue « la plus riche Province du Royaume ». Enfin, il déplore que le pays est obligé d’importer des soies afin d’alimenter nos manufactures et, par conséquent, dépenser des « sommes immenses ». Pour éviter ce manque à gagner, il est nécessaire de se lancer dans la culture du mûrier nécessaire aux vers à soie. Il reconnaît que les Etats, en général, ont tenté de la développer à travers les pépinières publiques comme nous l’avons vu en Béarn. 51
Références :
1- Moriceau Jean-Marie, article : céréales, Dictionnaire de l’Ancien Régime, puf quadrige, 1996.
2- Dralet Etienne-François, Description des Pyrénées considérées principalement sous le rapport de la Géologie, de l’Economie politique, rurale et forestière de l’Industrie et du Commerce, Paris Arthus Bertrand 1813, tome 2.
3- Mémoires de l’Intendant Lebret, Bull.SSLA de Pau, 2e série, tome 33, 1905, p. 121 et 122.
4- Foursans-Bourdette, M.P., Histoire économique et financière du Béarn au XVIIIème, Bordeaux : Bière, 1963.p. 34-35.
5- Lassansaa Jean, Billère au fil des siècles, histoire d’un village béarnais de la fin du Moyen-Age à nos jours, Revue Régionaliste des Pyrénées, 56e année, n° 201-202, janvier à juin 1974, p.55.
6- Abbé Roubaud, extrait du Journal, du Commerce, des Arts et des Finances par l’abbé Dubahat, Bull. SSLA de Pau, 1911, 2e série, tome 39, p. 211.
7- Soulet JF, Les Pyrénées au XIXe siècle, Organisation sociale et mentalités, tome 1, Editions Eché, 1987, p 74.
8- Méthode battre et de fouler les grains à l'aire, dans les Provinces méridionales de la France, par M. Amoreux, fils, Correspondant, à Montpellier. Mémoire d’agriculture, d’économie rurale et domestique publiée par la Société d’agriculture royale de Paris, p. 48.
9- Menuret J.J., Mémoire sur la culture des Jachères, Mémoire d’agriculture, d’économie rurale, et domestique publiée par la Société royale d’agriculture de Paris, p. 78.
10- D’Alband Denis, Moyens d’entretenir la culture des terres après l’épizootie des bâtes à cornes, Pau, J.P. Vignacour, 1776, Pau.
11- Rozier abbé, article battage, Cours complet d’agriculture théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire, Paris, 1782, tome 2, p. 94.
12- Menuret J.J., op.cit., p. 79.
13- Moriceau J.M., article « Pomme de terre » tiré du Dictionnaire de l’Ancien Régime, PUF quadrige, 1996.
14- D' après Charles du Faure de Saint-Sylvestre, La Truffole en France, 1785.
15- Dr Lemay Paul, Une lettre de Voltaire à Parmentier, Revue d’histoire de la pharmacie, vol. 25, 29 août 1937, p. 126.
16- Thouin, Broussonet, Dumont, Cadet-Levaux, Rapport sur la culture des pommes de terre faite
dans la plaine des Sablons & celle de Grenelle, Mémoires d’agriculture, Société Royale d’Agriculture de Paris, Paris, Buisson, trimestre d’hiver, 1788, p. 47.
17- Parmentier Antoine, traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de la patate, et du topinambour, chez Barrois Libraire, Paris, 1789, p. 4.
18- Idem., p.63.
19- Idem., p. 100.
20- Idem., p. 105.
21- Idem., p. 115.
22- Idem., p. 162.
23- Idem., p. 143.
24- Menuret J.J., opus. cit., p. 81.
25- M. de la Bergerie de Bleneau, Observations sur la Culture et l’Emploi des pommes de terre, Mémoires d’agriculture, d’économie rurale et domestique publiés par la Société royale d’agriculture de Paris, janvier 1787, p. 81.
26- Rozier abbé, op.cit., p. 179.
27- Lassansaa Jean, op.cit., p. 54.
28- A.D.P.A. C 1337.
29- Dubarat abbé : Article de l’abbé Rouhaud sur l’Agriculture, le Commerce, et l’Industrie en 1774 dans Bull.SSLA , 2e série, tome 41, 1914-1917, p. 215
30- Caput J., L’évolution géographique d’une petite capitale pyrénéenne : Pau, Revue géographique Pyrénéenne Sud-Ouest, XVIII-XIX, 1947-48, p. 132-152.
31- Desplat Christian, Principauté du Béarn, partie 2, Edition « société nouvelle d’éditions régionales et de diffusion », 1980, p 595.
32 A.D.P.A. C.278.
33- Poueilh Jean, Le folklore des pays d’oc, la tradition occitane, petite bibliothèque payot, 1976, p. 97.
Voir aussi : Sandinis P., L’industrie familiale du lin et du chanvre, Annales de la Fédération pyrénéenne d’économie montagnarde, Toulouse, 1940-1941, p. 100 à 116.
34- Encyclopédie de Diderot, exemplaire Mazarine, volume X, p. 872.
35- A.D. du Gers, C 3, lettre de d’Etigny au garde des Sceaux, 8 août 1752.
36- A.D.P.A. C 1303.
37- A. Nat. H 86, Lettre de M. de Sus au contrôleur général du 26 février 1774.
38- Dubarat abbé : « Article de l’abbé Rouhaud sur l’Agriculture, le Commerce, et l’Industrie en 1774 » dans Bull.SSLA , 2e série, tome 41, 1914-1917, p. 216.
39- Archives nationales : mémoires et notes littéraires, 745AP/17 dossier 5 et 745AP/21, dossiers 2-4.
Voir aussi Maillard Brigitte, Les campagnes de Touraine au XVIIIe siècle, chap. 7 : les fruits de la terre, pages
171-208, Presses universitaires de Rennes.
40- L. Madel Bodel, Essais sur la culture du mûrier blanc et du peuplier d’Italie, et les moyens les plus surs d’établir solidement & en peu de tems le Commerce des Soies, Edition 1766, Imprimeur Defay, page III de la
préface .
41- A.D.P.A. C 280.
42- A.D.P.A. C 1303.
43- A.D.P.A. C 804.
44- ADPA C 280 et ADPA C 283 et voir aussi - Laumon Raymon, Histoire de la vallée d’Aspe, Editions Monhelios, 2006, p. 92
45- A.D.P.A. C 286.
46- A.D.P.A. C 279.
47- Desplat Christian, Économie et société rurales en Aquitaine aux XVIIe-XVIIIe siècles . In: Histoire, économie et société, 1999, 18ᵉ année, n°1. Terre et paysans, sous la direction d’Olivier Chaline et François- Joseph Ruggiu. 2002, p .152.
48- Desplat Christian, Pau et le Béarn au XVIIIe, thèse doctorat Pau, tome 2, chez J. et D. Editions Biarritz, 1992, p. 84.
49- Idem, tome 1, p. 93.
50- L. Madel Bodel, Op.cit., p.2.
51- Idem, p.6.
-
Par Michel64a le 7 Juillet 2021 à 20:07
MAÏS ET VIGNES RECOLTES EN BEARN AU XVIIIe SIECLE
Le Béarn est une région agricole à majorité agricole au XVIIIe siècle, la polyculture y est dominante. Comme l’écrit M.P. Foursans-Bourdette, cette nécessité « dépendait à la fois des besoins de la consommation et des variabilités du climat ». Elle cite l’exemple de l’association céréales-vignes-prairies-touyas et ajoute le caractère enchevêtré des parcelles.
J. Bergeret nous a laissé une description des terres béarnaises dans son préliminaire de son traité de la flore des Basses-Pyrénées : « La surface de la terre habitable est presque partout couverte de végétaux et les espèces sont plus ou moins multipliées dans une contrée, suivant les circonstances plus ou moins variées du sol, du climat et des eaux. Le département des Basses-Pyrénées, baigné d’un côté, par la mer ; borné au sud par les Pyrénées ; arrosé par des torrens qui portent dans nos plaines des débris calcaires, argileux ou siliceux des montagnes ; incliné vers le nord-ouest interrompu dans cette direction par des collines disposées en amphithéâtre et souvent coupées en travers par des ravins ; offre, au milieu de la zone tempérée, la chaleur brûlante du midi, à côté des neiges et des glaces du nord. Aussi, voyons-nous dans les différentes parties de son étendue, les plantes de tous les climats, celles qui croissent dans les eaux douces et salées, celles qui se plaisent que sur les rochers, dans les sables et dans les marais. On y trouve des arbres propres aux constructions civiles et navales, des bois utiles pour le charronage, pour la menuiserie, pour toute sorte d’ouvrages de tour, de marqueterie, de lutherie et d’ébénisterie, des arbrisseaux flexibles pour la vannerie, ou recherchés pour la décoration des jardins, des plantes précieuses pour la teinture, pour les tanneries, pour les fabriques, pour toutes sortes d’usages ruraux et domestiques ; des plantes excellentes pour la nourriture de l’homme et pour celle des bestiaux, des plantes vineuses, huileuses ou résineuses ; des fleurs superbes, enfin, des plantes médicinales et vénéneuses. »1
Dans cette partie, nous étudierons quelques plantes qui ont été cultivées par les Béarnais soit pour leur alimentation propre, soit pour nourrir leurs animaux ou encore à des fins commerciales.
A) Le maïs, une arme contre les disettes.
Le maïs tire son origine de la téosinte d’après les dernières recherches opérées notamment par Doebley. Plante croissante à l’état naturel en Amérique centrale, plus particulièrement les Caraïbes, elle a mû et a été modifiée à la suite de sélections par l’homme.
Il s’agit d’une plante importée en Europe par les Espagnols après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Ce dernier la ramène lors de sa première expédition de 1492 à Séville. Ensemencée d’abord en Andalousie, celle qui est surnommée par les Aztèques "herbes des Dieux", conquiert ensuite le reste de la péninsule Ibérique. Vers 1610, elle gagne la Cantabrie et les Asturies. Toujours au XVIIe siècle, elle est plantée en Italie. On la retrouve en France, mais la chronologie de son installation dans les diverses régions pose un problème durant tout l’Ancien régime. Ce qui est sûr, c’est sa présence bien établie dans le sud-ouest à la fin du XVIIIe siècle. Son origine exotique a suscité auprès des paysans une certaine méfiance, surtout si on la compare avec le blé, céréale emblématique.
Déjà sous l’Ancien régime, elle suscite des interrogations Fernard Fushs n’écrit-il pas en 1542 à Bâle : « Ce bled est du nombre de ceux que l’on nous a apportés d’étranges pays. Il vient de Grèce et d’Asie en Alemeigne, et de là on l’appelle bled de Turquie. Car pour le jourdhuy , le grand turc possède et universellement toute l’Asie. » ? (De historia spirpium Commentarii insignes).
a- Implantation en Béarn
Une ordonnance prise dans le Pays Basque le 14 mai 1523 par le gouverneur de Bayonne, vicomte de Lautrec, interdisant aux riverains de la Nive de jeter du blé « d’arthomayro », fait débat.
Le texte : «… Vous mandons et à chacun de vous…commandons, par ces présentes, de par le Roi, notre Sire… à chacune des paroisses de Labour et à tous autres dont serait requis, étant à six lieues de lad ville, que dorénavant quand ils réduiront à culture leurs terres et couperont leurs arbres, racines et blé d’arthomayro, incontinent s’efforcent… branches racines et pailles d’arthomayro, à retirer hors lieu où leds rivières ont cours ; icelles coupent par menu ou brûlent de manière que ne portent aucun préjudice aux ponts, chaînes et, choses publiques de lad ville, aux peines que dessus… ».
Nous sommes alors au moment où l’on prend des mesures afin de soutenir un siège contre les Espagnols. 2 Le terme « arthomayto » d’origine basque pourrait correspondre à « gros mil » et plusieurs auteurs ont évoqué alors qu’il désignerait le maïs.
Mais J.J. Hemardinquer avance l’idée que le mot « mairo » correspond plutôt à « Maure » ou à « sauvage » (et donc que l’arthomayto se rapporte en fait au sorgho) et non au maïs.
Plus tard, en 1628, l'appellation "froment d'Inde" est transcrite dans un texte qu'on a trouvé. D’ailleurs les deux vocables « froment d’inde » et « Mayrou » y sont écrits, le premier concernant le maïs. Toujours dans le Pays Basque, en 1644, sa présence est établie et sa place est devenue importante : « La habitants du pays du labourd sont obligés de brusler et oster des prairies… la paille de mairou, mais comme ce bled n’est plus en usage et qu’au lieu de celluy la on y fait à présent du millet d’Inde, la paille duquel charge plus que ledit mairou. » Le même J.J. Hemardinquer soutient que ce que l’on désigne par le nom d’arthomayro n’est tout simplement qu’un sorgho à épi.
Ce dernier serait différent de celui que l’on trouve alors en Béarn. Le premier plus volumineux que le second qui correspond à celui que l’on nomme « sorgho à balais ». Cette plante herbacée de la famille des Graminées est plus rustique que le maïs et s’adapte très bien à tous types de sol.
En ce qui concerne le Béarn, on mentionne généralement, comme l’ont fait R. Ritter et Cuzacq, la date de 1563. Cette année-là, un espion espagnol, Juan Martinez d’Escurra rend compte à Philippe II d'Espagne de ce qu'il observe à Navarrenx, où s'édifie la forteresse que nous connaissons et use de ce mot en désignant un fourrage vert qui serait impropre aux chevaux montés par les cavaliers espagnols. Il emploie l’expression « mijo y borona ». J.J. Cazaurang écrit que le terme de « borona » est celui que l’on utilise à propos d’une variété de panis à une période antérieure « à l’introduction du maïs en Espagne ». Il fait référence à J.J. Hemardinquer qui ne voit dans la combinaison des deux appellations « mijo y borona » qu’une référence aux « millet et panis ».
Un autre témoignage, celui du chanoine du Quercy nommé Léon Godefroy, en 1644 : « En Béarn, les millets d’Espagne ou de Bordeaux (maïs) sont hauts de dix ou douze pieds et on en transforme la tige en échalas pour les vignes. » 3
J.J. Cazaurang doute encore que ce soit réellement du maïs. Il penche plutôt que cela soit encore du sorgho.
On pense que la plante est connue dans le Labourd au début du XVIe siècle, surtout cultivée dans les jardins. On la retrouve dans certains marchés de Bresse aux alentours de 1625, dans la mercuriale de la cité de Castelnaudary en 1637.
J.J Cazaurang note que c’est « au cours du XVIIe siècle, et sans doute après 1650, que le maïs conquiert le Béarn. Il s’impose aux dépens des millets et sorghos. 4
Son extension dans la province a probablement été retardée par l’importation de blés en provenance d’Aragon, qui permettait de pallier les insuffisantes ressources céréalières dont souffrait le Béarn.
L’Intendant Pinon en adressant son mémoire à Louis XIV mentionne au sujet du Béarn : « Les plaines y sont assez belles et assez fertiles. On y sème peu de froment et de seigle ; mais il y a quantité de milloc, qui est un blé venu des Indes, dont le peuple se nourrit. » 5
L’Intendant Lebret est plus explicite au sujet de la culture du maïs en Béarn. Voici ce qu’il écrit dans le mémoire adressé à Louis XV au sujet des terres agricoles béarnaises en 1703 : « Le terrain est bon et produirait beaucoup sans cet accident (il s’agit des gelées) qu’on évite en partie en semant du maïs ou blé de Turquie qui sert pour la nourriture des paysans. Les champs de la plaine de Pau, de la vallée de Josbaight, des plaines de Navarrenx et de Sauveterre ne se reposent jamais ; on les trouve toujours semés, tantôt de froment, tantôt de seigle, d’avoine, de lin, de millet et très souvent de maïs... Le maïs ou blé de Turquie s’est introduit en Béarn depuis peu d’années…» 6
Lentement, le maïs gagnera du terrain dans le Béarn, le long du gave de Pau et, enfin, dans les mercuriales béarnaises au début du XVIIIème siècle.
Lors de son voyage en Gascogne en 1646, voici comment Léon Godefroy décrit les terres agricoles ensemencées de maïs : « les millets viennent icy en très grande abondance et fort bien. Il y en a de toutes sortes : masle et femelle ; rouge, gris, noir et blanc. Il se trouve des endroits où l’on fait des tranchées de plus de trois lieues parmi iceux. J’ay veu entres autres de gros millet d’Espagne ou de Bayonne, haut de dix ou douze pieds, dont l’on tire ces utilités de servir au bestail tant pour le pasturage que litière, du grain pour faire du pain de millet et milliasses, la tige pour les eschalats. » 7
Vers la moitié du XVIIIe siècle, selon Marie-Pierrette Foursans-Bourdette, la moitié des terres labourables sont ensemencées en maïs, elle cite notamment la plaine de Nay « où en 1784, 80 % des terres labourables sont consacrées au maïs ».8
b- Généralités, les points de vue de théoriciens agronomes du XVIIIe siècle au sujet du maïs
Pourquoi l’appelle-t-on « blé de Turquie » ? En lisant l’ouvrage du botaniste allemand Léonard Fuschs, auteur de l’ouvrage intitulé « De historia stirpium commentarii insignes » (Bâle Insingrin, 1542), «Ce bled (comme plusieurs autres) est du nombre de ceux que l’on nous a apportés d’étranges pays. Il vient de Grèce et d’Asie en Alemeigne, et de là on l’appelle bled de Turquie. Car pour le jourdhuy, le grand turc possède et détient universellement toute l’Asie ». Dans l’Encyclopédie de Diderot, on lit à l’article maïs : « (Botanique) et plus communément en français blé de Turquie, parce qu'une bonne partie de la Turquie s'en nourrit. » Ici, on constate que l’utilisation du nom donné au « blé de Turquie » est en fait est impropre puisque le maïs est originaire du Nouveau monde et non de Turquie.
Voici un exemple parmi d’autres, le nom de blé de Turquie est assimilé au sarrazin.
Figuration du sarrasin nommé « Ble de turquie » tirée de « Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne » (1503-1508) ; illustration extraite de Wikipidia dans l’article « blé de Turquie ».
Son utilisation a varié dans le temps, d'abord comme fourrage vert puis, par la suite, entrera dans l'alimentation des individus les moins riches.
M. Parmentier 9 écrit que tout terrain est susceptible d’être semé en maïs à condition d’y apporter « des soins & de l’industrie ». Il ajoute néanmoins qu’il se plaît davantage « dans les terres un peu substantielles et grasses ». Sur les sols légers et sablonneux, il est nécessaire d’user d’engrais. Il préconise deux labours afin de préparer la terre «… on doit donner le premier après la récolte, ou pendant l’hiver, & le second vers la fin de Mars ; il y a des cantons dont le sol est si meuble, qu’un seul labour, au moment d’ensemencer, suffit, tandis qu’ailleurs il en faut trois ou quatre ; il convient sur-tout que la herse passe en tout sens, afin de briser les mottes , & que la terre soit divisée jusqu’à deux pouces de profondeur. » Un passage de son étude fait référence au Béarn : «Les plaines situées au bord des rivières, les terres basses qui ont été submergées pendant l’hiver, et où le froment ne saurait réussir, y sont en général très-propres. Enfin, quelque aride que soit le sol du Béarn, il produit toujours, à l’aide de quelque engrais, d’amples récoltes, sur-tout s’il survient à temps des pluies douces et des chaleurs successives, ce qui rend ce grain infiniment précieux et d’une grande utilité par-tout où il peut prospérer» . »
Puis, il se penche sur les engrais, pour lui, tous conviennent à la plante (marne, chaux, limon des étangs, cendres, fumier…). Tout dépend en réalité de la « nature du sol et des ressources locales… ».
Pour ce qui est de la semence, il opte pour le maïs de la récolte précédente et « le laisser adhérent à l’épi… afin que le germe… n’ait pas le tems d’éprouver un degré de sécheresse préjudiciable à son prompt développement. Il faut éviter de prendre les grains de l’extrémité de l’épi…» Puis on doit laisser tremper le maïs dans une eau de fumier légèrement chauffée, ceci un jour avant d’être semé. Ensuite, on attendra que la terre atteigne « un certain degré de chaleur, & de ne faire les semailles que du 15 au 25 d’Avril… afin que cette plante ne germe que lorsque les gelées sont passées, & que les froids de l’automne ne la surprennent pas sur pied avant la maturité. » Il conseille ensuite de laisser entre chaque pied, une distance de dix-huit à vingt pouces au moins… ». Il énumère quatre pratiques et recommande des travaux à effectuer depuis la plantation jusqu’à la récolte afin de fortifier les tiges du maïs. Il est nécessaire, par exemple, de rendre la terre très meuble, d’enlever les mauvaises herbes, « de conserver au pied de la plante de la fraîcheur & de l’affermir contre les secousses des vents… ». Plusieurs binages seront effectués à différents moments. Si les terres sont suffisamment grasses, l’auteur conseille lors du troisième labour de « semer & cultiver par rangées dans les intervalles que laissent entr’eux les pieds du Maïs, des Fèves, des Pois & des Haricots qui grimpent jusqu’au haut des plantes du Maïs, & présentent les avantages d’une double moisson… ». La maturité de la plante est visible de par la couleur qu’elle offre et par « l’écartement des tuniques ou enveloppes de l’épi… ». Puis vient la récolte qui s’effectue par temps sec en séparant l’épi de la tige ce qui se produit « en cassant le pédicule qui l’y attache… ». Ensuite, on les transporte avec ses enveloppes dans des paniers « à la grange ou des angars, pour en faire des différents triages, dont le travail peut être confié à des femmes & à des enfants. » Quant au chaume, s’il est broyé, il peut servir d’engrais. Et, avec les racines, il peut être mis dans les trous à fumier. Lors du manque de fourrage, il est possible de hacher cette tige pour alimenter le bétail. De plus, on peut le substituer à du combustible de chauffage du four.
Quant à l’abbé Rozier 10, ce théoricien loue la plante en tant que « salutaire » pour les habitants des provinces qui la sèment, la considérant comme « un des plus beaux présens que le nouveau monde ait fait à l’ancien » vu qu’elle est appréciée par les animaux de toute espèce. Pour lui, elle « mérite d’être placé au nombre des productions les plus dignes de nos soins & de nos hommages. »
Il prévient que la plante est sujette à des aléas comme la chaleur « continue » sans apport de pluie, car sa croissance risque de languir. Près d’un mois de sécheresse lui est préjudiciable sauf si l’aménagement de canaux a été prévu. Les semailles sont très sensibles à la gelée. Elle peut être touchée lors de sa croissance par la maladie nommée charbon provoquée par un champignon pathogène, Ustilago maydis, provenant lors de blessures, mais les conséquences sont faiblement dommageables. Par contre, un insecte nommé en Béarn « laire », du genre scarabé, peut s’attaquer aux racines, entraînant alors la mort, surtout si le sol est humide. « Le seul moyen de s’en préserver, c’est de travailler la terre aussitôt, & de couper le chemin à cet animal. »
Pour l’auteur, tous les sols conviennent à cette plante : davantage sur des sols légers et sablonneux, mais se contentent aussi de terres fortes et argileuses. S’agissant de notre province, l’auteur écrit : « quelque aride que soit le sol du, Béarn, il produit toujours, à la faveur de quelques engrais, d’amples moissons, sur-tout s’il survient à temps des pluies douces, accompagnées de chaleur. »
En ce qui concerne le labourage, il en préconise au moins deux, l’un après la récolte et l’autre pendant l’hiver ou du moins au début d’avril. Il convient qu’un seul labour peut suffire lorsque la terre est très meuble. Par contre, il arrive que dans d’autres contrées, il est nécessaire d’en réaliser jusqu’à quatre. Tout dépend bien entendu de l’expérience et de l’observation. Suivront ensuite, le hersage et le fumage.
Quant à la semence, l’abbé Rozier conseille de choisir les graines se trouvant au milieu de l’épi, car le maïs y est « le plus beau et le plus nourri ». Elles se seront choisies lors de la dernière récolte. 11
Le même auteur recommande de laisser macérer les graines dans l’eau que douze heures avant de semer.
Puis d’attendre que la terre se soit quelque peu réchauffée avant d’entreprendre les semailles pour éviter aux graines un froid préjudiciable, ce qui explique qu’il suggère qu’elles soient faites courant avril ou au début du mois de mai, notamment pour éviter toute gelée et éviter les baisses de températures lors de l’automne au moment de sa maturité. Les semailles doivent se pratiquer « par rayons, l’un après l’autre, à deux pieds et demi de distance en tout sens, & on recouvre à proportion, au moyen d’une seconde charrue. Ceux qui n’ont pas de charrue le plantent au cordeau, à la distance d’un pied & demi, en faisant avec le plantoit un trou, dans lequel on met un grain, que l’on recouvre de deux ou trois travers de doigt, afin de le garantir de la voracité des animaux destructeurs. »12
Ceci fait, de la plantation à la récolte, selon le même auteur, prône certains labours dans le but de donner aux tiges plus de vigueur et d’abondance. Ils consistent à purger le sol de mauvaises herbes, « à rechauffer la tige pour lui conserver de la fraîcheur, & l’affermir contre les secousses des orages. » Le premier labour aura lieu lorsque le maïs atteindra la hauteur de trois pouces (usage de hoyaux ou petite houe à lame courbe taillée en biseau et de sarcliers), le second à un pied (avec une bêche courbée ou une houe) et le troisième au moment où la graine se forme dans l’épi. Il suggère, à ce stade, de planter des végétaux dans les espaces vides laissés par les pieds comme des haricots, des fèves, des courges qui pourront se développer à leurs ombrages.
Avant la récolte, il rappelle qu’il faut enlever « la portion de la tige qui est à ses extrémités & au-dessous de l’épi… ». Mais il est impératif de le faire lorsque « les filaments sont sortis des étuis de l’épi, qu’ils commencent à sécher & à noircir… ».
Lorsque le grain est dur, la maturité de la plante est visible, surtout par sa couleur et l’écartement des feuilles. S’il a été planté en mai, la récolte est prête au mois de septembre. Par temps sec, les moissonneurs s’attèlent à la tâche, ils arrachent les épis « auxquels ils laissent une partie de l’enveloppe, ils en forment d’espace en espace de petits tas… ». 11Il ne reste alors qu’à les transporter dans la grange à l’aide « voitures garnies ordinairement de toiles … ».
L’abbé Rozier analyse le dépouillement des robes du maïs entreposé dans la grange. On laisse une partie des enveloppes à ce que l’on considère être les plus beaux et les plus mûrs et de les « suspendre au plancher, les autres en sont entièrement dépouillés & mis en tas dans le grenier… On en entrelasse les épis par les feuilles qu’on leur laisse à cet effet, on en forme des paquets de huit à dix, et on les suspend horizontalement avec des perches qui traversent la longueur des greniers et de tous les autres endroits intérieurs et extérieurs du bâtiment. » Ce procédé permet une conservation de plusieurs années, mais il est utilisé seulement pour les graines destinées aux semailles vu la surface importante qu’il exige.
Si on opte pour son étalement dans un grenier bien aéré, on dépouille totalement les enveloppes des épis que l’on répand sur le plancher, à claire voie. Il faut les remuer de temps en temps afin de dégager leur humidité. Cette opération peut s’effectuer tout simplement dehors en profitant du soleil.
L’égrenage, dans les pays chauds, se pratique si possible en automne. Le plus simple est d’utiliser un genre de tombereau soutenu par quatre petits pieds, & percé, dans son intérieur, de trous par où les grains, détachés de leur alvéole, puissent passe… Deux hommes, placés aux extrémités, frappent dessus avec des bâtons, & on repasse les épis à la main, pour en séparer les grains qui peuvent y rester. » Méthode que l’on peut assimiler avec celle pratiquée avec un fléau. 13 Après le passage des différentes opérations que sont l’égrenage et le vannage, le maïs est entreposé au grenier avant d’être vendu au marché ou d’être moulu dans un moulin. Dans le grenier, il est nécessaire selon l’auteur de continuer à s’en occuper pour bien le conserver. Il faut le remuer de temps en temps avec une pelle, le changer de lieu afin de le « rafraîchir ». Mais pour éviter qu’il ne soit attaqué par les insectes, on le mettra dans des sacs que l’on stockera au nord dans un endroit sec.
c- En Béarn, ceux qui déterminent les avantages et les inconvénients du maïs
· Les vertus prêtées à la plante
Pécuniairement, elle revient moins cher que le blé et sa production peut satisfaire les besoins de la population. De plus, elle a la particularité de bien s'adapter au Béarn.
Le cycle de vie du maïs dure 6 mois, le semis a lieu au printemps (avril-mai), durant l’été sa croissance est rapide et sa floraison s’effectue en été (en juillet). Les grains sont récoltés en automne, aux mois d’octobre et de novembre.
Comme l’écrit Marie-Pierrette Foursans-Bourdette le maïs « pousse plus vite que le blé, il rapporte trois plus et il en faut très peu pour ensemencer un champ. De la racine à la graine, tout est consommable et utilisable, le gain est mangé par l’homme et l’animal (volaille, porc), la tige sert de fourrage et de fumier surtout pour les prairies.
Autre qualité, il échappe à la jachère qualifiée de « morte » et de s'introduire dans le cycle blé d'hiver-céréales de printemps entraînant par la même occasion l’utilisation plus importante de la charrue et de la herse au détriment de l’araire.
Un des témoins de l’époque rapporte : « Le bled d’Inde, une de nos grandes ressources, est la nourriture commune des paysans du second ordre et d’une partie des Artisans. On le sème à la fin d’Avril et au commencement de Mai ; il se récolte en Octobre ; presque toujours, il réussit assez pour nous préserver de ces affreuses famines qui nous désoloient avant l’usage de ce grain … ». 14
L’Intendant Lebret lui reconnaît une qualité : «… la récolte du maïs est sûre, le brouillard ni la grêle, à moins qu’elle ne soit extraordinairement grosse ne l’endommagent pas point, les gelées du printemps ne lui nuisent point non plus parce qu’on ne le sème qu’au mois de Mai… » 6
Christian Desplat , lui aussi, insiste sur cette qualité : « Le « milloc » présentait en réalité un seul avantage, mais il était de taille : il était la seule céréale capable de résister aux sautes d’humeur du climat béarnais. » 15
Un autre témoignage datant de juillet 1735 dépeint très bien les effets très négatifs des aléas climatiques subis par le Béarn, il provient du Parlement de Navarre : «… les terres de leur nature sont fort stériles, cette province est affligée et accablée par les grêles fréquentes qui chaque année enlèvent la moitié des fruits dont la totalité ne suffirait pas à nourrir les habitants la moitié de l’année ». 16
Plus loin, l’Intendant rajoute que c’est un « excellent » fumier « …pour les prairies, ainsi que l’expérience l’a fait voir de plusieurs années. »
On donne quelques parties de la plante à manger aux bestiaux comme les feuilles notamment pour l’engraissement des cochons et des oies, mais aussi, on utilise les feuilles de l’épi pour la confection des matelas. Ici, on évoque un des grands travaux des Pyrénéens à la fin de l’année qui consistait à ce que l’on nomme les « desperouquères », pour cela, il était nécessaire d’utiliser tout le monde même les voisins. Ce sujet sera repris lorsqu’on abordera les veillées puisque cette tâche s’effectuait le soir.
Le maïs allait devenir, pour les Béarnais, une arme contre les disettes, bien intégré dans les cycles économiques, sujet de spéculations, toutefois, il s’avèrera qu’il n’a guère pu éviter la disette survenue en 1778 et celle de 1789. Les parlementaires béarnais n’écrivent-ils pas : «… la chose serait difficile à croire pour ceux qui ignorent que le milloc, même prix égal paraît préférable aux paysans, auxquels il fournit une nourriture sinon plus substantielle, du moins plus abondante et cette espèce de gens préfère volontiers une abondance même indigeste à un aliment meilleur mais plus délicat. Dans ces vues d’économie, le froment même ne saurait tenir lieu de cette autre nourriture grossière. ».
Autre point, la plante est riche en hydrates de carbone, mais déficiente en protéines et en acides aminés de qualité. 17 Il est « carencé, au point d’entraîner, à la limite, des affections pellagreuses. » Le même auteur mentionne que cette tare est reconnue dès le XVIIIe siècle, elle se « manifeste par trois symptômes que l’on peut appeler les trois d : démence, dermatose, diarrhée. » Il l’explique par sa carence en vitamine PP (acide nicotinique) et en acide aminé. Cela a des conséquences négatives sur la croissance des jeunes. Il fait remarquer les Américains avaient réussi à s’en prémunir en l’associant avec du haricot, ce qu’ont fait également les Béarnais « empiriquement ». 18
Il rajoute que l’introduction de la plante dans le système cultural béarnais a été bénéfique dans la mise en valeur du sol. Il écrit que « Par sa période de végétation, complémentaire de celle du froment, le maïs évitait la jachère morte et s’insérait naturellement dans le cycle blé d’hiver-céréales de printemps avec, dans une région suffisamment humide, des rendements meilleurs que ceux des millets. » La bonification de l’agro-système résultait encore des cultures associées au maïs et complémentaires de ce dernier : haricots à rames, citrouilles qui ne nuisent guère à la céréale, trèfle ou raves qui se développent après la cueillette des épis. »
Parmentier présente en juin 1785 un Mémoire sur la manière de cultiver et d’employer le maïs comme fourrage. 19 Il constate que dans toutes contrées qui introduisent cette plante et qui en font leur principale nourriture tant pour l’homme que pour les animaux, les hommes consacrent une partie de leurs terres à la culture du maïs en tant que fourrage. Il écrit : « Lorsque le Maïs a été semé en Avril, le même champ peut fournir jusqu’à trois récoltes de ce fourrage, en répétant à chaque fois l’ensemencement ; pourvu cependant qu’il ait eu lieu dans un climat tempéré, assez uniforme & suffisamment humide. » Ce qui est le cas de notre province. Si la plante est semée généralement au mois de mai en vue d’une récolte au mois de septembre, c’est celle qui se pratique à la fin du mois de juillet qui intéresse l’auteur, puisqu'on obtient alors un « fourrage vert dans l’arrière saison. » La terre doit être meuble et avoir « un peu de fonds », tandis que la semence doit correspondre à un maïs « le plus précoce, le plus menu & le plus nouveau » car il « lève plus vite & plus dru qu’aucun autre ». Si un grain de quatre ou cinq ans d’âge est exempt de moisissure il peut aussi bien faire l’affaire. Cette semence doit être baignée dans de l’eau mélangée avec un peu de chaux, ceci durant une journée, ce qui a pour effet d’accélérer sa germination. Après cette opération, on laboure la terre très profondément et on sème à la volée. Il calcule qu’il est nécessaire de : « deux tiers en sus de ce qu’il faut de Maïs quand on veut le récolter en grain. » Ensuite, on utilise la herse par « deux fois & en tous sens. »
En 1786, les Etats de Béarn ont connaissance du mémoire de Parmentier sur le maïs, mais ils le jugent trop théorique et pas assez pratique lors de la délibération du 16 février 1786 et ne le divulguent pas dans les campagnes de la province. 20
· Les inconvénients, ils sont tout aussi nombreux
Le maïs nourrit quantitativement l'homme et l'animal et non point qualitativement. Il est pauvre en protéines. 21 On peut ajouter également que sa consommation croissante provoque la sensation de monotonie.
L'Intendant Lebret mentionne : « La première raison contre le maïs est qu'il use extrêmement la terre et qu'il ne produit point de fumier. » C’est un « assez mauvais fumier pour les terres labourables. »
Le même Intendant continue à reprocher à la plante de faire du pain lourd, qui se digère mal. Parmentier lui-même déplorait cet état de fait. Ayant réceptionné un pain de maïs, renfermé dans sa terrine, il s’exclame : « Quel fut mon étonnement, en voyant au lieu de pain, une masse de pain serrée, grasse et à peine cuite ! C’est alors que mes espérances se ranimèrent, et que je cédai à un sentiment de tristesse, mêlé de consolation, en m’écriant : Quel pain mangent nos compatriotes les Béarnais ! Ils en prépareraient de bien meilleur, et à moindres frais, s’ils renonçaient à leurs terrines étroites et profondes, s’ils faisaient des masses moins considérables, et s’ils achevaient leur cuisson à nu dans le four. Mais combien ce pain acquerrait de qualité, si la farine était toujours parfaitement moulue ! Alors il ne faudrait plus employer d’eau bouillante : le pétrissage, ainsi que la fermentation s’opéreraient plus complètement ; il ne serait plus nécessaire de faire chauffer autant le four. Enfin, la fabrication du pain de Maïs sans mélange, rentrerait dans le procédé général, serait moins embarrassante, et plus certaine. » 19
Le même Intendant signale qu’il ne se conserve qu’un an.
Un autre personnage tenta de mettre à l’index le maïs, il s’agit d’un agronome qui était membre de la Société d’Agriculture de Saint-Gaudens, M. d’Alband. Par le biais d’un mémoire intitulé « Moyens d’entretenir la culture des terres après l’épizootie », outre des conseils donnés au niveau des techniques agricoles (substitution du cheval pour le labourage, usage d’engrais artificiels), il critique la culture du maïs. Selon lui, elle a trop remplacé celle du froment, il la considère trop « vorace d’engrais « et trop lente à mûrir, il opte davantage sur les cultures des blés de printemps. 22
Christian Desplat reconnaît que le maïs « épargna au Béarn les catastrophes alimentaires, mais en même temps, il transforma très tôt une polyculture spéculative en une stricte polyculture de subsistance. De même, il ajoute qu’en « apparence, l’essor du maïs, la viticulture achevaient de donner au Béarn son visage aquitain… ».
Au début du XVIIIe siècle, le maïs s’introduit dans les mercuriales de la province. Son coût est alors inférieur de moitié à celui du blé. Christian Desplat l’explique : « Mais on tiendra compte du fait que le maïs n’était pas panifiable et qu’il n’y avait guère de possibilités d’achat en dehors des pays aturiens. » 23
Mais on constate néanmoins que son prix peut souvent atteindre le même coût que celui du blé, mais aussi devenir plus onéreux lors des périodes de crise.
En analysant la mercuriale des grains à Pau, Christian Desplat constate les faits suivants : « … le maïs au XVIIIe siècle ne jouissait encore que d’une maturité économique relative. La soumission du maïs à la conjoncture du blé, qu’il soit beau ou “médiocre” est certaine. Au début du siècle, le prix du maïs répercute les incertitudes d’un approvisionnement encore très dépendant des marchés aragonais et navarrais. Par la suite, la similitude des courbes paloises avec celles de Toulouse ou de Bayeux souligne le rôle d’un marché national dont le maïs subit les variations alors qu’il n’était encore qu’une production régionale. 23 De plus, il note que : «… à la hausse le prix du froment réagit toujours le premier et il entraîne à sa suite ceux du méteil et du maïs. Mais on doit cependant noter que lors des fluctuations courtes, si le maïs connaissait des hausses un peu plus tardives que le froment, il se maintenait ensuite plus longtemps sur un pied plus élevé. On trouve ici la confirmation de l’importance prise par le maïs dans l’alimentation populaire qui avait fait de lui un objet de spéculation. Les spéculateurs avaient évidemment plus à gagner sur le maïs, consommation de masse, que sur le froment ; dans une économie où les marchés étaient très étroitement surveillés, les autorités cherchaient toujours à prévenir le mécontentement populaire sans avilir les prix des producteurs, il était plus facile de retarder une hausse que de la conjurer une fois qu’elle s’était produite. La coïncidence générale des prix du froment et du maïs, valable pour d’autres céréales, ne doit pas cacher les singularités des fluctuations courtes du blé d’Espagne qui était devenu le “pain des pauvres”. Enfin, il mentionne que : «… l’amplitude des variations saisonnières est plus forte dans le cas du maïs que dans celui du froment. Mais en dehors des périodes de crise, les écarts saisonniers excédaient rarement plus de 10 %... Après 1770, le mouvement saisonnier périodique fut constamment agité de violentes oscillations. Il faut cependant souligner que la corrélation entre la hausse des prix, les crises économiques et les crises de subsistances n’a jamais été parfaite… A la fin du siècle l’importance du maïs était devenue décisive…»
D’autres documents attestent l’importance du maïs dans l’économie domestique. Les actes notariaux sont significatifs à ce sujet, notamment ceux ayant trait aux pensions alimentaires lors des testaments. Sur 800 contrats analysés par Christian Desplat, 10,37 % constituent la proportion des pensions annuelles. Ces dernières sont élevées lors des périodes de fortes hausses des prix et basses lorsque ces derniers sont faibles. Il écrit : « Seulement 4,7 % des pensions étaient exclusivement formées de céréales, dont 50 % d’un seul produit ; mais le maïs apparaît dans 65 % des pensions, le froment dans 57 %, le seigle dans 43 %. Aucun doute n’est permis, avec le cochon, le maïs était devenu le fondement de l’alimentation populaire…». Toujours à partir de cette étude le maïs «… ne venait qu’au second rang pour les quantités composant la ration alimentaire en céréales. Avec 26,6 % il arrivait immédiatement après le froment (30,8 %), mais avant le seigle (22,2 %), le millet (12,6 %) et le méteil (7,6 %). » Il termine en mentionnant : « Le milloc a indiscutablement assuré une alimentation plus régulière ; mais son introduction coïncide avec une réduction de la ration annuelle de céréales qui passe de 279 litres par personne avant 1750 à 217 litres après cette date. »
Un autre moyen de connaître l’impact du maïs dans l’alimentation des Béarnais de l’époque consiste à observer les inventaires des cuisines populaires. Le même auteur écrit : « la prépondérance des “chaudières” évoque le plat unique, le maïs sous forme de bouillie (la broye) ou de péte “la mesture” ».
Le maïs fera l’objet de produit d’exportation aux alentours de l’année 1750 à destination de l’Aragon, de la Galice et du Portugal soit par voie maritime, soit par voie terrestre. En effet, ces régions connaissent à cette époque une crise agricole. L’Intendant d’Aine en donne l’autorisation en 1774. Par exemple, il est possible de vendre à la péninsule Ibérique près de 10 000 quintaux. Cela permet un écoulement régulier des excédents de récolte. Elle précise que c’est l’Intendant qui accélère ou freine ces exportations par les ordonnances qui ‘il prend vu que cela peut provoquer une hausse ou une chute des prix. 24
L’abbé Roubaud nous informe qu’ : « Il y a quelques années que la Galice et le Portugal, en échange de notre bled d’Inde ont versé dans ce pays une immense quantité d’argent. Il fallait voir avec quelle ardeur nos campagnes étoient travaillées ? Quand la cherté est revenue, il y avoit les moyens à payer. Mais les craintes étoient d’autant plus vives que la partie de l’Arragon qui nous avoisine avoit été frustrée de toute récolte par une longue sécheresse. » 14 Il écrit cela en 1774.
On sait qu'on ne défricha que quelques centaines d'hectares au XVIIIème siècle. On pense qu'au début de la seconde moitié du XVIIIème siècle, le maïs s'étend sur près d'un tiers des surfaces. Par contre, sa part dans les mercuriales est en hausse. Il fait l'objet de spéculations. Le maïs, devenu un grand produit alimentaire du peuple, revêt une importance plus grande que le froment, à la base du fameux pain blanc, plus onéreux, donc consommé davantage par les individus aisés. On peut affirmer que la culture du maïs a été bénéfique dans ce sens qu'elle a écarté le spectre de la famine, mais pas celui de la disette comme on le constatera plus loin.
Son exploitation est source d’exportation, on vend les excédents en Aragon, en Galice et même au Portugal. La quantité exportée est telle que souvent l’Intendant est tenu de modérer le débit pour éviter que cela ait une incidence sur les prix.
Le 20 mai 1769, les parlementaires béarnais dressent un mémoire 25 sur le milloc - autre appellation donnée au maïs, laissons-les parler : « la plus grande partie des habitans du ressort et surtout ceux de la province du Béarn se nourisent toute l année de Bled d inde appelé Dans le païs millocq. Les terres de la province en rapportent assés Considérablement et suffisament pour la Consommation des habitans, le froment et les autres menus grains ny Croissent au contraire quen petite quantité... le millocq sert non seulement pour la subsistance des habitans de la campagne, mais pour nourrir la volaille, et... les cochons». Mais son prix, dans les périodes de pénurie, peut atteindre, voire dépasser, celui de la céréale « noble ». En effet, son cours, grâce à l'exportation (en Aragon, au Portugal...) stagne. Cependant en 1788-1789, les désastreuses récoltes dues au mauvais temps vont tout perturber et mécontenter les classes populaires. Ce qui explique que les jurats de Pau tentent, par exemple, afin d'apaiser les esprits de lancer la fabrication d'un pain surnommé « pain des pauvres » constitué d'une part de blé pour deux parts de maïs.
d- Les différents travaux liés à la récolte du maïs
Parmentier nous relate comment on plantait le maïs en Béarn. « On commence par labourer la terre en automne, comme s’il s’agissait d’ensemencer du froment ; on la laisse ainsi labourée jusques à la fin d’avril ou les premiers jours de mai ; alors on la herse pour briser les mottes et la nettoyer. Cette opération faite, on lui donne un second labour avec un instrument de fer différent du soc, en ce qu’il est en forme de pelle. On le nomme arrazere. Cet instrument est précédé du coutre, sur-tout lorsque la terre a pris trop de consistance ; et on emploie pour cela deux attelages. Après ce second labour, on s’occupe à marquer la terre, et l’on se sert à cet effet d’une pièce de bois longue de cinq pieds et trois pouces et demi en carré, dans laquelle on pratique quatre ouvertures, en commençant par les extrémités et à égale distance, afin d’y placer quatre pelles de bois ou de fer. On ajoute à cette pièce une perche ordinaire pour l’atteler ; et pour l’attelage, on a un joug long de cinq pieds. Sur la pièce de bois où se trouvent les pelles, on attache deux tenans pour le laboureur : ensuite on marque la terre sur toute sa longueur, en rayon aussi droits qu’il est possible ; on la remarque ensuite dans toute sa largeur, afin de former des carrés, et c’est dans ces carrés qu’on jette la semence. » 9
Marguerite Rambeau 26 a produit une étude ethnographique sur le village de Lussagnet-lusson dont j’ai reproduit ici plusieurs passages mêlant les travaux agricoles concernant le maïs et les différents noms béarnais qui leur sont donnés. Son analyse ne touche pas le XVIIIe siècle, mais englobe plutôt une période qui le dépasse. Mais elle n’est pas inintéressante à connaître pour ceux qui veulent connaître le monde rural béarnais traditionnel.
L’auteure, en ce qui concerne les champs dans lesquels on cultive le maïs, écrit que ce sont « champs (lus kams) dont la terre est restée en jachère « buzigo », ou en pâturage « pesede » pendant une année ou davantage. Il faut labourer la terre choisie au printemps, en employant le même système de labour en planches que… le blé, pour former la « mantado » et la kürado ». Après le labour, on aplatit les arêtes « las kanteros » de la glèbe avec le rouleau « lu rrullew » - ce travail s’appelle rrullera. Ceux qui n’en ont pas se servent de la lourde « kledo » de bois. « L’arraskle a baws » herse « arrasklo » ensuite cette terre et l’on recommence trois fois « tres kops » en alternant « rrullera a arraskla », dans les deux sens du champ, en long puis en large « en alungan e en trübersan » passe enfin « lu merkade » qui, avec ses trois larges pelles, trace des sillons entrecroisés, pour semer le maïs en carré « aw karrat ».
En ce qui concerne les semailles, elles ont lieu au printemps lors des mois de mai et d’avril. Le sol ne doit pas être trop mouillé, sinon il collera aux sabots des bêtes, si, par contre, il est trop sec, « le grain ne germera pas facilement ; s’il pleut trop après les semailles, le grain pourrit, ou bien la terre durcit et forme une croûte qui empêche le germe de pointer. » De plus, le semeur doit tenir compte des phases de la lune et si possible « mieux choisir une époque de lune descendante car : « A la lue trende, k’ey tut kanaberos » A la nouvelle lune, le maïs monte en tige sans faire d’épi. » Mais il faut savoir, que certaines périodes sont privilégiées parce qu'on ne peut pas tenir compte des évolutions de la lune comme en avril. Le maïs, selon l’auteure, n’est pas semé à la volée, il faut « le déposer méticuleusement à l’intersection des lignes tractées par « lu merkade ». » Pour cette opération, on réquisitionne tous les gens du village, même les enfants sont sollicités, car cette opération ne nécessite aucun grand effort. On se positionne pour l’occasion de front face au champ, tous les individus sont équipés d’un tablier qu’ils mettent devant eux, de telle façon qu’ils prennent la forme d’un sac afin de contenir les grains. Dans leurs poches, ils y ont mis des haricots blancs « mundyetos », à l’occasion des graines de citrouille « küyo ». Comme on l’a vu précédemment, l’auteure mentionne que le haricot sert de tuteur et « à travers les jambes de maïs serpenteront les tiges de citrouilles, considérées comme des plantes trop encombrantes et trop hardies dans les jardins. » Lorsque les sillons se croisent, on « enfonce en terre avec le pouce « lu dit pos » trois grains de maïs, un grain de harricot, de temps en temps un pépin de citrouille. D’un coup de sabot, « d’ü kot d’esklop » on repousse sur les grains de terre fine, sans appuyer « sen de preme », cela s’appelle « arrula ». 27
Pour entretenir le maïs qui « met six jours « à se montrer « lorsqu’il fait beau temps, il est nécessaire de désherber lorsqu’on constate que les pousses mesurent quelques centimètres de hauteur. Trois manières possibles 28, la première appelée « saraskleta », s’effectue avec l’aide de « l’arrasklet » de forme triangulaire que l’on utilise dans les deux sens du terrain, ceci trois fois ou quatre fois tous les quinze jours. Elle consiste à herser. La seconde nommée « hudyika » est pratiquée avec la binette « l’essado » pour « enlever les herbes délaissées par « l’arrasklet ». Enfin, la troisième, la « purga », consiste à arracher à la main les « herbes trop proches des plantes ». Lorsqu’on constate que certains maïs n’ont pas poussé ou que leur germe « a été dévoré par les parasites… » il faut les remplacer. Quand on arrive au mois de juin, le paysan doit « butter « kawsa » le maIs avec « l’arrazerot » dont l’avant arrondi repousse la terre de chaque côté. Vers la Saint-Jean, le maïs atteint une taille suffisante pour l’abri des corbeaux. » Durant l’été, on ramasse les haricots trois ou quatre fois lors des venues au champ. A la mi-août, la plante est parvenue à sa floraison, la « fleur mâle supérieure « la belo » a fécondé la femelle inférieure qu’indique le gonflement de l’épi « lu kabel », d’où sort une mèche soyeuse et tendre de cheveux blonds « lu pew ». Pour réserver au fruit la sève qui alimente cette partie de la fleur devenue désormais inutile, le paysan coupe le haut de la tige ou cime « lu sum », au-dessus de l’épi. » Ces « lu sums » sont utilisés de deux façons, soit « ils servent de fourrage vert pour les porcs, les lapins, les vaches. », soit on les dépose, « rassemblés en poignées liées avec une cime », afin de les laisser se sécher au soleil. Plus tard, on les donnera à manger aux bêtes à cornes. Après l’été, en septembre, au moment où les feuilles de maïs flétrissent, il est temps de les effeuiller pour accélérer la maturation de l’épi en « supprimant l’ombre qu’elles apportent. » L’opération s’effectue en détachant les feuilles d’un « coup sec vers le bas », puis de les lier « par petits paquets avec l’une d’entr’elles et fichées sur le sommet des plants pour finir de sécher. » 28
La récolte 29 a lieu en octobre lorsque les premières gelées font leur apparition. Les ouvriers, munis de paniers nommés « tistets kastanes », « font craquer « peta » l’épi » d’un coup sec, « en le rabattant vers le dos de la main gauche. » L’auteure précise qu’il faut effectuer cette opération à la nouvelle lune car « alors l’épi casse net « estrus » à sa base. » Elle ajoute qu’il est possible de cueillir « l’épi en l’arrachant « essaskla » mais cela présente l’inconvénient d’emporter avec lui toutes les spathes extérieures noircies par les intempéries… ». Elle mentionne que les ouvriers peuvent souffrir de gerçures et se couvrir de crevasses « halasos » avec le froid. Mais ce qui ne les empêchent pas de pousser devant eux « au bout du pied le lourd « tistet » qu’ils vident « bweyton – inf : bweyta » souvent dans les « tistos » ronds et grands paniers d’osier que les plus forts de bande emportent sur leur tête, en la protégeant d’un coussinet en couronne appelé « lu kabido », jusqu’au « bros » où ils transvasent « trehmüdon – inf : trehmüda) leur charge. »
Le dépouillage du maïs 30 : Le maïs est acheminé vers la grange et déversé sur un espace libre, lorsque le tas devient assez conséquent, l’ensemble du village est appelé afin de procéder au dépouillage qui se fera dans la joie, comme une réjouissance nommée « la espelukero ». Il a lieu, comme l’écrit Marguerite Rambeau, le soir, après le dîner. « Les voisins « lus bezis » de près ou de loin, munis d’une pointe en bois de néflier « mesple » ou de buis « bus » attachée au poignet par un cordonnet pour éviter de le perdre : c’est « l’espelukadé ». D’abord à genoux « agülwaets » autour de l’énorme tas de maïs, les invités dépouillent assez de « pelok » pour en faire un siège « syeti » moelleux. Les épis dépouillés sont aussitôt lancés à la volée vers le haut de la pile où ça et là de grands paniers les reçoivent tandis que, de l’autre main, l’on rejette par-dessus l’épaule « lu pelok » qui s’accumule peu à peu et ne sera dégagé que le lendemain. » Les gens, durant ce travail, échangent les nouvelles, on chante aussi. Vers onze heures ou minuit, l’auteure nous relate que le maître de maison invite tout le monde à partager une collation à la cuisine. Elle est composée d’un pain frotté de gousses d’ail « recouvert de graisses d’oie « gres d’awko » » appelé « lu rregatel ». A côté de cela, on ajoute « las kastanos », des châtaignes cuites à l’eau ou rôties, « le tout bien arrosé de vin rouge et blanc. »
L’égrenage 31 suit l’opération du dépouillage, à ce stade Marguerite Rambeau énumère trois procédés. L’un nommé « a la barro » consistant pour l’opérateur, assis sur un escabeau, d’avoir une « latte épaisse horizontale entre les jambes » et de frotter l’épi « de bas en haut en le tournant légèrement… Le grain tombe dans un tamis « ü segune » entre ses pieds ». Le second s’effectue de la façon suivante, deux hommes se font face et lèvent à bout de bras un sac plein aux trois quarts d’épis et « le frappent avec force sur une dalle de schiste « üo labaso ». Enfin, la dernière façon est encore le fait de deux hommes qui battent les épis à l’aide de gourdins dans une « kledo », sorte de claie « formée de lattes épaisses juxtaposées avec des interstices de deux centimètres d’écart…montée sur quatre pieds et bordée à droite et à gauche de deux planches de quarante centimètres de haut environ… Le grain tombe en dessous » D’après l’auteure, ce moyen est le plus rapide mais court le risque de voir les épis se projeter partout.
Quelles sont les utilités du « pelok », de l’enveloppe du maïs ? L’auteure nous cite la réalisation de coussinets « pour protéger des coupantes courroies la tête des vaches attelées au joug », ou le remplacement de la paille de blé dans la nourriture des bêtes à cornes, mais elle précise que dans ce cas-là la valeur du « pelok » est moindre, ce qui explique qu’on en couvre des morceaux de betteraves et qu’on le donne à la main. Puis, on peut aussi en faire des paillasses « lus yas » mais qui déclenchent beaucoup de bruit pour le dormeur.
Utilisation du maïs : Il sert à l’alimentation des animaux de la basse-cour, à l’engraissement des porcs. Dans ce dernier cas, si on leur donne des grains entiers au début (variété de maïs blanc, puisque le « maïs doré colore la viande et le foie des volatiles » -, vers la fin « pour stimuler leur appétit », on le délaye en farine « dans de l’eau de vaisselle « aygo de basero » ou du bouillon préparé à leur intention « serpo » 32
B) La vigne,
La viticulture française a connu des périodes d’essor et de déclin à travers le temps depuis son introduction par les Romains. En hausse aux XII-XIIIe siècles, en déclin aux XIV-XVe siècles, elle connaît un redressement à partir du XVIe siècle. Elle est plus présente près des grandes villes - où la consommation s’accroît - et se transforme de façon importante. On estime que la France, à la veille de la Révolution, possède près de 1,576 000 millions d’hectares de vignes, ce qui fait d’elle le plus grand terroir viticole mondial. Cela lui permet une production d’une trentaine de millions d’hectolitres de vin annuellement.33 Si la production augmente, elle le doit davantage aux petits vignerons. Le vignoble disparaît quasiment au nord du pays du fait d’un lent reflux. Les producteurs se sont aussi tournés de plus en plus vers des vins colorés en délaissant le vin blanc et le vin clairet. Au XVIIIe siècle, on note un effort pour s’orienter vers la qualité. La consommation de vin est en hausse, le nombre de tavernes, de cabarets en témoigne.
A l’époque, dans le Béarn, la vigne est omniprésente. Déjà, à l’époque antique, sous les Romains, elle est accréditée. Une mosaïque dans la villa de Taron, dans le Vic-Bilh (ou Vic Vieux), est bordée par des feuilles de vigne. On pouvait également observer dans la villa de Jurançon - qui a disparu - des feuilles de vigne et des grains de raisin picorés par un oiseau.
Au Moyen-Age, on note que la vigne est répandue dans quatre zones. Le Vic-Bilh comme on vient de l’évoquer - notamment par l’entremise de moines bénédictins de Madiran et de marchands morlanais -, puis autour de Montaner, ensuite sur les coteaux de Monein et, enfin, le long du gave de Pau, entre Lescar et Lacq. Quant aux parcelles, elles ne sont pas importantes et le vin que l’on en retire sert essentiellement à la consommation locale. A l’époque moderne, d’après Pierre Marca « les vins de Jurançon sont d’une bonté exquise qui surpasse les meilleurs de Chalosse et du Bordelais et, par conséquent, de presque toute la France... ».
Léon Godefroy, lors de son voyage en Béarn au milieu du XVIIe siècle, nous a laissé une rapide description : « Il y a force vigne ; icelle cultivée comme en France dont le vin qui en provient est blanc et bon et meur comme il n’est ny fumeux ny malfaisant. Le vignoble de Jurançon est le plus estimé de tous. Son vin est gris et il est d’autant meilleur que plus il y a d’années sur la teste. Je l’ay jugé un peu fumeux. » Les vignes vergers ou hautins produisent un vint verd. En général, le vin y est assez cher. » 34
Si les souverains de Béarn sont propriétaires de vignobles, ceux que l’on trouve dans les régions de Monein et du Vic-Bilh sont détenus par la noblesse et l’Eglise béarnaises.
Jean Loubergé 35 écrit que ce sont les marchands palois, « aiguillonnés par la présence, à la fin du XVe siècle, de la cour des rois de Navarre et de leur administration » qui se sont tournés vers ce vignoble. Le personnage central serait Henri d’Albret qui par l’achat de terres et par le biais d’affièvements de terres en friche en aurait été le grand incitateur. Ces actions entraînent alors le déclassement du vin du Vic-Bilh et la renommée de celui de Jurançon. D’après l’auteur, c’est lui qui a la faveur de la noblesse parlementaire soucieuse de détenir des domaines.
Les Fors de Béarn établissent une sélection vis-à-vis du vin, ils décident de ne pas imposer le vin non sujet au commerce, celui de consommation courante. Par contre, ils taxent le vin destiné au commerce ou qui est importé. Ainsi, on décrète l’interdiction d’importer du vin étranger durant une période qui s’échelonne du 1eroctobre jusqu’au 1ermai.
De nombreux règlements sont décrétés en ce qui concerne la vente du vin.
En 1802, des données statistiques sont données et nous renseignent sur le vignoble béarnais. Bien que l’on puisse douter quelque peu de la véracité des chiffres, ces derniers nous permettraient d’établir une approximation du pourcentage du vignoble par rapport au reste des cultures, soit près de 15 %.
a- Le mode d’exploitation
Tout propriétaire détient une parcelle de terres consacrée à cette culture, exception faite de celles qui se trouvent en montagne. La viticulture occupe de nombreuses catégories sociales depuis les nobles, la bourgeoisie et les journaliers. Deux types de vignerons se détachent, les propriétaires et les métayers. Bien entendu, la part de la vigne dans l’exploitation diverge de quelques escats pour les minoritaires jusqu’à un demi-arpent pour les plus grandes. Elles sont généralement closes.
Christian Desplat 36 analysant l’Aquitaine méridionale et dont les régions du Madiran, du Vic-Bihl et du Jurançon constate que les paysans sont en majorité les principaux propriétaires de viticulture. Pour citer un exemple, dans le Madiranais, les terres sont détenues par ces paysans à 81 % alors que le clergé possède 3,7 % et la noblesse 11,3 %. Ensuite, connaissant des crises en 1693 et 1694, toujours dans le Madiranais, les riches propriétaires augmentent en importance au détriment des petits tandis la proportion des vignobles stagne durant le XVIIIe siècle aux alentours de 15 -16 % ce qui démontre que les superficies ne sont guère de grande envergure.
Les vignerons voient leur nombre augmenter durant le XVIIIe siècle et notamment ceux qui possèdent de petits terroirs vu la part de la demande qui s’avère conséquente. Mais comme on vient de le voir, leur part dans la population totale dépend des zones géographiques béarnaises.
Autour de Saint-Faust, par exemple, d’après les contributions foncières de 1791 analysées par Jean Loubergé, il ressort que le village était composé de « peu d’artisans et presque pas de commerçants ; il avait par contre une forte tradition viticole grâce à la proximité de la cité épiscopale de Lescar et de sa bourgeoisie. » Saint-Faust dénombre 184 propriétaires fonciers, parmi eux 147 représentent la paysannerie. « Il y a 67 « laboureurs » (c’est-à-dire paysans ayant un attelage de labour) et 80 vignerons, tous, laboureurs comme vignerons, étant propriétaires de parcelles de vigne, mais les vignerons payant une contribution foncière moins importante que les laboureurs car ils ont moins de terre. »
Son étude se poursuit dans le Vic-Bilh où il distingue deux villages, Aydie et Portet. Dans le premier, il recense : «… 60 laboureurs, 23 brassiers, 17 manouvriers (ou journaliers), 2 vignerons… », tandis que dans le second, on dénombre «… 21 laboureurs seulement, mais 51 brassiers, 6 vignerons et parmi les artisans 6 tonneliers, chiffre considérable si l’on considère les tonneliers dans les autres villages viticoles où ils ne sont jamais plus de 1 ou 2. »
Enfin, il décrit, parmi d’autres localités dans le sud-ouest, du Béarn la cité de Monein où le même auteur constate que seul le quartier du bourg « compte beaucoup de vignerons, 42 ; partout ailleurs, dans les quartiers ruraux, ils sont en nombre infime, ces quartiers comptant surtout des laboureurs et des journaliers. » Il précise que dans les exemples donnés les propriétaires fonciers « possédant une maison ou une terre » ont été catalogués, par conséquent, il est nécessaire de rajouter « ceux qui ne possèdent rien, et surtout les familles des possédants qui pouvaient… s’employer dans le travail de la terre et particulièrement du vignoble. On peut donc estimer qu’il y avait, à la fin du XVIIIe siècle, une main-d’œuvre excédentaire… situation qui se poursuivra durant le XIXe siècle, en attendant que l’exode rural éclaircisse les rangs. » Ce constat explique la signature de contrats de travail « moins favorables aux travailleurs qu’ils ne l’étaient au début du siècle. »
Dans ses études sur les différents systèmes d’exploitation le même auteur, au XVIIIe siècle, pointe celui du métayage où « le métayer étant logé soit dans la maison du maître quand celui-ci ne réside pas, soit dans une petite maison adjacente. », puis celui des « vigners », embauchés à la journée habitants « soit dans les bourgs, soit à proximité du domaine, dans de petites maisons construites sur un lopin de terre qui leur a été alloué ; ils seront surtout plus nombreux au XIXe siècle. » Il remarque que les contrats deviennent plus contraignants dans le Jurançonnais que dans le Vic-Bilh et l’explique par le fait que « l’emprise de la classe dominante s’y affirme beaucoup plus et que les domaines y valent plus cher. » Ceci que tandis que les contrats de fasende (soit : travail) notés dans les actes notariés se distinguent dans le Vic-Bilh par le fait qu’ils mentionnent la fourniture d’échalas par le propriétaire. Selon Jean Loubergé, cette particularité s’expliquerait par la raréfaction du bois et le remplacement des vignes par les hautins nécessitant « d’échalas plus grands ».35
Christian Desplat note que si le Béarn a augmenté le terroir agricole, ce n’est que par le biais de « conditions techniques et sociales très particulières ». De montrer qu’il y eut très peu d’amateurs parmi les nobles enclins à dynamiser cette filière. Ils auraient pu étendre les plantations sur les coteaux et éviter que le vin des plaines de moins bonne qualité inonde le marché. Il « eût fallu que l’aristocratie réalisât une mainmise massive sur le plat pays et réalisât sa conjonction avec une classe de négociants entreprenants, l’une et l’autre firent défaut. »
La viticulture des plaines, d’après Christian Desplat, a connu son apogée d’abord au Moyen Age, aux XIVe et XVe siècles, puis on a tenté de relancer la production pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Pour lui cela a occasionné une atteinte aux pratiques communautaires. 37
b- La recherche d’un vin de meilleure qualité pour l’exportation et l’effort des Etats de Béarn pour y parvenir
Il n'y a pas de grands crus à l'époque, mais elle constitue un apport très important d'argent avec le bétail, puis, la culture du lin qui s'étend le long des gaves.
M. Doléris tient en grande considération la qualité du vin béarnais puisqu’il les dépeint comme étant « suffisamment alcooliques, d’un bouquet très fin, les vins béarnais avaient le mérite d’être bien équilibrés et, comme les fruits bien mûris, de garder une activité proportionnée au degré alcoolique et au sucre résiduel. Ils conservaient ce fruité, malgré leur vieillissement. » 38
Pour en revenir au vignoble, il est à noter que la part que l'on y consacre en superficie dans le Béarn est peu importante, légèrement plus d'un dixième dans le Vic-Bilh pour citer un exemple. On constate toutefois un intérêt certain pour le vin au XVIIIème siècle, ce qui avantage à la fois l'exploitant aisé désireux d'accroître ses revenus et la moyenne des propriétés consacrées à sa culture.
Sa production augmente du fait de la hausse de la consommation et de bonnes conditions climatiques, surtout à partir des années 1720, ce qui n’avait pas été le cas auparavant. On sait qu’en 1702, par exemple, l’année fut marquée par une sécheresse importante, tandis qu’en 1709, l’hiver se caractérise par un grand froid.
Le témoignage d’un chirurgien palois du nom de Fourticot nous a laissé une description de ce qui advient durant l’hiver de cette année. On peut lire dans son journal : « En l’année 1709 vers le 8 janvier, les froids et les neiges furent si fréquents qu’ils durèrent tout ledit mois de janvier et celui de février jusque à demi-mars, avec des vents et bises qui furent cause que quantité d’arbres se séchèrent, notamment les figuiers et vignes, et par un surcroît , il fit vers le 15 avril une neige si forte que la nuit suivante il fit une gelée qui acheva de perdre toutes les vignes dans tout ce pays de Béarn. » Et, pour ce qui concerne plus particulièrement la vigne, il ajoute : «… il a fallu couper… le peu de bourgeons qui était resté aux vignes si était resté quelques raisins, il fit au mois de septembre des gelées qui empêchèrent les raisins de mûrir, ce qui causa que le vin était si vert qu’à peine pouvait on en boire, et avec tout cela il se vendit à 10 et 12 sols le pot, et la barrique qui s’est vendue jusques à 25 et 30 écus celle de Jurançon, et celle du Vic-Bilh à 20 et jusques à 24 écus. Pour ce qui est des vignes et des hautins, il en a fallu couper en beaucoup d’endroits la moitié des pieds… ».39
Le négoce du vin constitue une des ressources importantes du Béarn et surtout pour certaines zones comme les pays de coteaux caractérisés par un sol difficile à travailler, car trop rocailleux. L’évêque de Lescar, président des Etats de Béarn, ne déclare-t-il pas en 1742 que « les habitants de la province l’avaient reconnu depuis longtemps, la vente de leurs vins par l’étranger était la seule et presque unique ressource pour leur soulagement. » ? 40
Liés à cette augmentation, les vignerons voient leur nombre s’accroître notamment les petits exploitants. Autre changement, avant le XVIIIe les terres consacrées à la vigne se localisent sur les coteaux ou les versants des vallées - exposées au Sud si possible et en dehors des fonds de vallées jugés trop humides et plus frais -, à partir de ce siècle, on constate que la vigne s’installe là où régnaient les céréales, c’est-à-dire sur les plaines et les fonds plats des vallées (Vic-Bih et coteaux de l’Entre-Deux-Gaves, entre les localités de Jurançon et de Monein, régions caillouteuses et ensoleillées). Ce qui a déclenché des problèmes, c’est le fait que les premiers à planter des vignes ce sont les nobles, moins astreints aux contraintes de culture, alors que sur ces parcelles les bêtes paissent sur des terres considérées comme « vaines ».
En effet, une des transformations opérées au XVIIIe siècle selon Jean Loubergé est « l’apparition des vignes dans les plaines alors que jusque-là les parcelles de vignes ne se trouvaient guère que dans les terroirs plats des vallées, grandes ou petites, étaient réservées à la culture des céréales… ».
En ce qui concerne la qualité du vin, ce dernier, pendant longtemps, ne pouvait guère se conserver longtemps et devenir forcément du vinaigre au bout d’une année approximativement. Le vin de consommation courante appelé le « picquepouct » était produit de façon intensive et, pour le conserver, on usait du soufre.
On réussit toutefois à obtenir un vin constant au goût. Mais sa qualité fut sujette à des critiques sur deux types de vin, le premier que l’on qualifierait actuellement de consommation courante et celui que l’on exportait dans les pays du Nord de l’Europe comme La Hollande, la Belgique… Les raisons sont nombreuses, l’une résulte d’une pratique opérée par les vignerons consistant à planter un cep de vigne et de le lier à un arbre notamment des cerisiers ou supporté par des échalas ou « paxe » (surnommée la culture en hautin ou hautain) ce qui a pour effet d’obtenir du raisin qui murit sous les feuilles desdits arbres donc trop à l’ombre et d’avoir des ceps trop grands ce qui a des effets négatifs (afin d’éviter également les premières gelées de la fin de l’automne, à cet effet, on utilise également des pieux d’arbre comme le châtaigner de 2 m de hauteur), une autre proviendrait des petits vignerons qui n’entretiendraient pas suffisamment leur vigne. Ceux qui furent enclins à dénoncer cette diminution de la qualité furent les Etats de Béarn, car ils étaient intéressés par cette manne financière que la vigne représentait pour le Béarn.
En 1725, par exemple, un cas démontre le problème posé par la production du vin des plaines.
Si l’abbé Roubaud incrimine la prolifération des hautins coupables selon lui de la baisse de la qualité du vin, ce serait en réalité, selon Jean Loubergé, les plantations de vignes en plaine. En effet, vu que la consommation de vin s’accroît par la prolifération des cabarets et des tavernes à partir de la fin du XVIIe siècle, de nombreux individus remplacèrent la culture de grains par celle de la vigne plus lucrative alors que des édits à l’encontre de cette pratique se multipliaient à partir de 1728. Une autre explication s’ajoute et qui est donnée notamment lors d’une délibération des Etats de Béarn le 11 mai 1753 : « Dans les coteaux la dureté des terrains, la pente et la qualité de la plupart des vignes, qui sont basses et échalassées, obligent à faire les travaux à bras et on y revient jusqu’à trois fois. Le coût de cette culture excède infiniment celui des vignes hautes situées dans les plaines, qui se fait avec le bétail, et à l’égard desquelles on épargne les échalas parce qu’elles sont appuyées sur des arbres. » 41
Le rendement de ce vin de moindre qualité va entraîner l’intervention des Etats de Béarn soucieux de maintenir une bonne qualité. Ils fustigent ces viticulteurs qui plantent en hautier dans les plaines. L’origine provient d’une réclamation exercée par des particuliers envers un propriétaire se rendant coupable d’avoir planté en hautier après avoir clôturé le terrain interdisant ainsi tout pacage.
Ils convainquent le Parlement de Navarre de prendre un arrêt à leur encontre, ce qui sera fait le 5 avril 1727. Les fautifs « dans les plaines, landes et artigues, propres à porter du grain du foin et sujettes au pacage commun à fruit cueilli... » sont priés d’arracher les ceps incriminés. Cette affaire fait grand bruit dans le royaume puisque le Conseil royal s’en saisit et étend l’interdiction le 5 juin 1731 dans tout le pays.
Mais en Béarn, l’arrêt eut peu d’effet, car on constata que très peu de plants furent détruits malgré l’insistance des Etats de Béarn lors des périodes de mévente.
Mais ce ne furent les seuls motifs de contrariété pour les Etats, l’autre cas épineux consistait pour des viticulteurs ou des négociants en vins de contrefaire la qualité en obtenant du « moût ». Cela consistait à obtenir du raisin non fermenté soit par pressurage, soit par foulage, ceci permettant une fermentation alcoolique. De plus, ils ajoutaient du soufre. D’autres mélangeaient le vin béarnais à d’autres vins notamment de Bigorre... La vente au détail s’avérait en partie responsable de ce problème.
Une lettre des Etats de Béarn adressée au ministre des Affaires étrangères, M. de Saint-Contest, datée de 1753 illustre bien le souci des institutions béarnaises de réagir mais qui incrimine les petits vignerons : « le vin des vignerons partiaires ou petits fonciers, souvent peu attentifs à soigner leurs vignes et mélangeant leur vin avec du vin provenant des treilles et hautins, est inférieur à celui des gros fonciers qui donnent le plus d’attention à perfectionner leur vin » 41 N’oublions pas que les membres de ces Etats de Béarn sont des notables, particulièrement des nobles.
Christian Desplat pointe le délicat problème de la « querelle entre grands propriétaires et petits viticulteurs ». Il précise que durant la période comprise entre 1720 et 1740, des arrêts du Parlement de Navarre condamnent des communautés coupables d’avoir taxé le prix du vin, entraînant l’uniformisation du « prix en ne distinguant pas les qualités ». 42
Ces fraudes étaient facilitées par le fait que les Béarnais commercialisaient peu leur production. De plus, se posait un autre problème, celui touchant la contrefaçon du contenant.
Les courtiers sont aussi les responsables de la mauvaise qualité du vin. Cherchant à gagner de l’argent en le vendant dans les villes, ils arpentaient le monde rural à sa recherche et en l’achetant à un moindre coût.
Tout ce trafic d’ailleurs rendait douteux le rendement lucratif de ce négoce par la voie d’eau vu les dangers encourus : les dangers de la navigation, le nombre important des intermédiaires... En effet, ces derniers eurent tendance à se multiplier alors qu’auparavant les Hollandais venaient par eux-mêmes visiter les vignobles et faisaient affaire avec les viticulteurs.
Ce dit négoce connaissait des fluctuations causées par le contexte économique et commercial avec l’Europe, notamment avec l’Espagne. Par exemple, au moment de la guerre de Succession d’Espagne de 1701 à 1714 l’Intendant de la province Lebret écrit : « Lorsque la guerre a interrompu ce commerce, on a bien reconnu qu’il était le seul qu’il fît venir de l’argent ou, pour mieux qu’il conservât celui qu’il y était ; les lettres de change que les marchands hollandais laissaient en Béarn en paiement du vin qu’ils chargeaient à Bayonne, servaient facilement à faire les remises d’argent qu’on n’a pu faire depuis la cessation de ce commerce qu’en voiturant à Paris, les espèces, à Bordeaux et ailleurs, ce qui a épuisé ce petit pays. » 6
Un courtier de Bayonne nommé Moracin écrit en 1747 à un viticulteur du Vic-Bilh, M. de Ger d’Angosse, baron de Corbères : « le commerce des vins avec l’étranger est un billet de loterie. » 43
Le commerce du vin est une préoccupation des Etats de Béarn qui multiplient les règlements comme on l’a vu.
Ils sont tentés par l’application d’une politique protectionniste. En 1667, ils interdisent l’entrée dans la province de vins en provenance de l’étranger, ceci du 1eoctobre au 1ermai. En 1745, c’est au tour des régions voisines d’être pénalisées, en même temps les Etats mettent en place un privilège en faveur de la vente exclusive des productions vinicoles locales.
Ce qui prouve également leur souci de commercialiser le vin est la création constante d’une commission des vins lors de leurs tenues. Le 20 mai 1739, ils se penchent sur le cas des futailles et décident que « la barrique doit contenir 100 pots de Morlaàs. Elle doit être de forme ronde, de grosseur proportionnée, sans être rehaussée à l’endroit de la bonde, ni enfoncée à l’endroit opposé, ni aplanie sur les côtés, les contrevenants seront punis selon la gravité des cas. » Cette implication des Etats s’explique par le fait que plusieurs des membres de l’assemblée étaient des propriétaires de vignes. D’ailleurs, ils s’arrangeaient à faire coïncider la période des vendanges à celle des vacances des Etats.
Soucieux de faire rentrer des revenus frais en Béarn, les Etats de Béarn décident donc de procéder à une « politique de qualité au bénéfice des grands producteurs du Vic-Bilh (Madiran) et du Jurançonnais. », pour y parvenir il faut faire disparaître « les petits vignerons des plaines et leurs mauvais vins par une politique répressive et monopolistique... ».
Ils s’adressent en 1740 à l’Intendant Jean-Nicolas Mégret de Sérillyafin qu’il fasse pression aux jurats des différentes communes viticoles des plaines de jeter bas les clôtures et les pieds de vigne dressés depuis l’année 1718. Mais leur tentative se heurte à l’inertie desdits jurats qui craignent l’hostilité des propriétaires les plus importants et les arguments des principaux intéressés prétextant faussement que leurs vignes, leurs hautins et leurs clôtures dataient de bien avant cette date.
Persistant à chercher un appui auprès des hautes autorités, les Etats de Béarn s’adressèrent, comme cela a été écrit plus haut, au ministre des Affaires étrangères en 1753, M. de Saint-Contest. Dans leur lettre, ils tentaient de démontrer que la qualité de leur vin était bien supérieure à celle des régions avoisinantes, la Chalosse et le Tursan. 41
Pensant que ce dernier, ancien Intendant d’Auch, serait à même de les aider lors des ventes du vin de la province à l’étranger, ils constatent qu’il n'en est rien.
Même souci de leur part, en 1776, les Etats de Béarn poussent le Parlement de Navarre d’arrêter, le 30 septembre, l’interdiction de la vente et des mélanges de vin étranger sous peine d’amendes et de confiscation. 44 Face à cet arrêt, peu d’individus ne protestèrent guère au nom de la liberté du commerce.
Les Etats s’enquièrent alors « de nouveaux débouchés », ce qu’ils réussirent à faire en Europe du Nord. Les communautés s’y opposèrent jusqu’en 1740, mais lorsque survinrent « des crises de surproduction en pénuries » et la concurrence des « vins de Bigorre, elles se résignèrent ensuite à l’arrachage. » A cette dite concurrence du vin en provenance de Bigorre s’adjoignait celle de la Chalosse que l’on qualifiait les deux de « mesclagne ». 45
Les Etats de Béarn, soucieux, comme nous l’avons constaté, de faire la promotion du vin de la province, cherchèrent à toucher le marché de la Baltique vu que la compétition des négociants bordelais et bayonnais s’exerçait sur les marchés des Provinces-Unies et du Royaume-Uni. Ceci d’autant plus qu’il s’avérait que le vin béarnais n’avait plus en Hollande la réputation d’autrefois. Cela incombait à la contrefaçon exercée par les intermédiaires et des Hollandais qui leur vendaient « des vins ordinaires de Bayonne », c’est-à-dire mélangés avec du vin de Chalosse, du piquepoul. 46 D’autre part, depuis le milieu du XVIIe siècle, les élites européennes disposaient d’un large éventail de nouvelles boissons, délaissant les clairets pour consommer des boissons « exotiques » par exemple le curaçao, le chocolat, le porto…
On tente de trouver de nouveaux débouchés sur la Baltique. C’est le viticulteur de Saint-Faust et agronome qui est choisi comme commissionnaire des Etats de Béarn. Tonon s’embarque pour Hambourg sur le navire hollandais « L’Amitié de Hambourg ». Il emmène avec lui seize barriques de vin blanc et trente barriques de vin rouge, le point commun étant qu’ils provenaient de la dernière récolte Un tiers provenait du Vic-Bilh et le reste du Jurançon. Il réussit à faire apprécier ledit vin. A côté de ces barriques, il adjoignait six autres barriques de vin vieux, répartis comme suit, la moitié blanc et l’autre rouge.
A Hambourg, il constate que la ville s’approvisionne à Bayonne que pour seulement 1/8e de sa consommation, il apprend également que le vin béarnais ne représente qu’un quart des barriques exportées de la ville basque. Le restant est composé de vins des régions alentour c’est-à-dire de la Bigorre, de la Chalosse et d’Armagnac. Ce qui intéressait les négociants de Hambourg était de vendre du vin de grande consommation, d’où la pratique du mélange. Pour ce qui était du vin de qualité, celui de Bordeaux suffisait. 47 Apprenant qu’à Stralsund, ville suédoise à l’époque, mais actuellement située dans la région du Mecklembourg-Poméranie Occidentale dans le Nord de l’Allemagne, il y a une opportunité à saisir, il y va. Il constate que le port de la ville est situé favorablement et que les droits d’entrée perçus sont peu élevés. Le vin est une boisson chère et explique qu’il est peu consommé, d’autant plus que les négociants allemands qui les leur fournissent leur vendent du vin de médiocre qualité. Avec des négociants suédois, il projette de créer une association entre deux compagnies, l’une formée dans la ville même et une autre à Pau par les Etats de Béarn. 48 A son retour, le 4 février 1780, il fait son rapport, mais les Etats de Béarn, inquiets, prennent peur de cette formation d’une entreprise « multinationale » et ne s’engagent pas plus loin. Par contre, ils le gratifient d’une rémunération lors du vote du 4 février 1780 49 et le poussent à créer une compagnie privée pour son compte.
Ce qu’il entreprend puisque la « Compagnie Patriotique pour le commerce des vins du Béarn » naît avec un capital s’élevant à 100 000 livres et ayant son siège à Pau. Il traite sans intermédiaires avec les négociants suédois. Le gouverneur de Gramont en sera l’un des plus importants souscripteurs, ce qui encouragea d’autres personnes.
Mais les « troubles politiques » (la guerre avec l’Angleterre, la Révolution), la mauvaise gestion de Tonon, ses spéculations risquées, les récoltes excédentaires qui suivirent mettent fin à l’affaire, n’enrichissant guère personne. L’assemblée générale des actionnaires, le 22 janvier 1783, décréta la liquidation.
Le seul avantage procuré est le débouché ouvert vers l’Europe du Nord pour le vin béarnais.
Les Etats de Béarn tentent de réagir et cherchent à solliciter l’appui d’hommes influents tels des ministres. A travers les archives, on note en 1786 l’acquisition de 3 500 bouteilles de vin du Béarn à destination du Contrôleur général des finances Calonne, du Ministre des Affaires étrangères Vergennes… ceci pour un montant s’élevant à 1 362 livres 6 sols. 50 Nous sommes alors à l’époque de la signature du traité de commerce Eden-Rayneval signé avec l’Angleterre rétablissant la liberté de négoce entre les deux Etats.
Mais la vente du vin connaît beaucoup de difficultés expliquant les demandes d’exonération des charges lors des cahiers de doléances de 1789 de plusieurs communautés du Vic-Bilh. Déjà, auparavant, plusieurs paroisses de cette contrée béarnaise avaient sollicité auprès des Etats de Béarn d’adresser une requête au Parlement de Navarre lui adjoignant de procéder au retrait de l’arrêt de 1776 qui enfreignait la liberté de commerce, ce qui fut fait le 27 octobre 1788.
Sous la Révolution, la viticulture béarnaise ne connaît pas d’essor et les événements se déroulant durant cette période n’ont aucun impact sur elle.
Christian Desplat 51 écrit que « si par la règlementation et les encouragements, les Etats avaient sauvé le vignoble des grands propriétaires, ils n’avaient pu remédier à la nullité du négoce local et à l’inertie de la masse des vignerons. En 1789, les Béarnais n’avaient toujours aucun grand cru à proposer sur les marchés internationaux ; l’appellation « Jurançon » n’était qu’un terme générique... ». Ce vin étant plus connu à l’étranger, son nom était utilisé pour tous les vins béarnais vendus.
En 1786, les Etats constataient la stagnation « presque absolue du commerce de nos vins » et les petits vignerons du Madiranais... » et n’hésitaient pas à clamer leur déception alors que les années 1785 et 1786 représentent dans la production béarnaise des années de récoltes excédentaires.
Le vignoble devait connaître une croissance indéniable sous la Révolution et le Premier Empire. La surface des terres consacrées à la viticulture va passer, en effet, de 18 525 ha en 1788 à 23 175 ha en 1828, ce qui représente une augmentation de 4 650 ha.
Quel est le constat ? On peut déplorer le problème du transport insuffisant (manque de rivière), un coût de production qui se ressentait justement des transports « lents et chers », un « négoce local « manquant « de dynamisme et de capitaux », la trop grande inégalité avec les vins bordelais.52
Jean Loubergé loue l’action de personnages comme le baron de Corbères, de Péborde de Pardies et de Tonon mais reproche à la société béarnaise de l’époque de ne pas les avoir totalement soutenus. Il cherche des causes et pointe le souci dominant des individus « d’occuper une fonction parlementaire ou administrative, assortie d’un bon domaine foncier avec si possible un titre de noblesse (toutes choses qui s’achetaient) et de vivre bien tranquillement sur cet acquit. » En comparant les deux viticultures que sont celles du Béarn et de Bordeaux, il écrit que la première a manqué d’un « négoce puissant et organisé » et il dénonce les exportateurs bayonnais, malheureusement incontournables, qui sont en partie responsables de la baisse du « renom des vins béarnais sur les marchés étrangers ». 53
Analysons particulièrement le Vic-Bilh 54 pour illustrer cette analyse. Pour connaître l’histoire du vignoble de cette région, les historiens sont contraints de se contenter de documents datant du Moyen Age, du XIe siècle pour être plus précis. Ce sont des Bénédictins en provenance de Bourgogne qui introduisent des plants de « pinot ». Lorsque la ville de Morlaàs est choisie comme capitale de la vicomté, les nobles et les bourgeois se tournent vers ce vignoble pour acheter et consommer le vin. Aux XIIe et XIIIe siècles, il est même exporté en Angleterre et dans les pays de l’Europe du Nord. Ce débouché devient une source de revenus substantiels pour cette région souffrant d’une insuffisance de ses cultures vivrières aux XVIe et XVIIe siècles. Le paradoxe résultait de la vente d’un vin de qualité et de l’achat d’un vin de consommation courante de piètre qualité en provenance notamment de la Bigorre.
Le vin récolté était estampillé d’une marque, une partie était consommée sur place, une autre envoyée à Paris et une autre, enfin, transportée jusqu’à Saint-Sever par des bouviers, de là des bateliers les chargés d’abord dans des petits bateaux jusqu’à Mugron, port de l’Adour en Chalosse, déchargés puis rechargés dans d’autres plus grands jusqu’à Bayonne. A partir de la ville basquaise, des courtiers s’occupaient de la vente et du transport avec des négociants anglais ou allemands.54
b- Comment les vignes étaient-elles travaillées ?
Il faut rappeler qu’à l’origine, la vigne est une liane qui s’élève le long des arbres, le plus souvent fruitiers, à des dizaines de mètres de haut. Les raisins étaient petits et acides ce qui les rendait impropres à la consommation comme vin. Ce qui n’empêche pas qu’on les cueille durant la période du Néolithique inférieur ce qui correspond entre - 500 000 ans et - 120 000 ans. Ce sont les hommes du Néolithique qui, en tant que boisson, s’en serviront dans leurs pratiques religieuses et funéraires.
En Béarn, on plante la bouture de vigne près d’un arbre fruitier, en occurrence un pommier ou un cerisier. Ce procédé perdurera aux alentours d’Oloron durant longtemps puisqu’on le retrouvera jusqu’à l’ère contemporaine.
Autre procédé, l’usage de grands hautins que connaissaient les Grecs sous l’Antiquité est quelque peu modifié vu qu’il s’agit d’utiliser des échalas de 3 ou 5 m de haut et de palisser la vigne à environ 2 m du sol. L’écartement moyen des rangs s’échelonnait entre une largeur allant de 80 cm à 3 m selon les zones sur lesquelles on pouvait pratiquer des cultures.
Jean Loubergé 33, lui, mentionne qu’il existe à l’époque trois façons de cultiver la vigne : « soit en taille basse, les ceps ne dépassant pas 50 cm de haut, soit en taille haute, avec des échalas très longs, ou bien en treille, soit en associant les ceps à des arbres et en laissant les sarments grimper le long des branches, façon couramment usitée en Italie parfois dans le Midi méditerranéen français. »
Il ajoute qu’au début, c’est la première manière qui était privilégiée, celle en taille basse, mais qui fut peu à peu délaissée par la faute, entre autres motifs, des dégâts opérés par les chiens, suscitant de la part des communautés des règlements coercitifs. Il constate que les hautins sont plus fréquents dans les appellations à partir du milieu du XVIIe siècle.
Un Bordelais, lors de son voyage en Béarn, en juin-juillet 1765, écrit qu’en sortant de Pau en direction de Bétharram il a été attiré par la vue de « choses nouvelles ». Ces dernières correspondent à « l’ordre et la figure des vignes de ce pays…Ces vignes qu’on nomme hautains, sont plantées au pied et en même temps que de jeunes cerisiers, qui, à mesure que ceux-ci croissent, s’élèvent sur leurs têtes. Ces cerisiers n’ont pas au-delà de cinq à six pieds de tige, et on ne laisse jamais monter avec leurs branches au dessus de dix à douze pieds. Ces arbres sont plantés au cordeau en quinconce. Les pampres des vignes qu’ils soutiennent, conduits de l’un à l’autre, forment une espèce de treille, dont l’ombrage n’empêche pas le froment, le lin, les pois et autres légumes qu’on sème par-dessous d’y croître parfaitement. Les labours qu’on donne à ces semences sont presque les seules façons qu’on donne à ces sortes de vigne, qui dit-on, produisent abondamment. Ainsi sont plantées toutes les vignes du Béarn, de la Chalosse et de la Bigorre, dont le vin, soit que cela procède du terrain, de l’espèce du plant ou de la manière d’en faire la culture, est d’une qualité généralement très inférieure à celle des vins de Bordeaux. » 55
Jean Loubergé fait référence également à l’utilisation d’érables comme tuteurs dans le Jurançonnais. Il explique que l’usage de cerisiers et d’érables présente l’avantage d’avoir un feuillage « pas très touffu, ce qui ne nuisait donc pas à la maturité uniforme des raisins ; peut-être aussi parce que ce ne sont pas des arbres exigeants, enlevant à la terre beaucoup d’éléments nutritifs, ce qui permettait aux ceps de ne pas trop souffrir de la concurrence. »
Le même auteur ajoute que durant le XVIIIe siècle les vignerons (bigneroun, bigné) béarnais employèrent de plus en plus les hautins, notamment dans le Jurançonnais, par contre, dans le Vic-Bilh les vignes « dominent dans la plupart des localités, sauf à Aurions-Idernes. »
Les vignes « réclamaient un travail intense ». Le terrain est défoncé et aéré à la charrue, à la pioche ou la houe au mois de mars généralement. Cette dernière est une lame de 30 centimètres de long sur 20 de large arrimée à un manche. En ce qui concerne le travail à la pioche : « (fosse, d’où l’expression obres de fosse pour la viticulture) on chaussait l’hiver le pied du cep (toujours contre la gelée) et le déchaussait au printemps. » Le quadrillage des échalas (« paüs » ou « pachets ») est effectué selon les lieux soit à la bêche, soit avec un bâton à fouir (appelé « chanque ») équipé d’un repose-pied pour la réalisation des trous. « Retenues par des nœuds d’osier, les lianes étaient taillées (talhar), les feuilles et les grappes débarrassées plusieurs fois de la vermine (espedollhar) ; le provignage assurait le renouvellement des ceps. Il est nécessaire d’effeuiller les pampres afin de permettre au soleil et à l’air de dispenser leurs bienfaits.
Généralement, le vigneron binait au printemps et en été avant les vendanges.
Jean Poueigh écrit que la taille s’effectue à l’aide de deux outils, la serpe ( poudaidouro) ou les ciseaux. D’après lui, elle est la « tâche la plus importante et la plus délicate ; selon le cas, il lui faut laisser à la vigne un pou plusieurs nœuds (douna li longo). 56
La vendange débutait plus tôt que maintenant, début septembre, car toutes les redevances en vin étaient versées pour la Saint-Michel (29 septembre). 57
Dans le tableau Annuel Historique du Béarn, Année 1786, on note : «... l'automne seule est communément belle et semble faite tout exprès pour ces raisins délicieux d'où découlent le Jurançon, le Gan, le Vicbilh, le Monein, tous ces vins, les uns délicieux, les autres robustes, auxquels il ne manque que d'être encore plus fidèlement connus pour aller... nous subjuguer en quelque sorte l'Univers. ».
Les tâches se déroulaient par étapes.
En premier, les coupeurs (« brignayres ») posent les grappes dans des paniers en bois nommés « semaü » puis dans une cuve (« cubet »).
Jean Poueigh mentionne que dans cette catégorie de travailleurs les « femmes jeunes et vieilles » dominent tandis que les « garçonnets et les hommes âgés, sont munis du coutél poudalou, couteau recourbé pour couper les raisins, ou de la piquèto, toute petite serpe servant uniquement à cet usage, et du panié vendémiadou, panier qui les recevra. »
En second, le même auteur écrit que le porteur, un homme généralement (« gourbetaire »), peut porter sur son dos la hotte à bretelles (brèto, gourbèto, gourbilho), puis « du panier les grappes passent dans la hotte et sont versées ensuite dans la comporte (semal…), vaisseau de bois cerclé, dont deux dépassants de bois - espèce de tiges placées à l’opposite l’une de l’autre - formant les anses ou poignées. » Deux hommes viennent alors la prendre soit à l’aide des mains, soit en utilisant deux bâtons passés sous une anse.
Dans le premier cas, un porteur vient récupérer le raisin de ladite cuve qu’il met sur sa tête, leur poids pouvant atteindre près de 30 kg.
Dans les deux cas, on amène les grappes au pressoir en usant des chariots ou des traineaux, pas de caves, mais des chais servant le dépôt et le travail du raisin. Là, il sera foulé avec les pieds nus. « Les fouleurs se mettent alors à troulha la vendange… » 58 Le jus obtenu est versé dans des futailles.
Si on utilise un pressoir, l’instrument employé est « monté sur trois roues, avec vis en bois, lou destré ou trelh, au moyen duquel se fait le destrégnage. Lorsqu’il y a lieu d’égrapper les raisins, on se sert d’un outil disposé à cet effet et également en bois, le degaspadou ou escarpadou. »
Ces différentes tâches 53étaient entrecoupées de moments de repos « pris aux heures du déjeuner et du goûter (brespalh).
« Différentes manières de lier la vigne à l’échalat »
Tiré de l’Encyclopédie de Diderot, tome 1 Agriculture.
Le travail s’effectuait essentiellement à la main. L’érosion, la pente entraînaient invariablement la terre arable dans le bas du vignoble, contraignant les viticulteurs à la remonter par différents procédés, soit en usant d’une grande pelle nommée « ravale », soit de paniers ou encore de traineaux. Après la taille, le viticulteur doit veiller à remplacer les échalas détériorés.
Si au début de l’époque moderne, le vin correspond à un clairet que les négociants tentent de vendre le plus rapidement possible, car il ne peut que se conserver qu’une année généralement, on prend l’habitude d’ajouter des épices et de l’alcool pour augmenter sa préservation. A partir du XVIIIe siècle, des pratiques permettent de le conserver plus longtemps. On use des barriques de meilleure qualité et de la technique dite de la « mèche soufrée » afin de les désinfecter. En effet, on brûle dans un tonneau vide une mèche soufrée pour éliminer les bactéries. Cette technique est avérée en Médoc vers le milieu du XVIIIe siècle. De plus, on utilise le collage au blanc d’œuf ou de la colle de poisson pour la clarification et le fouettage avec un fouet en crin des blancs d’œufs pour les mélanger au vin. La pratique du « collage aux blancs d’œufs » - le vigneron utilise une écuelle de bois pour battre en neige douze à dix-huit blancs d’œufs - permet d’expédier les impuretés au fond de la barrique. On fabrique des bouteilles en verre plus résistantes notamment à fonds épais que l’on ferme par des bouchons de liège plus hermétiques remplaçant les chevilles de bois entourées d’étoupes.
Si la qualité du vin dans son ensemble s’est amoindrie, il faut nuancer et écrire qu’il existait du vin de qualité supérieure, bien entretenu par des vignerons soucieux d’améliorer le goût. L’Intendant Lebret écrit que le vin béarnais avait la particularité de bien supporter le transport par mer (déjà au Moyen-Age, sous occupation anglaise, il était apprécié pour cette qualité).
Il ne faut pas oublier, vu le climat qui sévit dans la province, les aléas fort nombreux et qui avaient une incidence sur la récolte. Le brouillard, la gelée, l’orage accompagné de grêle autant d’éléments naturels qui compromettent la récolte.
L’exemple le plus probant est celui où la grêle s’abat l’après-midi du 24 juin 1778 en Béarn, dix communautés perdent alors leur récolte. Celle de Gardin dresse les conséquences survenues : « Plusieurs de ceux qui pouvaient cultiver, même des chefs de famille prirent le parti d’abandonner leurs champs ; des pères de famille livrent leurs femmes, leurs enfants à la providence. Les métayers menacent d’abandonner les métairies. Cela fait faire de sérieuses réflexions à ceux qui en sont capables. » On peut également citer l’exemple tiré du Livre de raison de l’avocat Mourot. Nous sommes le 12 août 1770 : «… vers les deux heures de l’après-midi, jour de dimanche, il est tombé à Gère et dans le voisinage, une grêle prodigieuse, il en restoit encore le lendemain matin à dix heures, plus grosse que les œufs de pigeon. Le vignoble d’Asson a été abimé, celuy de Nay l’a été moins… ».59
Cela plus la concurrence du vin provenant de Bigorre sont autant de soucis pour l’exploitant au XVIIIe qui survit souvent grâce à la pratique de la polyculture. En ce qui concerne la rivalité entre les deux provinces, il faut savoir que les Bigourdans reprochent aux Béarnais d’interdire l’entrée aux vins des zones limitrophes surtout depuis le règlement de 1667 et la concentration de l’économie viticole dans les mains de quelques producteurs importants ceci afin d’établir des prix élevés. Les Béarnais objectent que la viticulture permet de compenser le peu de grains récoltés sur les coteaux qu’ils jugent stériles, qu’ils ont dû opérer à des défrichements importants ce qui explique que le Béarn soit quasiment couvert de vignes et que contrairement aux accusations portées par les Bigourdans cette extension a entrainé une baisse du prix au moment des récoltes abondantes. S’il s’avère que parfois il augmente, les causes proviennent de la faiblesse des rendements, les dépenses occasionnées par la main-d’œuvre et les travaux pratiqués sur les pentes.
Notes :
1-Bergeret, J, Flore des Basses-Pyrénées, extrait du discours
préliminaire, tome 1er, Pau, Imprimerie de P. Véronèse, an XI de la
République.
2- Archives municipales de Bayonne.
3-Voyages de Léon Godefroy en Gascogne, Bigorre et Béarn, 1644-1646
/ publ. et annotés par Louis Batcave, Pau, 1899, page VII)
4- Cazaurang J.J., Le maïs et sa culture en Béarn, imp. Monnaie Pau,
D.L 33, 1981 p .13.
5- Mémoires de l’intendant Pinon, Bull.SSLA de Pau, 2e série, tome 33,
1905, p .42.
6- Mémoires de l’Intendant Lebret, Bull.SSLA de Pau, 2e série, tome 33,
1905,p. 121 et 122.
7 : Godefroy Léon, Voyages de Léon Godefroy en Gascogne, Bigorre et
Béarn, 1644-1646, publ. et annotés par Louis Batcave, Pau, 1899,
p. 44.
8- Foursans-Bourdette, M.P, Histoire économique et financière du Béarn
au XVIIIe siècle, Bordeaux, Bière, 1963, p.38.
9- Parmentier Antoine-Augustin, Le maïs ou le blé de Turquie : apprécié
sous tous ses rapports Paris, Imprimerie impériale, 1812, p.60.
Mémoires sur la culture et les usages du Maïs qu’on veut récolter en
grains, tiré des Mémoires d’agriculture, d’économie rurale et
domestique publiés par la Société royale d’agriculture de Paris,
janvier 1786, p. 34.
10- Abbé Rozier, article maïs, Cours complet d’agriculture théorique,
pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire, Paris,
1785, tome 6, p. 358.
11- Idem., p. 365.
12- Idem., p 368.
13- Idem., p 372.
14- Journal de l’Agriculture, du Commerce, des Arts et des Finances de
1774 de l’abbé Roubaud, publié par l’abbé Dubahat, Bull. SSLA
2e série, tome 39, 1911, p .211.
15- Desplat, Christian, Pau et le Béarn, au XVIIIe siècle, tome 1, J & D
Editions, 1992, p. 34.
16- A.D.P.A., B 4552, f° 26 (juillet 1735).
17- Cazaurang J.J., op.cit., p.12.
18- Idem., p.13.
19- Parmentier A-A., Mémoire sur la manière & d’employer le Maïs
comme fourrage, Société royale d’agriculture de Paris, p. 49, janvier
1785.
20- A.D.P.A. C 821 f° 183.
21- A.D.PA., C 72.
22- Alband D' , Moyen d’entretenir la culture des terres après
l’épizootie, Pau, 1776.
23- Desplat Christian, Le maïs en Béarn au XVIIIe siècle, article tiré des
plantes et culturesn nouvelles, Flaran 12, Presses universitaires du
Midi, 1990, p.143-153
24- Foursans-Bourdette, M.P, op.cit., p.36.
25- A.D.P.A., B 4564, f° 61.
26- Rambeau Marguerite, Etude ethnographique et lexicologique de la
culture des céréales dans un village béarnais : Lussagnet-Lusson,
Mémoire du Diplôme d’Etudes Supérieures (Lettres Modernes),
Année Universitaire 1965-1966, p. 62-63.
27- Idem., p. 67.
28- Idem., p. 69.
29- Idem., p. 75.
30- Idem., p. 77.
31- Idem., p. 86.
32- Idem., p. 88.
33- Archives nationales, F20 744.
34- Godefroy Léon, op.cit., p. 45.
35- Loubergé Jean, article : Viticulture et viticulteurs en Béarn du XVIe
au XVIIIe siècle tiré de Le vigneron, la viticulture et la vinification :
en Europe occidentale, au Moyen Age et à l’époque moderne,
Toulouse, Presses universitaires du Midi, 1991, p. 287-294.
36- Desplat Christian : « Économie et société rurales en Aquitaine aux
XVIIe-XVIIIe siècles ». In: Histoire, économie et société, 1999, 18ᵉ
année, n°1. Terre et paysans, sous la direction d’Olivier
Chaline et François Joseph Ruggiu, p. 149, 2002.
37- Desplat Christian, La Principauté de Béarn, Editions Marrimpouey
jeune, 1980, p.26.
38- Dr Doléris, Les vignobles et les vins du Béarn et de la région
basque, 1920, éditeur : Pau : R. Massignac.
39-Batcave L., Revue histoire et archéologie du Béarn et du pays
Basque, n°51, mars 1914.
40-A.D.P.A., Brevet des Etats de 1742, C 785, 141 vo.
41- A.D.P.A., C 1361.
42-Desplat Christian, Pau et le Béarn, tome 1, op.cit., p.166.
43-Dr Doléris, Les vignobles et les vins du Béarn et de la région basque,
op.cit., p.33.
44- A.D.P.A., C 1323.
45- A.D.P.A., C 771, f° 194 (1770).
46- A.D.P.A., C 812, f° 207.
47- A.D.P.A., C 815.
48- A.D.P.A. , C 1331.
49- A.D.P.A., C 815 f°149 et suivants.
50- A.D.P.A., C 1517, C 973.
51- Desplat Christian, Pau et le Béarn, op.cit., p. 173.
52- Desplat Christian, La vie en Béarn au XVIIIe », Editions du Cairn,
2009, p. 151 et du même auteur , La principauté de Béarn, op.cit.,
p. 508.
53- Loubergé Jean, L’évolution de la viticulture béarnaise au XVIIIe
siècle, Revue de Pau et du Béarn, n° 19, 1992, p.137 à 154.
54-Voir : Lasserre-Jouandet Simone, Le Vic-Bilh, article tiré de la Revue
géographique des Pyrénées et du Sud- Ouest. Sud-Ouest Européen,
Année 1951 22-1, pp. 27-54.
55- Voyage d’un Bordelais en Béarn et en Labourd (juin-juillet 1765),
publié et annoté par Paul Courteault, Imprimeur O. Lescher-
Moutoué, Pau, 1910, p.13.
56- Poueigh Jean, Le folklore des pays d’oc, la tradition occitane, petite
bibliothèque payot, 1976, p. 110.
57- Desplat Christian, La Principauté de Béarn, op.cit., p. 474.
58- Poueigh Jean, op.cit., p.113.
59- Warnant, E., Livre de raison de Jean-François-Régis de Mourot
propriétaire terrien, Bull.SSLA de Pau, 3e série, tome 20, 1960,
p. 89.
Bibliographie :
- Jean Beigbeder, « Voyage dans l’histoire du maïs, du Mexique aux
Pyrénées », société Ramond, 2011, 23 p.
- Dejean Pierre, L’exportation des vins béarnais dans les pays du nord
au XVIIIe siècle (La « Compagnie patriotique pour le commerce des
vins de Béarn ») article tiré de la Revue d’Histoire Moderne &
Contemporaine, Année 1936 11-23, pp. 212-213.
- Lachiver Marcel, La viticulture française à l’époque moderne, tiré de Le
vigneron, la viticulture et la vinification : en Europe occidentale, au
Moyen Age et à l’époque moderne, Toulouse, Presses universitaires du
Midi, 1991,p. 207-237.
- Loubergé Jean, article : Viticulture et viticulteurs en Béarn du XVIe au
XVIIIe siècle tiré de Le vigneron, la viticulture et la vinification : en
Europe occidentale, au Moyen Age et à l’époque moderne, Toulouse,
Presses universitaires du Midi, 1991, p. 287-294.
- Mane Perrine, Le vigneron, la viticulture et la vinification : En Europe
occidentale, au Moyen Age et à l’époque moderne, Nlle édition,
Toulouse, Presses universitaires du Midi, 1991.
- Pierre Tauzia, Le maïs dans les Pyrénées-Atlantiques, des origines à la
révolution agricole 1530-1939, Pau, CDDP des Pyrénées-Atlantiques,
1978, 48 p.
-
Par Michel64a le 12 Février 2021 à 16:55
PRODUITS AGRICOLES RECOLTES EN BEARN AU XVIIIe SIECLE
Le Béarn est une région agricole à majorité agricole au XVIIIe siècle, la polyculture y est dominante. Comme l’écrit MP Foursans-Bourdette, cette nécessité « dépendait à la fois des besoins de la consommation et des variabilités du climat ». Elle cite l’exemple de l’association céréales-vignes-prairies-touyas et ajoute le caractère enchevêtré des parcelles.
J. Bergeret nous a laissé une description des terres béarnaises dans son préliminaire de son traité de la flore des Basses-Pyrénées : « La surface de la terre habitable est presque par-tout couverte de végétaux et les espèces sont plus ou moins multipliées dans une contrée, suivant les circonstances plus ou moins variées du sol, du climat et des eaux. Le département des Basses-Pyrénées, baigné d’un côté, par la mer ; borné au sud par les Pyrénées ; arrosé par des torrens qui portent dans nos plaines des débris calcaires, argileux ou siliceux des montagnes ; incliné vers le nord-ouest interrompu dans cette direction par des collines disposées en amphithéâtre et souvent coupées en travers par des ravins ; offre, au milieu de la zone tempérée, la chaleur brûlante du midi, à côté des neiges et des glaces du nord. Aussi, voyons-nous dans les différentes parties de son étendue, les plantes de tous les climats, celles qui croissent dans les eaux douces et salées, celles qui se plaisent que sur les rochers, dans les sables et dans les marais. On y trouve des arbres propres aux constructions civiles et navales, des bois utiles pour le charronage, pour la menuiserie, pour toute sorte d’ouvrages de tour, de marqueterie, de lutherie et d’ébénisterie, des arbrisseaux flexibles pour la vannerie, ou recherchés pour la décoration des jardins, des plantes précieuses pour la teinture, pour les tanneries, pour les fabriques, pour toute sorte d’usages ruraux et domestiques ; des plantes excellentes pour la nourriture de l’homme et pour celle des bestiaux, des plantes vineuses, huileuses ou résineuses ; des fleurs superbes, enfin, des plantes médicinales et vénéneuses. »1
Dans cette partie, nous étudierons quelques plantes qui ont été cultivées par les Béarnais soit pour leur alimentation propre, soit pour nourrir leurs animaux ou encore à des fins commerciales.
A) Le maïs, une arme contre les disettes.
Le maïs tire son origine de la téosinte d’après les dernières recherches opérées notamment par Doebley. Plante croissante à l’état naturel en Amérique centrale, plus particulièrement les Caraïbes, elle a mû et a été modifiée à la suite de sélections par l’homme.
Il s’agit d’une plante importée en Europe par les Espagnols après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. Ce dernier la ramène lors de sa première expédition de 1492 à Séville .Ensemencée d’abord en Andalousie, celle qui est surnommée par les Aztèques « herbes des Dieux, conquiert ensuite le reste de la péninsule Ibérique. Vers 1610, elle gagne la Cantabrie et les Asturies. Toujours au XVIIe siècle, elle est plantée en Italie. On la retrouve en France mais la chronologie de son installation dans les diverses régions pose problème durant tout l’Ancien régime. Ce qui est sûr, c’est sa présence bien établie dans le sud-ouest à la fin du XVIIIe siècle. Son origine exotique a suscité auprès des paysans une certaine méfiance surtout si on la compare avec le blé, céréale emblématique.
Déjà sous l’Ancien régime, elle suscite des interrogations Fernard Fushs n’écrit-il pas en 1542 à Bâle : « Ce bled est du nombre de ceux que l’on nous a apportés d’étranges pays . il vient de Grèce et d’Asie en Alemeigne, et de là on l’appelle bled de Turquie. Car pour le jourdhuy , le grand turc possède et universellement toute l’Asie. » ? (De historia spirpium Commentarii insignes).
Une ordonnance prise dans le Pays Basque le 14 mai 1523 par le gouverneur de Bayonne, vicomte de Lautrec, interdisant aux riverains de la Nive de jeter du blé « d’arthomayro » fait débat.
Le texte : « …Vous mandons et à chacun de vous …commandons, par ces présentes , de par le Roi, notre Sire…à chacune des paroisses de Labour et à tous autres dont serait requis , étant à six lieux de lad ville , que dorénavant quand ils réduiront à culture leurs terres et couperont leurs arbres , racines et blé d’arthomayro , incontinent s’efforcent … branches racines et pailles d’arthomayro , à retirer hors lieu où leds rivières ont cours ; icelles coupent par menu ou brûlent de manière que ne portent aucun préjudice aux ponts, chaînes et, choses publiques de lad ville , aux peines que dessus… ».
Nous sommes alors au moment où l’on prend des mesures afin de soutenir un siège contre les Espagnols. 2 Le terme « arthomayto » d’origine basque pourrait correspondre à « gros mil » et plusieurs auteurs ont évoqué alors qu’il désignerait le maïs.
Mais J.J. Hemardinquer avance l’idée que le mot « mairo » correspond plutôt à « Maure » ou à « sauvage » (et donc que l’arthomayto se rapporte en fait au sorgho) et non au maïs.
Plus tard, en 1628 l'appellation "froment d'Inde" est transcrite dans un texte qu'on a trouvé. D’ailleurs les deux vocables « froment d’inde » et « Mayrou » y sont écrits, le premier concernant le maïs. Toujours dans le Pays Basque, en 1644, sa présence est établie et sa place est devenue importante : « La habitants du pays du labourd sont obligés de brusler et oster des prairies…la paille de mairou, mais comme ce bled n’est plus en usage et qu’au lieu de celluy la on y fait à présent du millet d’Inde, la paille duquel charge plus que ledit mairou. » Le même J.J. Hemardinquer soutient que ce que l’on désigne par le nom d’arthomayro n’est tout simplement qu’un sorgho à épi.
Ce dernier serait différent de celui que l’on trouve alors en Béarn. Le premier plus volumineux que le second qui correspond à celui que l’on nomme « sorgho à balais ». Cette plante herbacée de la famille des Graminées est plus rustique que le maïs et s’adapte très bien à tous types de sol.
En ce qui concerne le Béarn, on mentionne généralement comme l’ont fait R. Ritter et Cuzacq la date de 1563. Cette année-là, un espion espagnol, Juan Martinez d’Escurra rend compte à Philippe II d'Espagne de ce qu'il observe à Navarrenx, où s'édifie la forteresse que nous connaissons et use de ce mot en désignant un fourrage vert qui serait impropre aux chevaux montés par les cavaliers espagnols. Il emploie l’expression « mijo y borona ». J.J. Cazaurang écrit que le terme de « borona » est celui que l’on use à propos d’une variété de panis à une période antérieure « à l’introduction du maïs en Espagne ». Il fait référence à J.J. Hemardinquer qui ne voit dans la combinaison des deux appellations « mijo y borona » qu’une référence aux « millet et panis ».
Un autre témoignage, celui du chanoine du Quercy nommé Léon Godefroy, en 1644 : « En Béarn, les millets d’Espagne ou de Bordeaux (maïs) sont hauts de dix ou douze pieds et on en transforme la tige en échalas pour les vignes. » 3
J.J. Cazaurang doute encore que ce soit réellement du maïs. Il penche plutôt que cela soit encore du sorgho.
On pense que la plante est connue dans le Labourd au début du XVIe siècle, surtout cultivée dans les jardins. On la retrouve dans certains marchés de Bresse aux alentours de 1625, dans la mercuriale de la cité de Castelnaudary en 1637.
J.J Cazaurang écrit que c’est « au cours du XVIIe siècle et sans doute après 1650, que le maïs conquiert le Béarn. Il s’impose aux dépens des millets et sorghos. 4
Son extension dans la province a probablement été retardée par l’importation de blés en provenance d’Aragon, qui permettait de pallier aux insuffisantes ressources céréalières dont souffrait le Béarn.
L’Intendant Pinon en adressant son mémoire à Louis XIV mentionne au sujet du Béarn : « Les plaines y sont assez belles et assez fertiles. On y sème peu de froment et de seigle ; mais il y a quantité de milloc, qui est un blé venu des Indes, dont le peuple se nourrit. » 5
L’Intendant Lebret est plus explicite au sujet de la culture du maïs en Béarn ». Voici ce qu’il écrit dans le mémoire adressé à Louis XV au sujet des terres agricoles béarnaises en 1703 : « Le terrain est bon et produirait beaucoup sans cet accident (il s’agit des gelées) qu’on évite en partie en semant du maïs ou blé de Turquie qui sert pour la nourriture des paysans. Les champs de la plaine de Pau, de la vallée de Josbaight, des plaines de Navarrenx et de Sauveterre ne se reposent jamais ; on les trouve toujours semées, tantôt de froment, tantôt de seigle, d’avoine, de lin, de millet et très souvent de maïs...Le maïs ou blé de Turquie s’est introduit en Béarn depuis peu d’années…» 6
Lentement, le maïs gagnera du terrain dans le Béarn, le long du gave de Pau et, enfin, dans les mercuriales béarnaises au début du XVIIIème siècle.
Vers la moitié du XVIIIe siècle, selon Marie-Pierrette Foursans-Bourdette, la moitié des terres labourables sont ensemencées en maïs, elle cite notamment la plaine de Nay « où en 1784, 80 % des terres labourables sont consacrées au maïs ».7
Pourquoi l’appelle-t-on « blé de Turquie » ? En lisant l’ouvrage du botaniste allemand Léonard Fuschs, auteur de l’ouvrage intitulé « De historia stirpium commentarii insignes » (Bâle Insingrin, 1542), «Ce bled (comme plusieurs autres) est du nombre de ceux que l’on nous a apportés d’étranges pays. Il vient de Grèce et d’Asie en Alemeigne, et de là on l’appelle bled de Turquie. Car pour le jourdhuy, le grand turc possède et détient universellement toute l’Asie ». Dans l’Encyclopédie de Diderot, on lit à l’article maïs : « (Botanique) et plus communément en français blé de Turquie, parce qu'une bonne partie de la Turquie s'en nourrit. » Ici, on constate que l’utilisation du nom donné au « blé de Turquie » est en fait est impropre puisque le maïs est originaire du Nouveau monde et non de Turquie.
Voici un exemple parmi d’autres, le nom de blé de Turquie est assimilé au sarrazin.
Figuration du sarrasin nommé « Ble de turquie » tirée des « Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne » (1503-1508) ; illustration extraite de Wikipidia dans l’article « blé de Turquie ».
Son utilisation a varié dans le temps, d'abord comme fourrage vert puis, par la suite, entrera dans l'alimentation des individus les moins riches.
Parmentier écrit que la plante se plaît « dans un sol léger et sablonneux », plutôt que dans une « terre grasse et argileuse, où il vient néanmoins assez bien. Les plaines situées au bord des rivières , les terres basses qui ont été submergées pendant l’hiver, et où le froment ne saurait réussir, y sont en général très-propres. Enfin, quelque aride que soit le sol du Béarn , il produit toujours , à l’aide de quelque engrais , d’amples récoltes , sur-tout s’il survient à temps des pluies douces et des chaleurs successives , ce qui rend ce grain infiniment précieux et d’une grande utilité par-tout où il peut prospérer» . »8
Quels sont les avantages et les inconvénients ?
a- Les avantages
Pécuniairement, il revient moins cher que le blé et sa production peut satisfaire les besoins de la population. De plus, il a la particularité de bien s'adapter au Béarn.
Le cycle de vie du maïs dure 6 mois, le semis a lieu au printemps (avril-mai), durant l’été sa croissance est rapide et sa floraison s’effectue en été (en juillet). Les grains sont récoltés en automne, aux mois d’octobre et de novembre.
Comme l’écrit Marie-Pierrette Foursans-Bourdette le maïs « pousse plus vite que le blé, il rapporte trois plus et il en faut très peu pour ensemencer un champ. De la racine à la graine, tout est consommable et utilisable, le gain est mangé par l’homme et l’animal (volaille, porc), la tige sert de fourrage et de fumier surtout pour les prairies.
Autre qualité, il échappe à la jachère qualifiée de « morte » et de s'introduire dans le cycle blé d'hiver-céréales de printemps entraînant par la même occasion l’utilisation plus importante de la charrue et de la herse au détriment de l’araire.
Un des témoins de l’époque rapporte : « Le bled d’Inde, une de nos grandes ressources, est la nourriture commune des paysans du second ordre et d’une partie des Artisans. On le sème à la fin d’Avril et au commencement de Mai ; il se récolte en Octobre ; presque toujours, il réussit assez pour nous préserver de ces affreuses famines qui nous désoloient avant l’usage de ce grain … ». 9
L’Intendant Lebret lui reconnaît une qualité : « …la récolte du maïs est sûre, le brouillard ni la grêle, à moins qu’elle ne soit extraordinairement grosse ne l’endommagent pas point, les gelées du printemps ne lui nuisent point non plus parce qu’on ne le sème qu’au mois de Mai… » 6
Christian Desplat , lui aussi, insiste sur cette qualité : « Le « milloc » présentait en réalité un seul avantage, mais il était de taille : il était la seule céréale capable de résister aux sautes d’humeur du climat béarnais. » 10
Un autre témoignage datant de juillet 1735 dépeint très bien les effets très négatifs des aléas climatiques subis par le Béarn, il provient du parlement de Navarre : « …les terres de leur nature sont fort stériles, cette province est affligée et accablée par les grêles fréquentes qui chaque année enlèvent la moitié des fruits dont la totalité ne suffirait pas à nourrir les habitants la moitié de l’année ». 11
Plus loin, l’Intendant rajoute que c’est un « excellent » fumier « …pour les prairies, ainsi que l’expérience l’a fait voir de plusieurs années. »
On donne quelques parties de la plante à manger aux bestiaux comme les feuilles notamment pour l’engraissement des cochons et des oies mais aussi on utilise les feuilles de l’épi pour la confection des matelas .Ici, on évoque un des grands travaux des Pyrénéens à la fin de l’année qui consistait à ce que l’on nomme les « desperouquères », pour cela il était nécessaire d’utiliser tout le monde même les voisins. Ce sujet sera repris lorsqu’on abordera les veillées puisque cette tâche s’effectuait le soir.
La maïs allait devenir pour les Béarnais une arme contre les disettes, bien intégré dans les cycles économiques, sujet de spéculations, toutefois, il s’avèrera qu’il n’a guère pu éviter la disette survenue en 1778 et celle de 1789.Les parlementaires béarnais n’écrivent-ils pas : «…la chose serait difficile à croire pour ceux qui ignorent que le milloc, même prix égal paraît préférable aux paysans, auxquels il fournit une nourriture sinon plus substantielle, du moins plus abondante et cette espèce de gens préfère volontiers une abondance même indigeste à un aliment meilleur mais plus délicat. Dans ces vues d’économie, le froment même ne saurait tenir lieu de cette autre nourriture grossière. ».
Autre point, la plante est riche en hydrates de carbone mais déficiente en protéines et en acides aminés de qualité. 12 Il est « carencé, au point d’entraîner, à la limite, des affections pellagreuses. » Le même auteur mentionne que cette tare est reconnue dès le XVIIIe siècle, elle se « manifeste par trois symptômes que l’on peut appeler les trois d : démence, dermatose, diarrhée. » Il l’explique par sa carence en vitamine PP (acide nicotinique) et en acide aminé. Cela a des conséquences négatives sur la croissance des jeunes. Il fait remarquer les Américains avaient réussi à s’en prémunir en l’associant avec du haricot ce qu’ont fait également les Béarnais « empiriquement ». 13
Il rajoute que l’introduction de la plante dans le système cultural béarnais a été bénéfique dans la mise en valeur du sol. Il écrit que « Par sa période de végétation, complémentaire de celle du froment, le maïs évitait la jachère morte et s’insérait naturellement dans le cycle blé d’hiver-céréales de printemps avec, dans une région suffisamment humide, des rendements meilleurs que ceux des millets. » La bonification de l’agro-système résultait encore des cultures associées au maïs et complémentaires de ce dernier : haricots à rame, citrouilles qui ne nuisent guère à la céréale, trèfle ou raves qui se développent après la cueillette des épis. »
b- Quant aux inconvénients, ils sont tout aussi nombreux.
Le maïs nourrit quantitativement l'homme et l'animal et non point qualitativement. Il est pauvre en protéines. 14 On peut ajouter également que sa consommation croissante provoque la sensation de monotonie.
L'Intendant Lebret mentionne: « La première raison contre le maïs est qu'il use extrêmement la terre et qu'il ne produit point de fumier. » C’est un « assez mauvais fumier pour les terres labourables. »
Le même Intendant continue à reprocher à la plante de faire du pain lourd, qui se digère mal. Parmentier lui-même déplorait cet état de fait. Ayant réceptionné un pain de maïs, renfermé dans sa terrine, il s’exclame : « Quel fut mon étonnement, en voyant au lieu de pain, une masse de pain serrée, grasse et à peine cuite ! C’est alors que mes espérances se ranimèrent, et que je cédai à un sentiment de tristesse, mêlé de consolation, en m’écriant : Quel pain mangent nos compatriotes les Béarnais ! Ils en prépareraient de bien meilleur, et à moindres frais, s’ils renonçaient à leurs terrines étroites et profondes, s’ils faisaient des masses moins considérables, et s’ils achevaient leur cuisson à nu dans le four. Mais combien ce pain acquerrait de qualité, si la farine était toujours parfaitement moulue ! Alors il ne faudrait plus employer d’eau bouillante : le pétrissage, ainsi que la fermentation s’opéreraient plus complètement ; il ne serait plus nécessaire de faire chauffer autant le four. Enfin, la fabrication du pain de Maïs sans mélange, rentrerait dans le procédé général, serait moins embarrassante, et plus certaine. » 15
Le même Intendant signale qu’il ne se conserve qu’un an.
Un autre personnage tenta de mettre à l’index le maïs, il s’agit d’un agronome qui était membre de la Société d’Agriculture de Saint-Gaudens .M. d’Alband .Par le biais d’un mémoire intitulé « Moyens d’entretenir la culture des terres après l’épizootie », outre des conseils donnés au niveau des techniques agricoles (substitution du cheval pour le labourage, usage d’engrais artificiels), il critique la culture du maïs. Selon lui, elle a trop remplacé celle du froment, il la considère trop « vorace d’engrais « et trop lente à mûrir, il opte davantage sur les cultures des blés de printemps. 16
Christian Desplat reconnaît que le maïs « épargna au Béarn les catastrophes alimentaires, mais en même temps, il transforma très tôt une polyculture spéculative en une stricte polyculture de subsistance. De même, il ajoute qu’en « apparence, l’essor du maïs, la viticulture achevaient de donner au Béarn son visage aquitain… ».
Au début du XVIIIe siècle, le maïs s’introduit dans les mercuriales de la province. Son coût est alors inférieur de moitié à celui du blé. Christian Desplat l’explique : « Mais on tiendra compte du fait que le maïs n’était pas panifiable et qu’il n’y avait guère de possibilités d’achat en dehors des pays aturiens. » 17
Mais on constate néanmoins que son prix peut souvent atteindre le même coût que celui du blé, mais aussi devenir plus onéreux lors des périodes de crise.
En analysant la mercuriale des grains à Pau, Christian Desplat constate les faits suivants : « … le maïs au XVIIIe siècle ne jouissait encore que d’une maturité économique relative. La soumission du maïs à la conjoncture du blé, qu’il soit beau ou “médiocre” est certaine. Au début du siècle, le prix du maïs répercute les incertitudes d’un approvisionnement encore très dépendant des marchés aragonais et navarrais. Par la suite la similitude des courbes paloises avec celles de Toulouse ou de Bayeux souligne le rôle d’un marché national dont le maïs subit les variations alors qu’il n’était encore qu’une production régionale. 17 De Plus, il note que : « … à la hausse le prix du froment réagit toujours le premier et il entraîne à sa suite ceux du méteil et du maïs. Mais on doit cependant noter que lors des fluctuations courtes, si le maïs connaissait des hausses un peu plus tardives que le froment, il se maintenait ensuite plus longtemps sur un pied plus élevé. On trouve ici la confirmation de l’importance prise par le maïs dans l’alimentation populaire qui avait fait de lui un objet de spéculation. Les spéculateurs avaient évidemment plus à gagner sur le maïs, consommation de masse, que sur le froment ; dans une économie où les marchés étaient très étroitement surveillés, les autorités cherchaient toujours à prévenir le mécontentement populaire sans avilir les prix des producteurs, il était plus facile de retarder une hausse que de la conjurer une fois qu’elle s’était produite. La coïncidence générale des prix du froment et du maïs, valable pour d’autres céréales, ne doit pas cacher les singularités des fluctuations courtes du blé d’Espagne qui était devenu le “pain des pauvres”. Enfin, il mentionne que : «… l’amplitude des variations saisonnières est plus forte dans le cas du maïs que dans celui du froment. Mais en dehors des périodes de crise, les écarts saisonniers excédaient rarement plus de 10 %.... Après 1770, le mouvement saisonnier périodique fut constamment agité de violentes oscillations. Il faut cependant souligner que la corrélation entre la hausse des prix, les crises économiques et les crises de subsistances n’a jamais été parfaite…. A la fin du siècle l’importance du maïs était devenue décisive… »
D’autres documents attestent l’importance du maïs dans l’économie domestique. Les actes notariaux sont significatifs à ce sujet, notamment ceux ayant trait aux pensions alimentaires lors des testaments. Sur 800 contrats analysés par Christian Desplat, 10,37 % constituent la proportion des pensions annuelles. Ces dernières sont élevées lors des périodes de fortes hausses des prix et basses lorsque ces derniers sont faibles. Il écrit : « Seulement 4,7 % des pensions étaient exclusivement formées de céréales, dont 50 % d’un seul produit ; mais le maïs apparaît dans 65 % des pensions, le froment dans 57 %, le seigle dans 43 %. Aucun doute n’est permis, avec le cochon ,le maïs était devenu le fondement de l’alimentation populaire…. ». Toujours à partir de cette étude le maïs « … ne venait qu’au second rang pour les quantités composant la ration alimentaire en céréales. Avec 26,6 % il arrivait immédiatement après le froment (30,8 %), mais avant le seigle (22,2 %), le millet (12,6 %) et le méteil (7,6 %). » Il termine en mentionnant : « Le milloc a indiscutablement assuré une alimentation plus régulière ; mais son introduction coïncide avec une réduction de la ration annuelle de céréales qui passe de 279 litres par personne avant 1750 à 217 litres après cette date. »
Un autre moyen de connaître l’impact du maïs dans l’alimentation des Béarnais de l’époque consiste à observer les inventaires des cuisines populaires. Le même auteur écrit : « la prépondérance des “chaudières” évoque le plat unique, le maïs sous forme de bouillie (la broye) ou de péte “la mesture” »
Le maïs fera l’objet de produit d’exportation aux alentours de l’année 1750 à destination de l’Aragon, de la Galice et du Portugal soit par voie maritime soit par voie terrestre. En effet, ces régions connaissent à cette époque une crise agricole. L’Intendant d’Aine en donne l’autorisation en 1774. Par exemple, il est possible de vendre à la péninsule Ibérique près de 10 000 quintaux. Cela permet un écoulement régulier des excédents de récolte. Elle précise que c’est l’Intendant qui accélère ou freine ces exportations de par les ordonnances qui ‘il prend vu que cela peut provoquer une hausse ou une chute des prix. 18
L’abbé Roubaud nous informe qu’ : « Il y a quelques années que la Galice et le Portugal, en échange de notre bled d’Inde ont versé dans ce pays une immense quantité d’argent. Il fallait voir avec quelle ardeur nos campagnes étoient travaillées ? Quand la cherté est revenue, il y avoit les moyens à payer. Mais les craintes étoient d’autant plus vives que la partie de l’Arragon qui nous avoisine avoit été frustrée de toute récolte par une longue sécheresse. » 9 Il écrit cela en 1774.
On sait qu'on ne défricha que quelques centaines d'hectares au XVIIIe siècle. On pense qu'au début de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le maïs s'étend sur près d'un tiers des surfaces. Par contre, sa part dans les mercuriales est en hausse. Il fait l'objet de spéculations. Le maïs, devenu un grand produit alimentaire du peuple, revêt une importance plus grande que le froment, à la base du fameux pain blanc, plus onéreux, donc consommé davantage par les individus aisés. On peut affirmer que la culture du maïs a été bénéfique dans ce sens qu'il a écarté le spectre de la famine mais pas celui de la disette comme on le constatera plus loin.
Son exploitation est source d’exportation, on vend les excédents en Aragon, en Galice et même au Portugal. La quantité exportée est telle que souvent l’Intendant est tenu de modérer le débit pour éviter que cela ait une incidence sur les prix.
Le 20 mai 1769, les parlementaires béarnais dressent un mémoire 19 sur le milloc -autre appellation donnée au maïs, laissons-les parler: « la plus grande partie des habitans du ressort et surtout ceux de la province du Béarn se nourisent toute l année de Bled d inde appelé Dans le païs millocq. Les terres de la province en rapportent assés Considérablement et suffisament pour la Consommation des habitans, le froment et les autres menus grains ny Croissent au contraire quen petite quantité...le millocq sert non seulement pour la subsistance des habitans de la campagne, mais pour nourrir la volaille, et...les cochons». Mais son prix, dans les périodes de pénurie, peut atteindre, voire même dépasser, celui de la céréale « noble ». En effet, son cours, grâce à l'exportation (en Aragon, au Portugal...) stagne, cependant en 1788-1789 les désastreuses récoltes dues au mauvais temps vont tout perturber et mécontenter les classes populaires. Ce qui explique que les jurats de Pau tentent, par exemple, afin d'apaiser les esprits de lancer la fabrication d'un pain surnommé « pain des pauvres » constitué d'une part de blé pour deux parts de maïs.
Parmentier nous relate comment on plantait le maïs en Béarn. « On commence par labourer la terre en automne, comme s’il s’agissait d’ensemencer du froment ; on la laisse ainsi labourée jusques à la fin d’avril ou les premiers jours de mai ; alors on la herse pour briser les mottes et la nettoyer. Cette opération faite, on lui donne un second labour avec un instrument de fer différent du soc, en ce qu’il est en forme de pelle. On le nomme arrazere . Cet instrument est précédé du coutre, sur-tout lorsque la terre a pris trop de consistance ; et on emploie pour cela deux attelages. Après ce second labour, on s’occupe à marquer la terre, et l’on se sert à cet effet d’une pièce de bois longue de cinq pieds et trois pouces et demi en carré, dans laquelle on pratique quatre ouvertures , en commençant par les extrémités et à égale distance , afin d’y placer quatre pelles de bois ou de fer. On ajoute à cette pièce une perche ordinaire pour l’atteler ; et pour l’attelage, on a un joug long de cinq pieds. Sur la pièce de bois où se trouvent les pelles, on attache deux tenans pour le laboureur : ensuite on marque la terre sur toute sa longueur, en rayon aussi droits qu’il est possible ; on la remarque ensuite dans toute sa largeur, afin de former des carrés, et c’est dans ces carrés qu’on jette la semence. » 9
B) La vigne,
La viticulture française a connu des périodes d’essor de déclin à travers le temps depuis son introduction par les Romains. En hausse aux XII-XIIIe siècles, en déclin aux XIV-XVe siècles, elle connaît un redressement à partir du XVIe siècle. Elle est plus présente près des grandes villes – où la consommation s’accroît- et se transforme de façon importante. On estime que la France, à la veille de la Révolution, possède près de 1,576 000 millions d’hectares de vignes ce qui fait d’elle le plus grand terroir viticole mondial. Cela lui permet une production d’une trentaine de millions d’hectolitres de vin annuellement.21 Si la production augmente, elle le doit davantage aux petits vignerons. Le vignoble disparaît quasiment au nord du pays du fait d’un lent reflux. Les producteurs se sont aussi tournés de plus en plus vers des vins colorés en délaissant le vin blanc et le vin clairet. Au XVIIIe siècle, on note un effort pour s’orienter vers la qualité. La consommation de vin est en hausse, le nombre de tavernes, de cabarets en témoigne.
A l’époque, dans le Béarn, la vigne est omniprésente. Déjà, à l’époque antique, sous les Romains, elle est accréditée. Une mosaïque dans la villa de Taron, dans le Vic-Bilh (ou Vic Vieux), est bordée par des feuilles de vigne. On pouvait également observer dans la villa de Jurançon - qui a disparu - des feuilles de vigne et des grains de raisins picorés par un oiseau.
Au Moyen-Age, on note que la vigne est répandue dans quatre zones. Le Vic-Bilh comme on vient de l’évoquer – notamment par l’entremise de moines bénédictins de Madiran et de marchands morlanais -, puis autour de Montaner, ensuite sur les coteaux de Monein et, enfin, le long du gave de Pau, entre Lescar et Lacq. Quant aux parcelles, elles ne sont pas importantes et le vin que l’on en retire sert essentiellement à la consommation locale. A l’époque moderne, d’après Pierre Marca « les vins de Jurançon sont d’une bonté exquise qui surpasse les meilleurs de Chalosse et du Bordelais et, par conséquent, de presque toute la France... ». Si les souverains de Béarn sont propriétaires de vignobles, ceux que l’on trouve dans les régions de Monein et du Vic-Bilh sont détenus par la noblesse et l’Eglise béarnaises.
Jean Loubergé 22 écrit que ce sont les marchands palois, « aiguillonnés par la présence, à la fin du XVe siècle, de la cour des rois de Navarre et de leur administration » qui se sont tournés vers ce vignoble. Le personnage central serait Henri d’Albret qui par l’achat de terres et par le biais d’affièvements de terres en friche en aurait été le grand incitateur. Ces actions entraînent alors le déclassement du vin du Vic-Bilh et la renommée de celui de Jurançon. D’après l’auteur, c’est lui qui a la faveur de la noblesse parlementaire soucieuse de détenir des domaines.
Les Fors de Béarn établissent une sélection vis-à-vis du vin, ils décident de ne pas imposer le vin non sujet au commerce, celui de consommation courante. Par contre, ils taxent le vin destiné au commerce ou qui est importé. Ainsi, on décrète l’interdiction d’importer du vin étranger durant une période qui s’échelonne du 1er octobre jusqu’au 1er mai.
De nombreux règlements sont décrétés en ce qui concerne la vente du vin.
En 1802, des données statistiques sont données et nous renseignent sur le vignoble béarnais. Bien que l’on puisse douter quelque peu de la véracité des chiffres, ces derniers nous permettraient d’établir une approximation du pourcentage du vignoble par rapport au reste des cultures, soit près de 15 %.
a- Le mode d’exploitation
Tout propriétaire détient une parcelle de terres consacrée à cette culture, exception faite de celles qui se trouvent en montagne. La viticulture occupe de nombreuses catégories sociales depuis les nobles, la bourgeoisie et les journaliers. Deux types de vignerons se détachent, les propriétaires et les métayers. Bien entendu, la part de la vigne dans l’exploitation diverge de quelques escats pour les minoritaires jusqu’à un demi-arpent pour les plus grandes. Elles sont généralement closes.
Christian Desplat 23 analysant l’Aquitaine méridionale et dont les régions du Madiran, du Vic-Bihl et du Jurançon constate que les paysans sont en majorité les principaux propriétaires de viticulture. Pour citer un exemple, dans le Madiranais, les terres sont détenues par ces paysans à 81 % alors que le clergé possède 3,7 % et la noblesse 11,3 %. Ensuite, connaissant des crises en 1693 et 1694, toujours dans le Madiranais, les riches propriétaires augmentent en importance au détriment des petits tandis la proportion des vignobles stagne durant le XVIIIe siècle aux alentours de 15 -16 % ce qui démontre que les superficies ne sont guère de grande envergure.
Les vignerons voient leur nombre augmenter durant le XVIIIe siècle et notamment ceux qui possèdent de petits terroirs vu la part de la demande qui s’avère conséquente. Mais comme on vient de le voir leur part dans la population totale dépend des zones géographiques béarnaises.
Autour de Saint-Faust, par exemple, d’après les contributions foncières de 1791 analysées Jean Loubergé, il ressort que le village était composé de «peu d’artisans et presque pas de commerçants ; il avait par contre une forte tradition viticole grâce à la proximité de la cité épiscopale de Lescar et de sa bourgeoisie. » Saint-Faust dénombre 184 propriétaires fonciers, parmi eux 147 représentent la paysannerie. « Il y a 67 « laboureurs » (c’est-à-dire paysans ayant un attelage de labour) et 80 vignerons, tous, laboureurs comme vignerons, étant propriétaires de parcelles de vigne, mais les vignerons payant une contribution foncière moins importante que les laboureurs car ils ont moins de terre. »
Son étude se poursuit dans le Vic-Bilh où il distingue deux villages, Aydie et Portet. Dans le premier, il recense : « …60 laboureurs, 23 brassiers, 17 manouvriers (ou journaliers), 2 vignerons… », tandis que dans le second on dénombre « …21 laboureurs seulement, mais 51 brassiers, 6 vignerons et parmi les artisans 6 tonneliers, chiffre considérable si l’on considère les tonneliers dans les autres villages viticoles où ils ne sont jamais plus de 1 ou 2. »
Enfin, il décrit, parmi d’autres localités dans le sud-ouest, du Béarn la cité de Monein où le même auteur constate que seul le quartier du bourg « compte beaucoup de vignerons, 42 ; partout ailleurs, dans les quartiers ruraux, ils sont en nombre infime, ces quartiers comptant surtout des laboureurs et des journaliers. » Il précise que dans les exemples donnés les propriétaires fonciers « possédant une maison ou une terre » ont été catalogués, par conséquent, il est nécessaire de rajouter « ceux qui ne possèdent rien, et surtout les familles des possédants qui pouvaient…s’employer dans le travail de la terre et particulièrement du vignoble. On peut donc estimer qu’il y avait, à la fin du XVIIIe siècle, une main d’œuvre excédentaire…situation qui se poursuivra durant le XIXe siècle, en attendant que l’exode rural éclaircisse les rangs. » Ce constat explique la signature de contrats de travail « moins favorables aux travailleurs qu’ils ne l’étaient au début du siècle. »
Dans ses études sur les différents systèmes d’exploitation le même auteur, au XVIIIe siècle, pointe celui du métayage où « le métayer étant logé soit dans la maison du maître quand celui-ci ne réside pas, soit dans une petite maison adjacente. », puis celui des « vigners », embauchés à la journée habitant « soit dans les bourgs soit à proximité du domaine, dans de petites maisons construites sur un lopin de terre qui leur a été alloué ; ils seront surtout plus nombreux au XIXe siècle. » Il remarque que les contrats deviennent plus contraignants dans le Jurançonnais que dans le Vic-Bilh et l’explique par le fait que « l’emprise de la classe dominante s’y affirme beaucoup plus et que les domaines y valent plus chers. » Ceci que tandis que les contrats de fasende (soit : travail) notés dans les actes notariés se distinguent dans le Vic-Bilh par le fait qu’ils mentionnent la fourniture d’échalas par le propriétaire. Selon Jean Loubergé, cette particularité s’expliquerait par la raréfaction du bois et le remplacement des vignes par les hautins nécessitant « d’échalas plus grands ».22 siècle)
Christian Desplat note que si le Béarn a augmenté le terroir agricole ce n’est que par le biais de « conditions techniques et sociales très particulières ». De montrer qu’il y eut très peu d’amateurs parmi les nobles enclins à dynamiser cette filière. Ils auraient pu étendre les plantations sur les coteaux et éviter que le vin des plaines de moins bonne qualité inonde le marché. Il « eût fallu que l’aristocratie réalisât une mainmise massive sur le plat pays et réalisât sa conjonction avec une classe de négociants entreprenants, l’une et l’autre firent défaut. »
La viticulture des plaines, d’après Christian Desplat, a connu son apogée d’abord au Moyen Age, aux XIVe et XVe siècles puis on a tenté de relancer la production pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Pour lui cela a occasionné une atteinte aux pratiques communautaires. 24
b- La recherche d’un vin de meilleure qualité pour l’exportation et l’effort des Etats de Béarn pour y parvenir
Il n'y a pas de grand cru à l'époque, mais elle constitue un apport très important d'argent avec le bétail, puis, la culture du lin qui s'étend le long des gaves.
M. Doléris tient en grande considération la qualité du vin béarnais puisqu’il les dépeint comme étant « suffisamment alcooliques, d’un bouquet très fin, les vins béarnais avaient le mérite d’être bien équilibrés et, comme les fruits bien mûris, de garder une activité proportionnée au degré alcoolique et au sucre résiduel. Ils conservaient ce fruité, malgré leur vieillissement. » 25
Pour en revenir au vignoble, il est à noter que la part que l'on y consacre en superficie dans le Béarn est peu importante, légèrement plus d'un dixième dans le Vic-Bilh pour citer un exemple. On constate toutefois un intérêt certain pour le vin au XVIIIe siècle, ce qui avantage à la fois l'exploitant aisé désireux d'accroître ses revenus et la moyenne des propriétés consacrées à sa culture.
Sa production augmente du fait de la hausse de la consommation et de bonnes conditions climatiques, surtout à partir des années 1720, ce qui n’avait pas été le cas auparavant. On sait qu’en 1702, par exemple, l’année fut marquée par une sécheresse importante, tandis qu’en 1709, l’hiver se caractérise par un grand froid.
Le témoignage d’un chirurgien palois du nom de Fourticot nous a laissé une description de ce qui advient durant l’hiver de cette année. On peut lire dans son journal : « En l’année 1709 vers le 8 janvier, les froids et les neiges furent si fréquents qu’ils durèrent tout ledit mois de janvier et celui de février jusque à demi-mars, avec des vents et bises qui furent cause que quantité d’arbres se séchèrent, notamment les figuiers et vignes, et par un surcroît , il fit vers le 15 avril une neige si forte que la nuit suivante il fit une gelée qui acheva de perdre toutes les vignes dans tout ce pays de Béarn. » Et, pour ce qui concerne plus particulièrement la vigne, il ajoute : « …il a fallu couper…le peu de bourgeons qui était resté aux vignes si était resté quelques raisins, il fit au mois de septembre des gelées qui empêchèrent les raisins de mûrir, ce qui causa que le vin était si vert qu’à peine pouvait on en boire, et avec tout cela il se vendit à 10 et 12 sols le pot, et la barrique qui s’est vendue jusques à 25 et 30 écus celle de Jurançon, et celle du Vic-Bilh à 20 et jusques à 24 écus. Pour ce qui est des vignes et des hautins, il en a fallu couper en beaucoup d’endroits la moitié des pieds… ».26
Le négoce du vin constitue une des ressources importantes du Béarn et surtout pour certaines zones comme les pays de coteaux caractérisés par un sol difficile à travailler car trop rocailleux. L’évêque de Lescar, président des Etats de Béarn, ne déclare-t-il pas en 1742 que « les habitants de la province l’avaient reconnu depuis longtemps, le vente de leurs vins par l’étranger était la seule et presque unique ressource pour leur soulagement. » ? 27
Liés à cette augmentation les vignerons voient leur nombre s’accroître notamment les petits exploitants. Autre changement, avant le XVIIIe les terres consacrées à la vigne se localisent sur les coteaux ou les versants des vallées – exposées au Sud si possible et en dehors des fonds de vallées jugés trop humides et plus frais -, à partir de ce siècle on constate que la vigne s’installe là où régnaient les céréales c’est-à-dire sur les plaines et les fonds plats des vallées (Vic-Bih et coteaux de l’Entre-Deux-Gaves, entre les localités de Jurançon et de Monein, régions caillouteuses et ensoleillées). Ce qui a déclenché des problèmes c’est le fait que les premiers à planter des vignes ce sont les nobles , moins astreints aux contraintes de culture, alors que sur ces parcelles les bêtes paissent sur des terres considérées comme « vaines ».
En effet, une des transformations opérées au XVIIIe siècle selon Jean Loubergé est « l’apparition des vignes dans les plaines alors que jusque-là les parcelles de vignes ne se trouvaient guère que dans les terroirs plats des vallées, grandes ou petites, étaient réservées à la culture des céréales… ».
En ce qui concerne la qualité du vin, ce dernier pendant longtemps ne pouvait guère se conserver longtemps et devenir forcément du vinaigre au bout d’une année approximativement. Le vin de consommation courante appelé le « picquepouct » était produit de façon intensive et pour le conserver on usait du soufre.
On réussit toutefois à obtenir un vin constant au goût. Mais sa qualité fut sujette à des critiques sur deux types de vin , le premier que l’on qualifierait actuellement de consommation courante et celui que l’on exportait dans les pays du Nord de l’Europe comme La Hollande, la Belgique…Les raisons sont nombreuses, l’une résulte d’une pratique opérée par les vignerons consistant à planter un cep de vigne et de le lier à un arbre notamment des cerisiers ou supporté par des échalas ou « paxe » (surnommée la culture en hautin ou hautain ) ce qui a pour effet d’obtenir du raisin qui murit sous les feuilles desdits arbres donc trop à l’ombre et d’avoir des ceps trop grands ce qui a des effets négatifs (afin d’éviter également les premières gelées de la fin de l’automne, à cet effet on utilise également des pieux d’arbre comme le châtaigner de 2 m de hauteur) , une autre proviendrait des petits vignerons qui n’entretiendraient pas suffisamment leur vigne. Ceux qui furent enclins à dénoncer cette diminution de la qualité furent les Etats de Béarn car ils étaient intéressés par cette manne financière que la vigne représentait pour le Béarn.
En 1725, par exemple, un cas démontre le problème posé par la production du vin des plaines.
Si l’abbé Roubaud incrimine la prolifération des hautins coupables selon lui de la baisse de la qualité du vin, ce serait en réalité, selon Jean Loubergé, les plantations de vignes en plaine. En effet, vu que la consommation de vin s’accroît par la prolifération des cabarets et des tavernes à partir de la fin du XVIIe siècle, de nombreux individus remplacèrent la culture de grains par celle de la vigne plus lucrative alors que des édits à l’encontre de cette pratique se multipliaient à partir de 1728. Une autre explication s’ajoute et qui est donnée notamment lors d’une délibération des Etats de Béarn le 11 mai 1753 : « Dans les coteaux la dureté des terrains, la pente et la qualité de la plupart des vignes, qui sont basses et échalassées, obligent à faire les travaux à bras et on y revient jusqu’à trois fois. Le coût de cette culture excède infiniment celui des vignes hautes situées dans les plaines, qui se fait avec le bétail, et à l’égard desquelles on épargne les échalas parce qu’elles sont appuyées sur des arbres. » 28
Le rendement de ce vin de moindre qualité va entraîner l’intervention des Etats de Béarn soucieux de maintenir une bonne qualité. Ils fustigent ces viticulteurs qui plantent en hautier dans les plaines. L’origine provient d’une réclamation exercée par des particuliers envers un propriétaire se rendant coupable d’avoir planté en hautier après avoir clôturé le terrain interdisant ainsi tout pacage.
Ils convainquent le Parlement de Navarre de prendre un arrêt à leur encontre ce qui sera fait le 5 avril 1727. Les fautifs « dans les plaines, landes et artigues, propres à porter du grain du foin et sujettes au pacage commun à fruit cueilli... » sont priés d’arracher les ceps incriminés. Cette affaire fait grand bruit dans le royaume puisque le Conseil royal s’en saisit et étend l’interdiction le 5 juin 1731 dans tout le pays.
Mais en Béarn l’arrêt eut peu d’effet car on constata que très peu de plants furent détruits malgré l’insistance des Etats de Béarn lors des périodes de mévente.
Mais ce ne furent les seuls motifs de contrariété pour les Etats, l’autre cas épineux consistait pour des viticulteurs ou des négociants en vins de contrefaire la qualité en obtenant du « moût ». Cela consistait à obtenir du raisin non fermenté soit par pressurage soit par foulage, ceci permettant une fermentation alcoolique. De plus, ils ajoutaient du soufre. D’autres mélangeaient le vin béarnais à d’autres vins notamment de Bigorre...La vente au détail s’avérait en partie responsable de ce problème.
Une lettre des Etats de Béarn adressée au ministre des Affaires étrangères, M. de Saint-Contest, datée de 1753 illustre bien le souci des institutions béarnaises de réagir mais qui incriminent les petits vignerons : « le vin des vignerons partiaires ou petits fonciers, souvent peu attentifs à soigner leurs vignes et mélangeant leur vin avec du vin provenant des treilles et hautins, est inférieur à celui des gros fonciers qui donnent le plus d’attention à perfectionner leur vin » 28 N’oublions pas que les membres de ces Etats de Béarn sont des notables , notamment des nobles.
Christian Desplat pointe le délicat problème de la « querelle entre grands propriétaires et petits viticulteurs ». Il précise que durant la période comprise entre 1720 et 1740, des arrêts du Parlement de Navarre condamnent des communautés coupables d’avoir taxé le prix du vin entraînant l’uniformisation du « prix en ne distinguant pas les qualités ». 29
Ces fraudes étaient facilitées par le fait que les Béarnais commercialisaient peu leur production. De plus, se posait un autre problème, celui touchant la contrefaçon du contenant.
Les courtiers sont aussi les responsables de la mauvaise qualité du vin. Cherchant à gagner de l’argent en le vendant dans les villes, ils arpentaient le monde rural à sa recherche et en l’achetant à un moindre coût.
Tout ce trafic d’ailleurs rendait douteux le rendement lucratif de ce négoce par la voie d’eau vu les dangers encourus : les dangers de la navigation, le nombre important des intermédiaires...En effet, ces derniers eurent tendance à se multipliaient alors qu’auparavant les Hollandais venaient par eux-mêmes visiter les vignobles et faisaient affaire avec les viticulteurs.
Ce dit négoce connaissait des fluctuations causées par le contexte économique et commercial avec l’Europe notamment avec l’Espagne. Par exemple, au moment de la guerre de Succession d’Espagne de 1701 à 1714 l’Intendant de la province Lebret écrit : « Lorsque la guerre a interrompu ce commerce , on a bien reconnu qu’il était le seul qu’il fît venir de l’argent ou, pour mieux qu’il conservât celui qu’il y était ; les lettres de change que les marchands hollandais laissaient en Béarn en paiement du vin qu’ils chargeaient à Bayonne, servaient facilement à faire les remises d’argent qu’on n’a pu faire depuis la cessation de ce commerce qu’en voiturant à Paris, les espèces , à Bordeaux et ailleurs, ce qui a épuisé ce petit pays. » 6
Un courtier de Bayonne nommé Moracin écrit en 1747 à un viticulteur du Vic-Bilh, M. de Ger d’Angosse, baron de Corbères : « le commerce des vins avec l’étranger est un billet de loterie. » 30
Le commerce du vin est une préoccupation des Etats de Béarn qui multiplient les règlements comme on l’a vu. Ce qui prouve ce souci de leur part est la création constante d’une commission des vins lors de leurs tenues. Le 20 mai 1739, ils se penchent sur le cas des futailles et décident que « la barrique doit contenir 100 pots de Morlaàs. Elle doit être de forme ronde, de grosseur proportionnée, sans être rehaussée à l’endroit de la bonde, ni enfoncée à l’endroit opposé, ni aplanie sur les côtés, les contrevenants seront punis selon la gravité des cas. » Cette implication des Etats s’explique par le fait que plusieurs des membres de l’assemblée étaient des propriétaires de vignes. D’ailleurs, ils s’arrangeaient à faire coïncider la période des vendanges à celle des vacances des Etats.
Soucieux de faire rentrer des revenus frais en Béarn, les Etats de Béarn décident donc de procéder à une « politique de qualité au bénéfice des grands producteurs du Vic-Bilh (Madiran) et du Jurançonnais. », pour y parvenir il faut faire disparaître « les petits vignerons des plaines et leurs mauvais vins par une politique répressive et monopolistique... » .
Ils s’adressent en 1740 à l’Intendant Jean-Nicolas Mégret de Sérillyafin qu’il fasse pression aux jurats des différentes communes viticoles des plaines de jeter bas les clôtures et les pieds de vigne dressés depuis l’année 1718. Mais leur tentative se heurte à l’inertie desdits jurats qui craignent l’hostilité des propriétaires les plus importants et les arguments des principaux intéressés prétextant faussement que leurs vignes, leurs hautins et leurs clôtures dataient de bien avant cette date.
Persistant à chercher un appui auprès des hautes autorités, les Etats de Béarn s’adressèrent, comme cela a été écrit plus haut, au ministre des Affaires étrangères en 1753, M . de Saint-Contest. Dans leur lettre, ils tentaient de démontrer que la qualité de leur vin était bien supérieure à celle des régions avoisinantes, la Chalosse et le Tursan. 28
Pensant que ce dernier, ancien Intendant d’Auch, serait à même de les aider lors des ventes du vin de la province à l’étranger, ils constatent qu’il en est rien.
Ils s’enquièrent alors « de nouveaux débouchés », ce qu’ils réussirent à faire en Europe du Nord. Les communautés s’y opposèrent jusqu’en 1740 mais lorsque survinrent « des crises de surproduction en pénuries » et la concurrence des « vins de Bigorre, elles se résignèrent ensuite à l’arrachage. » A cette dite concurrence du vin en provenance de Bigorre s’adjoignait celle de la Chalosse que l’on qualifiait les deux de « mesclagne ». 31
Les Etats de Béarn, soucieux comme nous l’avons constaté de faire la promotion du vin de la province, cherchèrent à toucher le marché de la Baltique vu que la compétition des négociants bordelais et bayonnais s’exerçait sur les marchés des Provinces-Unies et du Royaume-Uni. Ceci d’autant plus qu’il s’avérait que le vin béarnais n’avait plus en Hollande la réputation d’autrefois. Cela incombait à la contrefaçon exercée par les intermédiaires et des Hollandais qui leur vendaient « des vins ordinaires de Bayonne », c’est-à-dire mélangés avec du vin de Chalosse, du piquepoul. 32 D’autre part, depuis le milieu du XVIIe siècle, les élites européennes disposaient d’un large éventail de nouvelles boissons, délaissant les clairets pour consommer des boissons « exotiques » par exemple le curaçao, le chocolat, le porto…
On tente de trouver de nouveaux débouchés sur la Baltique. C’est le viticulteur de Saint-Faust et agronome qui est choisi comme commissionnaire des Etats de Béarn. Tonon s’embarque pour Hambourg sur le navire hollandais « L’Amitié de Hambourg » .Il emmène avec lui seize barriques de vin blanc et trente barriques de vin rouge, le point commun étant qu’ils provenaient de la dernière récolte Un tiers provenait du Vic-Bilh et le reste du Jurançon. Il réussit à faire apprécier ledit vin. A côté de ces barriques, il adjoignait six autres barriques de vin vieux , répartis comme suit, la moitié blanc et l’autre rouge.
A Hambourg, il constate que la ville s’approvisionne à Bayonne que pour seulement 1/8e de sa consommation, il apprend également que le vin béarnais ne représente qu’un quart des barriques exportées de la ville basque. Le restant est composé de vins des régions alentours c’est-à-dire de la Bigorre, de la Chalosse et d’Armagnac. Ce qui intéressait les négociants d’Hambourg était de vendre du vin de grande consommation d’où la pratique du mélange. Pour ce qui était du vin de qualité, celui de Bordeaux suffisait. 33Apprenant qu’à Stralsund, ville suédoise à l’époque mais actuellement située dans la région du Mecklembourg-Poméranie Occidentale, dans le Nord de l’Allemagne, il y a une opportunité à saisir, il y va. Il constate que le port de la ville est situé favorablement et que les droits d’entrée perçus sont peu élevés. Le vin est une boisson chère et explique qu’il est peu consommé d’autant plus que les négociants allemands qui les leur fournissent leur vendent du vin de médiocre qualité. Avec des négociants suédois, il projette de créer une association entre deux compagnies, l’une formée dans la ville même et une autre à Pau par les Etats de Béarn. A son retour, le 4 février 1780, il fait son rapport mais les Etats de Béarn, inquiets, prennent peur de cette formation d’une entreprise « multinationale » et ne s’engagent pas plus loin. Par contre, ils le poussent à créer une compagnie privée pour son compte.
Ce qu’il entreprend puisque la « Compagnie Patriotique pour le commerce des vins du Béarn » naît avec un capital s’élevant à 100 000 livres et ayant son siège à Pau. Il traite sans intermédiaires avec les négociants suédois. Le gouverneur de Gramont en sera l’un des plus importants souscripteurs ce qui encouragea d’autres personnes.
Mais les « troubles politiques » (la guerre avec l’Angleterre, la Révolution), la mauvaise gestion de Tonon, ses spéculations risquées, les récoltes excédentaires qui suivirent mettent fin à l’affaire n’enrichissant guère personne. L’assemblée générale des actionnaires, le 22 janvier 1783, décréta la liquidation.
Le seul avantage procuré est le débouché ouvert vers l’Europe du Nord pour le vin béarnais.
Les Etats de Béarn tentent de réagir et cherchent à solliciter l’appui d’hommes influents tels des ministres. A travers les archives, on note en 1786 l’acquisition de 3 500 bouteilles de vin du Béarn à destination du Contrôleur général des finances Calonne, du Ministre des Affaires étrangères Vergennes…ceci pour un montant s’élevant à 1 362 livres 6 sols. 34 Nous sommes alors à l’époque de la signature du traité de commerce Eden-Rayneval signé avec l’Angleterre rétablissant la liberté de négoce entre les deux Etats.
Mais la vente du vin connaît beaucoup de difficultés expliquant les demandes d’exonération des charges lors des cahiers de doléances de 1789 de plusieurs communautés du Vic-Bilh.
Sous la Révolution, la viticulture béarnaise ne connaît pas d’essor et les événements se déroulant durant cette période n’ont aucun impact sur elle.
Christian Desplat 35 écrit que « si par la règlementation et les encouragements les Etats avaient sauvé le vignoble des grands propriétaires, ils n’avaient pu remédier à la nullité du négoce local et à l’inertie de la masse des vignerons. En 1789, les Béarnais n’avaient toujours aucun grand cru à proposer sur les marchés internationaux ; l’appellation « Jurançon » n’était qu’un terme générique... ». Ce vin étant plus connu à l’étranger, son nom était utilisé pour tous les vins béarnais vendus.
« En 1786 les Etats constataient la stagnation « presque absolue du commerce de nos vins » et les petits vignerons du Madiranais... » et n’hésitaient pas à clamer leur déception alors que les années 1785 et 1786 représentent dans la production béarnaise des années de récoltes excédentaires.
Le vignoble devait connaître une croissance indéniable sous la Révolution et le Premier Empire. La surface des terres consacrées à la viticulture va passer, en effet, de 18 525 ha en 1788 à 23 175 ha en 1828 ce qui représente une augmentation de 4 650 ha.
Quel est le constat ? On peut déplorer le problème du transport insuffisant (manque de rivière), un coût de production qui se ressentait justement des transports « lents et chers », un « négoce local « manquant « de dynamisme et de capitaux », la trop grande inégalité avec les vins bordelais.36
Jean Loubergé loue l’action de personnages comme le baron de Corbères, de Péborde de Pardies et de Tonon mais reproche à la société béarnaise de l’époque de ne pas les avoir totalement soutenus. Il cherche des causes et pointe le souci dominant des individus « d’occuper une fonction parlementaire ou administrative, assortie d’un bon domaine foncier avec si possible un titre de noblesse (toutes choses qui s’achetaient) et de vivre bien tranquillement sur cet acquit. » En comparant les deux viticultures que sont celles du Béarn et de Bordeaux, il écrit que la première a manqué d’un « négoce puissant et organisé » et il dénonce les exportateurs bayonnais, malheureusement incontournables, qui sont en partie responsables de la baisse du « renom des vins béarnais sur les marchés étrangers ». 37
Analysons particulièrement le Vic-Bilh pour illustrer cette analyse. Pour connaître l’histoire du vignoble de cette région, les historiens sont contraints de se contenter de documents datant du Moyen Age, du XIe siècle pour être plus précis. Ce sont des Bénédictins en provenance de Bourgogne qui introduisent des plants de « pinot ». Lorsque la ville de Morlaàs est choisie comme capitale de la vicomté, les nobles et les bourgeois se tournent vers ce vignoble pour acheter et consommer le vin. Aux XIIe et XIIIe siècles, il est même exporté en Angleterre et dans les pays de l’Europe du Nord. Ce débouché devient une source de revenus substantiels pour cette région souffrant d’une insuffisance de ses cultures vivrières aux XVIe et XVIIe siècles. Le paradoxe résultait de la vente d’un vin de qualité et de l’achat d’un vin de consommation courante de piètre qualité en provenance notamment de la Bigorre.
Le vin récolté était estampillé d’une marque, une partie était consommée sur place, une autre envoyée à Paris et une autre, enfin, transportée jusqu’à Saint-Sever par des bouviers, de là des bateliers les chargés d’abord dans des petits bateaux jusqu’à Mugron, port de l’Adour en Chalosse, déchargés puis rechargés dans d’autres plus grands jusqu’à Bayonne. A partir de la ville basquaise, des courtiers s’occupaient de la vente et du transport avec des négociants anglais ou allemands.38
c- Comment les vignes étaient-elles travaillées ?
Il faut rappeler qu’à l’origine, la vigne est une liane qui s’élève le long des arbres, le plus souvent fruitiers, à des dizaines de mètres de haut. On les raisins étaient petits et acides ce qui le rendait impropre à la consommation comme vin. Ce qui n’empêche pas qu’on le cueille durant la période du Néolithique inférieurs ce qui correspond entre - 500 000 ans et - 120 000 ans. Ce sont les hommes du Néolithique qui, en tant que boisson, s’en serviront dans leurs pratiques religieuses et funéraires.
En Béarn, on plante la bouture de vigne près d’un arbre fruitier, en occurrence un pommier ou un cerisier. Ce procédé perdurera aux alentours d’Oloron durant longtemps puisqu’on le retrouvera jusqu’à l’ère contemporaine.
Autre procédé, l’usage de grands hautins que connaissaient les Grecs sous l’Antiquité est quelque peu modifié puisqu’il s’agit d’utiliser des échalas de 3 ou 5 m de haut et de palisser la vigne à environ 2 m du sol. L’écartement moyen des rangs s’échelonnait entre une largeur allant de 80 cm à 3 m selon les zones où on pouvait pratiquer des cultures.
Jean Loubergé 22 , lui, mentionne qu’il existe à l’époque trois façons de cultiver la vigne : « soit en taille basse, les ceps ne dépassant pas 50 cm de haut, soit en taille haute, avec des échalas très longs, ou bien en treille, soit en associant les ceps à des arbres et en laissant les sarments grimper le long des branches, façon couramment usitée en Italie parfois dans le Midi méditerranéen français. »
Il ajoute qu’au début, c’est la première manière qui était privilégiée, celle en taille basse, mais qui fut peu à peu délaissée par la faute, entre autres motifs, des dégâts opérés par les chiens suscitant de la part des communautés des règlements coercitifs. Il constate que les hautins sont plus fréquents dans les appellations à partir du milieu du XVIIe siècle.
Un Bordelais, lors de son voyage en Béarn, en juin-juillet 1765, écrit qu’en sortant de Pau en direction de Bétharram il a été attiré par la vue de « choses nouvelles ». Ces dernières correspondent à « l’ordre et la figure des vignes de ce pays…Ces vignes qu’on nomme hautains, sont plantées au pied et en même temps que de jeunes cerisiers, qui, à mesure que ceux-ci croissent, s’élèvent sur leurs têtes. Ces cerisiers n’ont pas au-delà de cinq à six pieds de tige, et on ne laisse jamais monter avec leurs branches au dessus de dix à douze pieds. Ces arbres sont plantés au cordeau en quinconce. Les pampres des vignes qu’ils soutiennent, conduits de l’un à l’autre, forment une espèce de treille, dont l’ombrage n’empêche pas le froment, le lin, les pois et autres légumes qu’on sème par-dessous d’y croître parfaitement. Les labours qu’on donne à ces semences sont presque les seules façons qu’on donne à ces sortes de vigne, qui dit-on, produisent abondamment. Ainsi sont plantées toutes les vignes du Béarn, de la Chalosse et de la Bigorre, dont le vin, soit que cela procède du terrain, d el’espèce du plant ou de la manière d’en faire la culture, est d’une qualité généralement très inférieure à celle des vins de Bordeaux. » 39
Jean Loubergé fait référence également à l’utilisation d’érables comme tuteurs dans le Jurançonnais. Il explique que l’usage de cerisiers et d’érables présentent l’avantage d’avoir un feuillage « pas très touffu, ce qui ne nuisait donc pas à la maturité uniforme des raisins ; peut-être aussi parce que ce ne sont pas des arbres exigeants, enlevant à la terre beaucoup d’éléments nutritifs, ce qui permettait aux ceps de ne pas trop souffrir de la concurrence. »
Le même auteur ajoute que durant le XVIIIe siècle les vignerons (bigneroun, bigné) béarnais employèrent de plus en plus les hautins notamment dans le Jurançonnais, par contre, dans le Vic-Bilh les vignes « dominent dans la plupart des localités, sauf à Aurions-Idernes. »
Les vignes « réclamaient un travail intense ». Le terrain est défoncé et aérer à la charrue, à la pioche ou la houe au mois de mars généralement. Cette dernière est une lame de 30 centimètres de long sur 20 de large arrimée à un manche. En ce qui concerne le travail à la pioche : « (fosse, d’où l’expression obres de fosse pour la viticulture) on chaussait l’hiver le pied du cep (toujours contre la gelée) et le déchaussait au printemps. » Le quadrillage des échalas (« paüs » ou « pachets »est effectué selon les lieux soit à la bêche soit avec un bâton à fouir (appelé « chanque ») équipé d’un repose-pied pour la réalisation des trous. « Retenues par des nœuds d’osier, les lianes étaient taillées (talhar), les feuilles et les grappes débarrassées plusieurs fois de la vermine (espedollhar) ; le provignage assurait le renouvellement des ceps. Il est nécessaire d’effeuiller les pampres afin de permettre au soleil et à l’air de dispenser leurs bienfaits.
Généralement, le vigneron binait au printemps et en été avant les vendanges.
Jean Poueigh écrit que la taille s’effectue à l’aide de deux outils, la serpe ( poudaidouro) ou les ciseaux .D’après lui, elle est la « tâche la plus importante et la plus délicate ; selon le cas, il lui faut laisser à la vigne un pou plusieurs nœuds (douna li longo). 40
La vendange débutait plus tôt que maintenant, début septembre car toutes les redevances en vin étaient versées pour la Saint-Michel (29 septembre). » 41
Dans le tableau Annuel Historique du Béarn, Année 1786, on note : « ...l'automne seule est communément belle et semble faite tout exprès pour ces raisins délicieux d'où découlent le Jurançon, le Gan, le Vicbilh, le Monein, tous ces vins, les uns délicieux, les autres robustes, auxquels il ne manque que d'être encore plus fidèlement connus pour aller...nous subjuguer en quelque sorte l'Univers. ».
Les tâches se déroulaient par étapes.
En premier, les coupeurs (« brignayres ») posent les grappes dans des paniers en bois nommés « semaü » puis dans une cuve (« cubet ») .
Jean Poueigh mentionne que dans cette catégorie de travailleurs les « femmes jeunes et vieilles » dominent tandis que les « garçonnets et les hommes âgés, sont munis du coutél poudalou, couteau recourbé pour couper les raisins, ou de la piquèto, toute petite serpe servant uniquement à cet usage, et du panié vendémiadou, panier qui les recevra. »
En second, le même auteur écrit que le porteur, un homme généralement (« gourbetaire »), peut porter sur son dos la hotte à bretelles (brèto, gourbèto, gourbilho), puis « du panier les grappes passent dans la hotte et sont versées ensuite dans la comporte (semal…), vaisseau de bois cerclé, dont deux dépassants de bois – espèce de tiges placées à l’opposite l’une de l’autre – formant les anses ou poignées. » Deux hommes viennent alors la prendre soit à l’aide des mains soit en utilisant deux bâtons passés sous une anse.
Dans le premier cas, un porteur vient récupérer le raisin de ladite cuve qu’il met sur sa tête, leur poids pouvant atteindre près de 30 kg.
Dans les deux cas, on amène les grappes au pressoir en usant des chariots ou des traineaux, pas de caves mais des chais servant le dépôt et le travail du raisin. Là, il sera foulé avec les pieds nus. « Les fouleurs se mettent alors à troulha la vendange… » 42 Le jus obtenu est versé dans des futailles.
Si on utilise un pressoir, l’instrument employé est « monté sur trois roues, avec vis en bois, lou destré ou trelh, au moyen duquel se fait le destrégnage. Lorsqu’il y a lieu d’égrapper les raisins, on se sert d’un outil disposé à cet effet et également en bois, le degaspadou ou escarpadou. »
Le travail s’effectuait essentiellement à la main. L’érosion, la pente entraînaient invariablement la terre arable dans le bas du vignoble contraignant les viticulteurs à la remonter par différents procédés, soit en usant d’une grande pelle nommée « ravale » , soit de paniers ou encore de traineaux. Après la taille, le viticulteur doit veiller à remplacer les échalas détériorés.
Ces différentes tâches étaient entrecoupées de moments de repos « pris aux heures du déjeuner et du goûter (brespalh). 42
« Différentes manières de lier la vigne à l’échalat »
Tiré de l’Encyclopédie de Diderot, tome 1 Agriculture.
Si au début de l’époque moderne, le vin correspond à un clairet que les négociants tentent de vendre le plus rapidement possible car il ne peut que se conserver qu’une année généralement, on prend l’habitude d’ajouter des épices et de l’alcool pour augmenter sa préservation. A partir du XVIIIe siècle des pratiques permettent de le conserver plus longtemps. On use des barriques de meilleure qualité et de la technique dite de la « mèche soufrée » afin de les désinfecter. En effet, on brûle dans un tonneau vide une mèche soufrée pour éliminer les bactéries. Cette technique est avérée en Médoc vers le milieu du XVIIIe siècle. De plus, on utilise le collage au blanc d’œuf ou de la colle de poisson pour la clarification et le fouettage avec un fouet en crin des blancs d’œufs pour les mélanger au vin .La pratique du « collage aux blancs d’œufs » - le vigneron utilise une écuelle de bois pour battre en neige douze à dix-huit blancs d’œufs – permet d’expédier les impuretés au fond de la barrique. On fabrique des bouteilles en verre plus résistantes notamment à fonds épais que l’on ferme par des bouchons de liège plus hermétiques remplaçant les chevilles de bois entourées d’étoupe.
Si la qualité du vin dans son ensemble s’est amoindrie, il faut nuancer et écrire qu’il existait du vin de qualité supérieure bien entretenu par des vignerons soucieux d’améliorer le goût. L’Intendant Lebret écrit que le vin béarnais avait la particularité de bien supporter le transport par mer (déjà au Moyen-âge, sous occupation anglaise, il était apprécié pour cette qualité).
Il ne faut pas oublier vu le climat qui sévit dans la province les aléas fort nombreux et qui avaient une incidence sur la récolte. Le brouillard, la gelée, l’orage accompagné de grêle autant d’éléments naturels qui compromettent la récolte.
L’exemple le plus probant est celui où la grêle s’abat l’après-midi du 24 juin 1778 en Béarn, dix communautés perdent alors leur récolte. Celle de Gardin dresse les conséquences survenues : « Plusieurs de ceux qui pouvaient cultiver, même des chefs de famille prirent le parti d’abandonner leurs champs ; des pères de famille livrent leurs femmes, leurs enfants à la providence. Les métayers menacent d’abandonner les métairies. Cela fait faire de sérieuses réflexions à ceux qui en sont capables. » On peut également citer l’exemple tiré du Livre de raison de l’avocat Mourot . Nous sommes le 12 août 1770 : « …vers les deux heures de l’après-midi, jour de dimanche, il est tombé à Gère et dans le voisinage, une grêle prodigieuse, il en restoit encore le lendemain matin à dix heures, plus grosse que les œufs de pigeon. Le vignoble d’Asson a été abimé, celuy de Nay l’a été moins… ».43
Cela plus la concurrence du vin provenant de Bigorre sont autant de soucis pour l’exploitant au XVIIIe qui survit souvent grâce à la pratique de la polyculture. En ce qui concerne la rivalité entre les deux provinces, il faut savoir que les Bigourdans reprochent aux Béarnais d’interdire l’entrée aux vins des zones limitrophes surtout depuis le règlement de 1667 et la concentration de l’économie viticole dans les mains de quelques producteurs importants ceci afin d’établir des prix élevés. Les Béarnais objectent que la viticulture permet de compenser le peu de grains récoltés sur les coteaux qu’ils jugent stériles, qu’ils ont dû opérer à des défrichements importants ce qui explique que le Béarn soit quasiment couvert de vignes et que contrairement aux accusations portées par les Bigourdans cette extension a entrainé une baisse du prix au moment des récoltes abondantes. S’il s’avère que parfois il augmente, les causes proviennent de la faiblesse des rendements, les dépenses occasionnées par la main d’œuvre et les travaux pratiqués sur les pentes.
Notes :
1-Bergeret, J, Flore des Basses-Pyrénées, extrait du discours préliminaire, tome 1er, Pau, Imprimerie de P. Véronèse, an XI de la République.
2- Archives municipales de Bayonne.
3-Voyages de Léon Godefroy en Gascogne, Bigorre et Béarn, 1644-1646 / publ. et annotés par Louis Batcave, Pau, 1899, page VII)
4- Cazaurang J.J., Le maïs et sa culture en Béarn, imp. Monnaie Pau, D.L 33, 1981 p .13.
5- Mémoires de l’intendant Pinon, Bull.SSLA de Pau, 2e série, tome 33, 1905, p .42.
6- Mémoires de l’Intendant Lebret, Bull.SSLA de Pau, 2e série, tome 33, 1905,p. 121 et 122.
7- Foursans-Bourdette, M.P, Histoire économique et financière du Béarn au XVIIIe siècle, Bordeaux, Bière, 1963, p.38.
8- Parmentier Antoine-Augustin, Le maïs ou le blé de Turquie : apprécié sous tous ses rapports Paris, Imprimerie impériale, 1812, p.60.
9- Journal de l’Agriculture, du Commerce, des Arts et des Finances de 1774 de l’abbé Roubaud, publié par l’abbé Dubahat, Bull. SSLA 2e série, tome 39, 1911, p .211.
10- Desplat, Christian, Pau et le Béarn, au XVIIIe siècle, tome 1, J & D Editions, 1992, p. 34.
11- A.D.P.A., B 4552, f° 26 (juillet 1735).
12- Cazaurang J.J., op.cit., p.12.
13- Idem., p.13.
14- A.D.PA., C 72.
15- Bergeret J., Le maïs ou le blé de Turquie, Paris, Imprimerie impériale, 1812.
16- A. Alband, Moyen d’entretenir la culture des terres après l’épizootie, Pau, 1776.
17- Desplat Christian, Le maïs en Béarn au XVIIIe siècle, article tiré des plantes et cultures nouvelles, Flaran 12, Presses universitaires du Midi, 1990, p.143-153
18- Foursans-Bourdette, M.P, op.cit., p.36.
19- A.D.P.A., B 4564, f° 61.
20- Parmentier A.A., op.cit., p. 66-67.
21- Archives nationales, F20 744.
22- Loubergé Jean, article : Viticulture et viticulteurs en Béarn du XVIe au XVIIIe siècle tiré de Le vigneron, la viticulture et la vinification : en Europe occidentale, au Moyen Age et à l’époque moderne, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 1991, p. 287-294.
23- Desplat Christian : « Économie et société rurales en Aquitaine aux XVIIe-XVIIIe siècles ». In: Histoire, économie et société, 1999, 18ᵉ année, n°1. Terre et paysans, sous la direction d’Olivier Chaline et François Joseph Ruggiu, p. 149, 2002.
24- Desplat Christian, La Principauté de Béarn, Editions Marrimpouey jeune, 1980, p.26.
25- Dr Doléris, Les vignobles et les vins du Béarn et de la région basque, 1920, éditeur : Pau : R. Massignac.
26-Batcave L., Revue histoire et archéologie du Béarn et du pays Basque, n°51, mars 1914.
27-A.D.P.A., Brevet des Etats de 1742, C 785, 141 vo.
28- A.D.P.A., C 1361.
29-Desplat Christian, Pau et le Béarn, tome 1, op.cit., p.166.
30-Dr Doléris, Les vignobles et les vins du Béarn et de la région basque, op.cit., p.33.
31- A.D.P.A., C 771, f° 194 (1770).
32- A.D.P.A., C 812, f° 207.
33- A.D.P.A., C 815.
34- A.D.P.A., C 1517, C 973.
35- Desplat Christian, Pau et le Béarn, op.cit., p. 173.
36- Desplat Christian, La vie en Béarn au XVIIIe », Editions du Cairn, 2009, p. 151 et du même auteur , La principauté de Béarn, op.cit., p. 508.
37- Loubergé Jean, L’évolution de la viticulture béarnaise au XVIIIe siècle, Revue de Pau et du Béarn, n° 19, 1992, p.137 à 154.
38-Voir :Lasserre-Jouandet Simone, Le Vic-Bilh, article tiré de la Revue géographique des Pyrénées et du Sud- Ouest. Sud-Ouest Européen, Année 1951 22-1, pp. 27-54.
39- Voyage d’un Bordelais en Béarn et en Labourd (juin-juillet 1765), publié et annoté par Paul Courteault, Imprimeur O. Lescher-Moutoué, Pau, 1910, p.13.
40- Poueigh Jean, Le folklore des pays d’oc, la tradition occitane, petite bibliothèque payot, 1976, p. 110.
41- Desplat Christian, La Principauté de Béarn, op.cit., p. 474.
42- Poueigh Jean, op.cit., p.113.
43- Warnant, E., Livre de raison de Jean-François-Régis de Mourot
propriétaire terrien, Bull.SSLA de Pau, 3e série, tome 20, 1960,
p. 89.
Bibliographie :
- Jean Beigbeder, « Voyage dans l’histoire du maïs, du Mexique aux Pyrénées », société Ramond, 2011, 23 p.
- Dejean Pierre, L’exportation des vins béarnais dans les pays du nord au XVIIIe siècle (La « Compagnie patriotique pour le commerce des vins de Béarn ») article tiré de la Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine, Année 1936 11-23, pp. 212-213.
- Lachiver Marcel, La viticulture française à l’époque moderne, tiré de Le vigneron, la viticulture et la vinification: en Europe occidentale, au Moyen Age et à l’époque moderne, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 1991,p. 207-237.
- Loubergé Jean, article : Viticulture et viticulteurs en Béarn du XVIe au XVIIIe siècle tiré de Le vigneron, la viticulture et la vinification : en Europe occidentale, au Moyen Age et à l’époque moderne, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 1991, p. 287-294.
- Mane Perrine, Le vigneron, la viticulture et la vinification : En Europe occidentale, au Moyen Age et à l’époque moderne, Nlle édition, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 1991.
- Pierre Tauzia, Le maïs dans les Pyrénées-Atlantiques, des origines à la révolution agricole 1530-1939, Pau, CDDP des Pyrénées-Atlantiques, 1978, 48 p.
-
Par Michel64a le 12 Décembre 2020 à 12:38
L’OUTILLAGE AGRICOLE ET LES MOYENS DE TRANSPORT AGRICOLES EN FRANCE ET EN BÉARN AU XVIIIe SIÈCLE
A) L’outillage
Au sujet de l'outillage agricole, en France, il est traditionnel.
On cite souvent l’agronome Henri Louis Duhamel du Monceau auteur notamment en 1760 d’un « Traité sur la culture des terres » qui, en analysant la France agricole de son temps, écrit : « Ce royaume a près de moitié de son terrain en friche, l’autre moitié est si mal cultivée en général qu’elle rapporterait au moins le double si elle était travaillée convenablement ». Les historiens sont d’accord pour certifier que ce sont des propos excessifs.
Planche et légende de "L'agriculture, labourage", tirée de l'Encyclopédie de Diderot. (source:http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie)
Mais ce qui est sûr, afin de lutter contre la nature et s’assurer une production agricole, les moyens utilisés sont les animaux domestiques et des instruments généralement en bois avec quelques pièces de métal. En ce qui concerne les animaux, il peut s’agir de chevaux, de bœufs, de mulets, d’ânes, de vaches. Depuis la Préhistoire, les hommes ont domestiqué ces bêtes de trait Antoine Lavoisier 1 nous a dressé un dénombrement pour la France : 7 millions de bovins, 1 780 000 de chevaux.
Le laboureur utilise les instruments aratoires légers et peu onéreux relevant davantage d’une industrie que l’on pourrait qualifier de domestique. Dans le Nord, on emploie majoritairement la charrue (et si on se localise dans un bassin sédimentaire propice à une plus grande prodigalité, on utilise plus volontiers l'assolement triennal et la monoculture) et dans le Sud l'araire (les céréales voient leur importance moins prépondérante parallèlement à d'autres cultures comme l'arbre fruitier, dans le Midi, l'assolement biennal domine). Posséder un araire ou une charrue est un signe de fortune, car cela suppose que le propriétaire possède également un attelage et de quoi le nourrir, on l’appelle le « laboureur » et, de ce fait, il est amené à louer aux autres villageois qui n’en ont point.
Qu’attend-on par assolement biennal ? C’est une division des terres d’une communauté villageoise en deux parties nommées soles. Une sole est occupée un an par une culture tandis que l’autre est laissée en jachère. La jachère consiste à laisser en repos une terre pour qu’elle puisse reconstituer ses éléments fertilisants. Chaque année, le cercle tourne sur lui-même. Concrètement, tous les paysans d’un village donné tiennent des lanières de terre dans les deux parties. On sème la même plante dans la sole cultivée. Pour marquer ces lanières afin de les distinguer, on use d’un double sillon, d’un rejet de terre... On cherche à permettre la possibilité de faire un demi-tour à l’araire ou à la charrue. Pas de haie, pas de clôture.
On pouvait également abandonner une sole pour la friche et diviser la seconde sole en deux moitiés, l’une semée à l’automne et l’autre au printemps. Ce dernier cas s’apparente fort à l’assolement dit triennal, car nous sommes en présence de trois champs, mais où la friche est plus étendue.
L’assolement triennal comporte trois soles comme leur nom l’indique, deux parties sont cultivées, l’une est semée à l’automne ou en hiver (céréales comme le froment, le seigle, le méteil ou l’épeautre), l’autre est occupée au printemps (céréales ou marsages - ou de mars - comme l’orge, l’avoine, le millet ou le sarrasin…) et la dernière est laissée en friche. Comme pour le précédent assolement, il y a rotation des cultures sur trois ans. Ce système a l’avantage de réduire la surface des terres en jachère.
Dans la plaine de Nay, à Mirepeix notamment, les trois soles se disposaient parallèlement les unes par rapport aux autres et ceci transversalement au gave de Pau.
On retrouve ce type d’assolement dans la plaine de Nay et particulièrement à Mirepeix, analysé par Yves Suarez (voir partie bibliographie).
Selon cet auteur, il serait à l’origine de la « dispersion et du morcellement des terres » obligeant le paysan à des « déplacements incessants ». Il cite le chiffre de cent vingt et un tenanciers qui devaient se partager deux cent vingt-cinq hectares ».
Ces deux systèmes dépendent d’un accord commun des villageois pour entreprendre les labours, les semailles et la moisson, d’où la mise en place de règles communautaires, de multiples droits dont la vaine pâture, le glanage, le chaumage…, l’usage des biens communaux… Ces décisions sont prises lors de l’assemblée générale échevinage dans le Nord, jurade en Béarn… qui se réunit plusieurs fois par an.
Lorsque s’opéraient les semailles, l’assemblée villageoise nommait un gardien - appelé "garde de la plaine" ou "gardien des landes" à Mirepeix - afin que le finage soit respecté. Les soles nouvellement ensemencées étaient alors délimitées par des barrières mobiles ou fixes nommées « clèdes » notamment pour interdire l’accès au bétail jusqu’à la moisson. Cette action porte alors le nom de « veter » ou « better ». Le rôle du gardien était également d’empêcher les maraudeurs et les animaux nuisibles de sévir, il pouvait alors verbaliser. Pour ceux qui outrepassaient le règlement en laissant leurs animaux pénétrer dans « une lanne bettée » se voyaient contraints de payer le « droit de penhère », la saisie. Sa fonction était des plus ingrates vu que ces gens qu’il connaissait pouvaient lui en vouloir.
Si les lanières de terre sont la propriété individuelle des paysans, elles sont réparties inégalement. Plusieurs d’entre eux sont en possession de quelques-unes.
a- L’araire et la charrue : généralités
L’araire est dépourvu d’avant-train roulant (appelé « aratrum » par les Romains), son usage s’effectue sur des sols nus ou peu gazonnés. Des spécialistes actuels rejettent l’idée que l’on lit encore trop souvent à leur goût que son principal défaut réside dans le fait qu’il ne creuse pas profondément le sillon et qu’il rejette sur les côtés la terre émiettée. 2
Araire : Musée du château de Lourdes.
Le soc est fréquemment en bois, parfois enrobé de métal pour éviter l’usure, pointu, de forme conique et est composé de trois parties. L’age est une pièce de bois de chêne ou d’orme de forme cintrée s’assemblant dans ses parties inférieure et supérieure à la flèche - barre de saule ou d’ormeau servant à l’attelage. Dans la partie médiane de l’age, le coutre s’insère par le biais d’une mortaise. Le mancheron (simple ou double) sert à l’homme à guider l’araire et le sep, porté par l’age, est l’élément qui pénètre la terre. Ces différentes pièces sont assemblées par le biais de tenons et de mortaises.
A l’opposé, la charrue à roues possède un soc dissymétrique (puisque tous les éléments sont du même côté de l’age), un versoir qui a pour fonctions à la fois d’enfouir les mauvaises herbes, d’aérer la terre et de la rejeter d’un seul côté. Dans le Gers, le versoir est un bois d’orme de figure trapézoïdale, avec le soc, il est placé à quarante-cinq degrés. La charrue possède un avant-train muni de roues régulant ainsi la largeur et la profondeur du sillon (remplacé actuellement par le tracteur), parfois d’une rasette afin de nettoyer le sol avant qu’il soit retourné, d’un coutre en fer qui pourfend la motte de terre. Elle est plus adaptée au sol gazonné, aux terres grasses et limoneuses.
Pour diriger l’instrument aratoire, le laboureur utilise deux moyens, le levier intégré dans la mortaise de l’age et qui, dans sa partie postérieure présente un manche par lequel avec sa main droite le paysan conduit, incline l’instrument et, également, le marche-pied inséré lui aussi dans la mortaise de l’age. Avec son pied gauche, l’homme peut enfoncer et diriger la charrue.
Sinon, on est contraint d’utiliser les bras.
Jusqu’au XVIIIe siècle, la culture à bras se maintient. Elle est présente aussi bien dans les vignobles, mais aussi dans les zones de culture intensive. Dans le Nord, en 1801, « 7 % des terres et des jardins sont encore labourés à bras » alors que la culture à bras est perçue comme « développée », 3 avec comme outils rudimentaires la houe par exemple. La faux (répandue à l’époque romaine et étendue au Moyen âge) est très utilisée dans le Nord de la France (utilisée en Flandre au XVIe siècle) mais s’est répandue lentement dans le reste du royaume. La faucille (« faus » en Béarn) est employée ailleurs. Elle scie les blés à une hauteur d’environ 60 cm du sol, ce qui a l’avantage d’abandonner au bétail le chaume. Pour séparer l’enveloppe de la graine, on use du fléau sur un espace dénommé aire (mais cela pose un problème pour les journaliers qui lorsqu’on utilise la faux cela leur procure moins d’heures de travail et donc de salaire ; de plus, on use davantage de métal et on provoque une perte de grains et de pailles ). Le problème le plus grave est le peu d’importance du fumier. Ces pratiques archaïques occasionnent des rendements insuffisants, dans certaines régions, on arrive à récolter 2 ou 3 grains pour 1 grain semé.
En France, la production agricole dans son ensemble est plus destinée à l’autoconsommation plutôt qu’à la vente, ce qui explique que l’importance de la céréaliculture. Il ne faut point omettre que le pain est l’aliment de base du peuple et que de ce fait les autres productions paraissent moins importantes, on pense au lait, aux fruits…
Bien entendu, la céréaliculture n’était pas totalement l’apanage de l’agriculture, les paysans soucieux de fournir des marchés s’adonnaient à d’autres cultures considérées comme alternatives comme la viticulture. George W. Grantham cite les chiffres de 2,3 millions d’individus en 1787, ce qui représente 8,2 % de la population totale. A cela, il faut ajouter les plantes qui servaient comme matières premières industrielles comme le lin…4
A côté de ces outils, on peut encore adjoindre la bêche, la fourche, le trident... et tous ceux spécialement conçus pour des tâches bien déterminées, notamment dans le travail de la vigne...
L’élevage apparaît comme une activité dépendante de la culture puisque les bêtes servent soit pour tracter les outils agricoles, soit pour produire du fumier ; en France, l’élevage, seul, est exercé dans quelques parties de la France.
Dans le Béarn, pour labourer la terre dans le but de cultiver du maïs par exemple, il est nécessaire que la météorologie soit clémente et la terre favorable. Les travaux se feront le plus rapidement en raison des aléas climatiques, pour cela s’exerce une entraide, « au tourne-fournàu ».
L’outillage utilisé par les Béarnais est rudimentaire et peu onéreux.
Ci-dessous, les planches traitées par l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert concernant les charrues, à titre de témoignage de ce que l'on utilisait, en partie, à l'époque.
Deux planches et légendes qui illustrent les 2 types de charrue (à versoir et à oreille), planches tirées de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. (source:http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie).
Le paysan utilise le coutre (« coudreya » ou « coudrédre »). C’est un fer, mince et large si possible, coupant la terre verticalement et qui a l’avantage d’extirper le sol des mauvaises herbes. Son usage consiste à permettre le soulèvement de la terre avec le soc et le versoir. En effet, on utilise ensuite l’araire (« aret », du latin « aratrum ») à manche-sep qui reste l’outil le plus utilisé au XVIIIe siècle (le mancheron et le sep ne forment qu’une seule pièce, le manche-sep s’avère plus mobile, moins lourd). L’araire et le coutre sont séparés comme on le voit en Europe du Sud et ce jusqu’au siècle dernier. Cet usage de deux instruments a d’ailleurs été critiqué par les agronomes au XIXe siècle. Il est tracté alors par des vaches ou alors par des bœufs, des mulets. Les femmes, les enfants sont sollicités pour ramasser les galets encombrants ou les herbes arrachées.
Ce type d’araire est fabriqué en bois, le soc (« bôme » ou « boumé », du latin « vomer ») est effilé et comporte deux oreilles de bois et est assujetti à un bâti de bois. Il permet de fendre alors horizontalement la terre. On a souvent critiqué cet instrument en montrant que le travail effectué par lui était loin d’être parfait. On a montré qu’il occasionnait aux animaux un surcroît de tirage.
Voici ce qu’écrit Jean Poueigh en décrivant cet instrument : « L’ancienne charrue (arêt, araire) était en bois. Elle se compose du coutre (befèrri), couteau qui fend la terre ; du soc (réio d’araire), la pièce importante ; du versoir ou oreille (escampadoùiro) ; du sep (aramoun, dentàau, souchàdo), pièce de bois qui porte le soc ; de l’age ou haie (cambèlo, ple ou pèd d’aràire) ; des manches ou mancherons (manipo, manitoun, estèvo), comprenant le timon et sa flèche (pèrti et bacègue), le palonnier (reinard), le petit coin de bois (cavaleirou) fixant à la flèche le tirant (tendilho). 5
Si le passage de l’araire a lieu sur un terrain plat, il se fait aisément, par contre, si une pente se présente, le travail devient particulièrement fatigant.
Mais l’implantation du maïs a comme effet également d’accroître l’importance de la charrue au détriment de l’araire. Ensuite, le paysan, afin de briser les mottes de terre, use d’un outil intitulé en béarnais « cleda ».
L’araire ou la charrue, après leurs passages, laissent des imperfections, par exemple, des mottes de terre qu’on tente de disloquer avec la houe (« houssé »).
Il peut herser par ailleurs avec un instrument nommé « arrascle » composé de 16 fers de forme recourbée fixés sur un bâti en bois ou de trois dents mais plus rare. On brise les mottes aussi avec une claie de madriers nommée « cleda », vu plus haut. Ces madriers étaient parfois remplacés par des branches d’arbres, tout simplement comme l’aubépine (« brocs »). Ce genre de herse ne permet pas d’obtenir un travail parfait au premier passage, ce qui entraîne la nécessité de la repasser plusieurs fois. Il existe aussi un rouleau de bois nommé « lu rullew ».
Marguerite Rambeau mentionne dans son mémoire une sorte de herse en bois qu’elle nomme « arraskle a baws ». Elle est « surmontée d’un arc « baws » en bois de noisetier « aberané ». Dix dents plates « lus herris », plantées dans les croisillons de bois « lus tabots », sont bloquées par des coins de bois « las herriséros ». Cet outil est trainé « arrusegat ; inf : arrusega » par une paire de bœufs « u pa de bwewa » ou plus souvent de vaches « bakos », au moyen d’une chaîne « kadeno » allant d’une annueau à crochet « la teladéro », mobile sur le devant de « l’arraskle », au crochet fixé sur le joug « lu yu » de l’attelage « lu parel ». 6
Lors des travaux agricoles et notamment lors du labourage, Jean Poueigh nous rappelle que « le chant humain s’élevait de partout » et que pour « le travailleur au plein air, il était mieux, mieux qu’une distraction, un adjuvant qui facilitait sa tâche et l’allégeait » Il oubliait un temps la fatigue. « Fécondée par lui, la terre va pouvoir renaître et produire de nouveau : « Quand lou bouiè càanto, l’araire vàai bèn » (soit : "Quand le bouvier chante, l’araire marche bien"). Il rajoute que ce chant était « coupé par les pressants appels qu’il adresse aux animaux accouplés sous le joug ».7
Peu de progrès dans l’outillage, on décèle seulement deux « nouveautés » en relation avec le maïs : «... lorsque le maïs avait levé il était éclairci avec un scarificateur (arrasclet) et enfin butté avec un araire léger, muni d’un fer plat en croissant (arasèra).
L’arasclet est composé d’un coutre positionné en avant et de trois dents qui fendent la terre. Son usage est dévolu notamment dans l’entretien des interlignes du maïs. Marguerite Rambeau la décrit comme une « petite herse triangulaire » spécialement utilisée pour sarcler le maïs, en enlever les herbes. Une paire de vaches la tire par son timon, attelée à un joug spécial, d’une longueur adaptée à la mesure de l’espace entre deux ou trois rangées de maïs. 8
Quant à l’arazère, c’est un instrument qui a une double tâche, celle d’éliminer les mauvaises herbes se trouvant dans le maïs et de butter ce dernier. On le surnomme d’ailleurs le butteur. On note son existence avant l’introduction du maïs dans le Béarn. Son soc est plat et emmanché dans le sep.
Introduit en Béarn au milieu du XVIIe siècle probablement, le labour du maïs se fait en deux étapes, comme cela a été vu plus haut, on fend la terre avec le coutre et on la retourne avec l’araire. Si possible, on labourera le plus profondément.
Après ce travail, on passa la herse et on marque afin de se repérer pour les semailles avec une traverse comportant plusieurs pales selon que l’on se trouve en plaine (quatre) ou en montagne (trois). On a soin de placer cet outil en formant des lignes transversales dans le but de constituer des croix où on déposera les graines.
Autre outil en usage, la bêche. Dralet écrit : « On prépare les terres en recevant la semence du millet par deux ou labours qui s’exécutent avec une charrue nommée arrayre ; mais quelques-unes de ces terres sont travaillées à la bêche et ensuite émottées. ... ». 9
Des binages (« arades ») et des sarclages seront effectués avec la houe pour parfaire le travail.
b- Les semailles
Puis, avant de semer, le paysan réalise des tracés les plus droits possible avec le « mercader » (traverse, à trois ou quatre pales, tirée par une vache, d’abord en long, puis en large) , enfin, il passe aux semailles .
Il a pris soin, au préalable, de plonger la semence dans de l’eau afin d’écarter toutes traces de résidus comme des graines de chardon et de délimiter des bandes de terre de 5 à 10 m dans le champ sur sa longueur.
Martine Rambeau nous cite des proverbes liés aux semailles, dont l’un préconise de les faire à la « vieille lune » lors d’un vendredi (« Ow düs de la lüo, k’ey bu heyt de semya, süstut se paso pow dibes »), un autre durant quinze jours précédant la Toussaint et quinze jours après (« Lu bu semya k’ey kinze diyos aban Marteru e kinze diyos apres »). 10
L’action de semer des céréales, dans la langue béarnaise, diffère selon que le paysan sème du blé (« jeta ») ou du maïs (« pousa »).
Afin de semer l’homme ou la femme qui utilise à cet effet soit un tissu (le plus souvent un tablier) soit un récipient. A la main, il ou elle empoigne des graines que l’on jette à la volée. Il sera nécessaire de revenir sur ses pas une seconde fois pour parfaire son travail.
En ce qui concerne le maïs, avant de semer, on mélange des graines de maïs et des haricots grimpants blancs et des pépins de citrouille. De ces graines et de ces pépins, des plantes prendront appui sur les tiges, d’autres se frayeront un passage et s’accroîtront en profitant de l’ombre des feuilles.
Ensuite, ce sont les femmes qui interviennent puisque ce sont elles, portant leurs tabliers remplis de graines, qui les placent en marchant et en les faisant tomber par trois ou quatre dans la « croutz » (marque réalisée par le mercader), puis, elles repoussent la terre de leurs pieds afin de les recouvrir. Pour le dépiquage, les gerbes qui ont été attachées le plus souvent par les femmes lors de la moisson (pendant les hommes coupaient) et qui ont été dressées en verticale sur le sol dans le but de sécher le plus vite, car la pluie entraînerait forcément des conséquences préjudiciables, seront soit foulées par des juments soit battues par des perches de chêne ou de buis ou des fléaux dans un endroit appelé « lo sou de la borde » soit une aire de la grange. Ensuite, il ne reste plus qu’à vanner, jeter les grains en l’air avec la « pale-cope » soit une pelle de forme creuse prononcée pour se défaire de la paille.
On recourt ensuite à un hersage afin de niveler le terrain et de recouvrir les graines, ensuite, on passe un tronc d’arbre faisant office de rouleau par-dessus. Cette action a pour fonction d’améliorer le contact entre la terre et les graines. Cela doit être pratiqué lorsque le sol est sec sinon la terre et les graines adhéreront au rouleau. Si le poids du rouleau apparaît insuffisant, on pose des pierres par-dessus ou un enfant.
Planche et légende de "la herse", tirée de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (source: http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie)
Michel Carolo nous a dressé une étude d’instruments aratoires en Béarn à la fin du XVIIIe siècle à partir de la série Q des Archives départementales provenant d’une liste de biens séquestrés d’individus lors de la Révolution. Dans sa conclusion, il constate que « Si les terres possédées par la Noblesse étaient de superficie plus vaste, notamment par la présence de bois, les terres labourables et les vignes demeuraient exploitées d’une manière identique à celle des autres ordres. Les grandes exploitations nobiliaires étaient divisées en métairies... Peu fortunée en Béarn et Pays Basque, la Noblesse ne se distinguait pas du Clergé et du tiers Etat sur les méthodes de culture et par là même sur l’utilisation aratoire qui reste le même. »
Prenons l’exemple d’un propriétaire issu de la noblesse, un dénommé Marc-Antoine Fanget, Garde du Corps. Ses domaines s’étendent sur plusieurs communes : Thèze, Lème, Boueilh-Boueilho-Lasque, Pouriubes et Auga. La totalité correspond à 675 arpents, soit approximativement 231 ha. Si l’on s’en tient aux terres situées à Thèze, elles correspondent quasiment à la moitié, soit 324 arpents. On peut les diviser en deux catégories, la première appartenant au faire-valoir direct et la seconde au système de la métairie, sachant qu’elles sont au nombre de trois.
Attardons-nous d’abord à la première catégorie représentant 139 arpents (47,5 ha). Sur cette dite surface, on ensemence du froment, du milloc et du linet (sur 34 arpents soit 11,5 ha). Pour entreposer le matériel agricole, on utilise une grange. Ce matériel comprend trois charrettes, un tombereau, deux herses et deux charrues. Les animaux de trait sont deux paires de bœufs. D’autres outils sont recensés, utilisés également pour travailler le jardin qui environne la maison) comme « trois arrazeres, trois coutres, une bêche pointue et trois petites bêches », certains sont en fer (scie, deux faux, quatre râteaux), d’autres sont en bois (râteau à deux branches). Le propriétaire détient une forge pour une réparation éventuelle. Pratiquant de la viticulture sur une surface de 13 arpents (environ 4,5 ha), le propriétaire possède « trois pressoirs, cinq comportes, huit cuves, un entonnoir de bois et 33 bois de barrique). En plus de tous ces biens, il faut ajouter d’autres animaux, un cheval, deux juments, quatre truies et deux cochons.
Détenteur de trois métairies qui correspondent respectivement à 89 arpents (34,5 ha), 64 arpents (22 ha) et 32 arpents (11 ha), chacune comprend « une maison et une grange ». Nous analysons uniquement la métairie la plus importante, celle qui porte le nom de « Bachot ». Comme matériel agricole, on dénombre une charrette, trois charrues et deux herses utilisées à la culture des 27 arpents (9 ha) de terres labourables. Une paire de bœufs permet de les tracter, jointe à une paire de vaches, une génisse et une paire de veaux qui complètent son cheptel. Le «petit matériel rassemble une arrazere, un râteau et une fourche de fer, deux petites bêches et un coutre ». 11
Christian Desplat nous donne l’exemple d’un métayer vivant à Denguin situé sur la « ribeyre », zonne où « le matériel » était plutôt « plus abondant et plus diversifié, mais tout aussi simple et traditionnel...» Cet homme, métayer et vicaire, J. Loustau, était détenteur d’une métairie «... à Gélos et une autre à Bosdarros. Sur les 65 arpents de Bosdarros, 61 étaient labourables et la grange abondamment pourvue : deux charrues, six « trainoirs » (traineaux de bois), trois vaches et quatre veaux ; un coutre, deux « rasoirs avec leur fer », quatre bois d’arrazère, une fourche, un râteau à trois pointes de fer, trois fourches et deux râteaux en bois, deux hoyaux (ou houes) deux haches, trois bêches, une faux pour le foin (dalhe feassere ou dragou) , une autre pour le soutrage (dalhe sostrere). L’existence d’un petit vignoble ou de pommiers, la pommade était boisson courante des paysans béarnais, est attestée par deux pressoirs, cinq cuves, cinq baquets à vendange et une barrique. » 12
En montagne, l’outillage est encore plus rudimentaire, on utilise surtout la bêche, la fourche du fait des pentes abruptes.
Les plantes que l’on sème au printemps, notamment en avril, sont la pomme de terre et l’orge, un mois plus tard, en mai, c’est au tour du maïs, des haricots…
Pour les moissons, on persiste à utiliser dans certaines parties du Béarn la faucille (haus) notamment autour de Garlin (permettant ainsi d’obtenir un chaume important en vue de la « dépaissance » ou faire paître les bestiaux). Le bois prédomine encore dans la confection de l’outillage. Bien entendu cela ne veut pas dire que des paysans ne possédaient pas des outils en fer tels des faux (pour la fenaison), des pelles. Le paysan bêche avec une houe, débroussaille les haies en usant d’un haut-volant. Le travail se pratique de manière collective vu qu’il reste exténuant et qui nécessite les bras de tout le monde même les enfants.
Au fur et à mesure de la croissance des plantes, on raffermira les tiges fragiles par un coup de pied ou un par un ajout de terre, ou alors en les tutorant par des rames.
Le rendement, on s’en doute, est médiocre, surtout en montagne, excepté la vallée d’Ossau qui s’autosuffisait à l’opposé de la vallée d’Aspe qui ne couvrait l’équivalent de deux mois de ses besoins.
c- La moisson
Le travail se fait essentiellement à la main, en utilisant également la faux ou la faucille. Cet outillage s’avère rudimentaire et peu coûteux.
Lorsque le blé ou toute autre céréale est bien mûr, il est temps pour la famille de partir aux champs et de les couper. En règle générale, l’homme fauche, sa femme ramasse la javelle avec un râteau et les autres confectionnent les gerbes.
La faux (« grip ») tenue par les hommes est composée de grandes dents permettant de ratisser les tiges. Utilisée en Flandre - exactement en Hainaut - dès le XVIe siècle, elle s’introduit lentement en France. On avance plusieurs causes à cela, d’abord d’ordre technique. Ce serait à l’époque qu’un instrument imparfait, en partie en raison d’une métallurgie déficiente, d’autre part le travail opéré s’avère harassant. Des causes économiques sont pointées, la faux égrènerait les épis du fait des brutales secousses du moissonneur, elle ne laisserait qu’un chaume relativement écourté, pénalisant ceux qui jouissaient du droit de chaumage, en effet elle sectionne les tiges au ras du sol.
Marguerite Rambeau nomme la faux « lu dragu » et la décrit comme un outil composé « d’un manche de bois « l’asto » auquel s’adjoint, à mi-hauteur environ, un mancheron recourbé « l’espiwlu ». La lame « latozo » d’acier, légèrement bombée est bordée inférieurement par la partie tranchante « la hargwaüro », et du côté supérieur, par un bord très épais « la kosto » prolongée d’une sorte d’ergot « lu kwet » qui sert à fixer la lame à « l’asto » en s’enfonçant dans un anneau de fer « ü anet de her ». On l’y bloque par un coin « lu kuy » entre « l’anet » et « lu kwet » et forcé à coups de marteau « a cot de martet ». 13
La même auteure nous dépeint le moissonneur en train d’aiguiser sa faux le matin avant de partir entreprendre son travail. Assis par terre, « il plante « la hargwo » sorte de pointe dont la tête plate et lisse sert d’enclume, munie d’oreillettes « awléros » à mi-hauteur pour éviter qu’elle ne s’enfonce trop. Il pose sur cette enclume la « hargwadüro » et entreprend de la frapper « trüka » à petits coups réguliers, pour aiguiser le fil « lu hiw » de la lame, avec un marteau « lu martet » de fer « de her » ». Sa tâche terminée, il a soin de porter sur lui « le coffin « lu kup » (empli d’eau « ple d’aygo » où baigne la pierre à aiguiser « la peyro » dont il se sert fréquemment pour aiguiser le fil émoussé de sa faux. » 14 La même auteure, en la comparant à la faucille, nous énumère les avantages : le moissonneur « ne se pique plus les doigts aux chardons « lus kardus » ni aux ronces « lus arruumeks ou las arrumeros » qui serpentent souvent loin des haies. La paille recueillie est plus longue, le chaume est de hauteur régulière, et le travail va si vite ! ». 15
La faucille (« haous ») est l’outil de la femme en général. Elle a l’avantage d’éviter l’égrenage (séparation du grain de la plante) et de couper (ou scier) la tige à une hauteur suffisante pour être ramassée par les pauvres (à mi-hauteur, soit à environ 60 cm du sol), ce que l’on nomme chaume.
Martine Rambeau écrit que le travail fait à la faucille est si fastidieux que les moissonneurs se rassemblent pour le faire. Tous opèrent les champs les uns après les autres. On nomme « ces occasions de s’entr’aider : « ha ayüdos » 16, exemple même de la vie communautaire. Les moissonneurs débutent tôt, tous prennent chacun sa largeur de coupe « ü arrek e ö arbuho », et avancent « un peu en retrait du voisin pour avoir plus de place… sous le chapeau « debat lu sapew » s’étalent les grands mouchoirs quadrillés pour éponger la sueur « ta pumpa la südu », les uns sont en bras de chemise « en kamiso », les autres gardent la veste… Le moissonneur « lu segayre » prend les tiges « apuno inf : apüna », poignée par poignée, « las punetos », les tranche d’un coup sec de faucille, et, en un geste large et arrondi de la main droite qui tient la faucille, il couche en ligne la succession régulière de ces « pünetos » qui s’appelle « lu garbere ». 17
A la suite de l’usage des deux instruments, l’éteule (ce chaume laissé sur place) était laissée à la disposition des pauvres, mais aussi des cochons et de la volaille.
Les gerbes sont liées avec des tiges de blé puis on aura soin de les mettre à l’abri le plus rapidement possible vu que le climat pluvieux qui prévaut en Béarn pourrait compromettre la moisson. Les javelles (ou brassées d’épis moissonnés, non ramassés afin de laisser mûrir) ne sont pas permises.
Le travail se pratiquait en chantant, les chansons se composaient de poésies narratives comme le précise Jean Poueigh. Selon lui, le « romancero des moissonneurs semble en être redevable à l’importance vitale du blé, en tant qu’aliment...». 18
Selon les années, la moisson a lieu à la fin du mois de juin, en même temps que la fenaison. Jean-Marc Moriceau écrit qu’ « une fois les herbages fauchés, l’ordre des récoltes voulait que les moissonneurs... commencent par les céréales d’hiver et terminent par celles de printemps (« les mars »).
Ici, comme le rappelle Jean-Marc Moriceau «... nulle tâche que les « métives » ne créait davantage de tension dans la France de l’Ancien Régime. Les convoitises des voisins ou des pauvres qui bénéficiaient des droits de « glanage »(ramasser les épis tombés à terre) et de « chaumage » (couper les chaumes résiduels laissés dans les éteules)... les intérêts contradictoires entre les exploitants individuels et la communauté rurale, l’opposition entre les deux types de main-d’œuvre, locale et foraine, multipliaient les incidents. » 19
Durant la moisson, parmi les travailleurs, les jeunes profitent souvent de l’occasion pour s’amuser surtout après le souper. Mais c’est le dernier jour qu’a lieu la fête que certains propriétaires offrent aux ouvriers agricoles. Elle consiste en un repas et des danses.
Lorsque la moisson s’achève, on met en gerbes le blé durant quelques heures afin que la chaleur du soleil le sèche. Vient alors le prélèvement des taxes, la dîme ecclésiastique, le champart qui venait après. Les glaneurs accouraient ensuite. Mais afin d’honorer le contrat de métayage, le métayer se devait avant tout de réserver la part de la récolte au propriétaire, en général la moitié. Enfin, les fêtes villageoises marquent la fin des moissons.
d- Le dépiquage
Le fléau (« layetch » ou » ehlayet ») est l’un des outils utilisés pour dépiquer le blé. Il est constitué d’une gaule fixée au manche par des lanières de cuir pour leur donner du jeu . Selon les régions, les deux bâtons peuvent varier de taille. Marguerite Rambeau le décrit comme un outil composé d’un « manche « lu matye » en bois de noisetier « aberane » et d’un battoir plus court « la bergo » en bois de houx « agrew » ou de néflier « mesplé ». Celui-ci doit subir un traitement spécial : cueilli à la Saint-Martin il est grillé à four chaud « üsklat », dépouillé de son écorce « la pet » puis laissé dans le fumier pendant quelques heures. Le bois devient rouge et beaucoup plus solide, paraît-il. Les deux éléments « matye e bergo » sont coiffés de deux bandes de peau d’anguille « pet d’andyelo » = « lus kapets » cousues avec des nerfs de bœuf « nerbis de bwew ». Ces deux bandes sont reliées entre elles par un anneau de peau d’anguille, également « lu kuzene ». »
Fléaux à gauche de la photographie : Musée du château de Lourdes.
Si le manche est long et le fléau court, ce dernier peut asséner un coup plus fort. Dans le cas contraire, il frappe une surface plus importante. Quoi qu’il en soit, le fléau tournoie et voltige avant de frapper les épis. La gerbe est alors posée sur le sol, l’épi positionné vers le haut. Si le travail se fait à plusieurs, les individus se mettent en rond autour de la gerbe et ils abattent leurs fléaux à tour de rôle.
On peut également seulement user d’une longue perche de bois de buis ou de chêne.
Albert Soboul écrit que le battage au fléau, selon lui, découle du besoin de conserver la paille « en raison de sa longueur et de son liant aptes à de multiples usages… ». Vu que les paysans couchaient à plat les gerbes déliées, « les épis des unes reposant sur l’extrémité des autres : les coups de fléau ainsi amortis, la paille restait entière. » 20
Ensuite, on jette en l’air (surtout un vent en provenance du sud-ouest) le blé battu, ce qui a pour effet de retirer les balles. Pour cela, on utilise une fourche, si possible de bois léger. Marguerite Rambeau indique que les fourches « las hurkos » possèdent généralement trois oi quatre pointes , que leur « manche « mandye » est plus ou moins long, suivant la hauteur duy chargement des chars de blé que le propriétaire a l’habitude d’atteindre. Car elles servent surtout à « garbeya » c'est-à-dire à faire passer les gerbes sur le char. » 21
On peut disposer sur le sol de l’aire un tissu, un drap, pour réceptionner le grain alors que les balles sont emportées sur la marge.
Un autre moyen de dépiquer le blé est son piétinement par des animaux, des vaches, des bœufs, des mulets et des chevaux. Quelqu’un, souvent une femme en Béarn, guide, à partir du centre de l’aire, ces bêtes par une corde et les font trottiner en rond. Il suffit de réduire la corde pour raccourcir le cercle. Les hommes, au fur et à mesure du travail, alimentent l’aire et poussent sous les pieds des animaux la paille non encore brisée. On prend soin de boucher les yeux des animaux avec du linge par exemple afin notamment d’éviter les étourdissements du fait des cercles qu’ils opèrent durant de longues heures, parfois sous un soleil accablant en été.
Traîneau à dépiqueter (ou tribulum).
Le dépiquage ne peut guère se réaliser pour le seigle vu que la graine a davantage de difficulté à sortir de la balle.
Le travail peut se pratiquer à l’abri, dans une grange -permettant de battre en hiver -, ou dehors, dans la cour ou dans un terrain où on a pris soin de balayer au préalable. L’aire doit être, selon Pierre-Joseph Amoreux, médecin et bibliothécaire de la faculté de médecine de Montpellier : «…plane, unie, nette d’herbes, de pierres & et de toutes ordures. ». De plus, elle doit être aussi exempte d’herbes. Dans son mémoire de la Société royale d’agriculture de Paris daté de printemps 1789, ce même auteur conseille, dans le cas où cette étendue ne correspondrait pas à ces critères, c'est-à-dire : « peu propre à présenter une surface unie, compacte & non poudreuse…» de répandre « dessus de l’argile fine, ou toute terre grasse, dont on forme une couche en l’humectant, en le battant & en la piétinant ; la solidité de l’aire est un point essentiel qui rend le travail plus expéditif & le grain plus net. » Il précise que « Chaque an, l’aire se couvre d’herbes, qu’on fauche, on ne la laboure point, elle s’affermit toujours plus. »22
Marguerite Rambeau écrit que le battage (la batero) se pratique sur le sol de la cour de la maison. Afin d’empêcher que le grain se joint aux cailloux ou se plante dans la terre, « dans une comporte de bois, (la semaw) on délaie de la bouse de vache (hemso de bako) ou (bwaso), avec de l’eau (aygo), en tournant avec un bâton (ü barrot). Lorsque le mélange est homogène, on le verse sur le sol et on égalise avec le balai de bruyère (üo eskubo de brano). Cela s’appelle « lya lu par ». En séchant au soleil « en sekan aw su » ceci devient dur comme de la pierre. Mais il faut recommencer l’opération après chaque pluie.
Dans la cour ainsi transformée en aire, on apporte (ke porton-inf : purta) alors les gerbes, on les délie « ke dehligon – inf : dehliga » et on étale « k’estenin – inf : estene » la paille à battre par couches « a palats ». Puis à l’ardeur du soleil « aw tenilet », armés de fléaux « ehlayets », les batteurs habituellement quatre par quatre, frappent en cadence « ke merkon laposto » les épis « lus kabels » à égrener « dehglara ». le sifflement « lu brunide – inf : bruni » des battoirs ne cesse qu’au coucher du soleil. Travail pénible qui laisse les ouvriers haletants « pantuhaes » et les « flaks ». Pour compléter le travail du fléau, on attelle ensuite une paire de vaches à une sorte de petit char qui s’appelle « lu tumbarow » et on fait circuler cet attelage sur l’aire. Une personne juchée « arpitado » - inf : arpita » sur le véhicule, tient prête « paro ou emparo dab… » « la palo-kupo » pour recueillir les excréments « la hemso e lu pis » des animaux dès qu’ils font mine de lever la queue car il faut préserver le grain et la paille de toute souillure…. « Palat per palat » : par épaisseurs successives, on retourne la paille et on recommence au fléau et à l’attelage à battre le blé, toujours par grande chaleur. Ce travail achevé, on enlève la paille, on l’empile de côté « apyela-lo a par ». On ramasse grain et balle « lu grae e lu pup » en vrac à l’endroit propice à la ventilation, c’est-à-dire dans un courant d’air. » 23
L’abbé Rozier énumère d’autres procédés pratiqués dans des régions comme celui de bien niveler et de battre le sol, de délayer de la fiente de vache avec de l’eau et de répandre cette dernière avec des balais.
Ce dernier a étudié les avantages et les inconvénients du battage et du dépiquage et se démarque alors du précédent, M. Amoreux, qui préfère l’usage du fléau.
L’abbé Rozier écrit 24 : « Le dépiquage laisse beaucoup plus de grains dans l’épi que le battage ; c’est un fait constant, sur-tout dans les années pluvieuses, & lorsque le grain n’est pas totalement sec & bien nourri… Un second avantage du fléau résulte de la facilité avec laquelle on sépare la paille entière du grain & et de la balle ; au lieu qu’après le dépiquage, il faut manier deux ou trois fois à la fourche la même paille. » Il poursuit en affirmant que le battage conserve la paille « dans son entier » tandis que l’utilisation des animaux « la réduit en petits brins ». Dans l’article intitulé froment, il mentionne « …que pour la même somme d’argent, les mules ou chevaux accéléroient beaucoup plus le travail & même d’un tiers, objet très important… Somme totale, le battage au fléau est plus économique, & le dépiquage plus expéditif…» De plus, pour lui les animaux occupés lors du dépiquage ne sont pas utilisés pour d’autres tâches comme le labourage.25 Il expose également des causes sociales, le dépiquage permet de battre l’hiver, tems auquel les travailleurs sont moins occupés dans les pays où il y a peu ou point de vignobles à façonner. » 26
La paille, écrit Marguerite Rambeau, est disposée en « vrac, « dezwado » ou grossièrement liée en gerbes « garbots » on l’empile autour d’un mât « la brüko » planté dans le sol. La pile doit avoir l’aspect d’une poire, très mince en bas et en haut. Lorsque la paille arrive à un mètre du haut de « la brüko » on la couvre avec « lus palus » : paquets de balles grossièrement rassemblés, puis des paquets de liens de seigle particulièrement imperméables. Quelquefois, un lourd cercle de barrique empêche le vent d’emporter ce chapeau « preme : maintenir appuyant ». Tout en haut du mât « aw bet sum de la brüko » on renverse un pot ventru « ü tupi », ou une cruche « ü tarras » sans anse pour empêcher l’eau de pluie de glisser le long du bois du mât et de pourrir l’intérieur de l’édifice de paille. » 27
e- L’engrais
Dans la partie concernant l’outillage, il a été écrit que la jachère consiste à laisser en repos une terre pour qu’elle puisse reconstituer ses éléments fertilisants. Elle est utilisée notamment lors de la division des terres en soles soit dans l’assolement biennal ou l’assolement triennal. Pendant longtemps, la jachère a été pointée du doigt comme une pratique archaïque. Jean-Marc Moriceau écrit qu’elle ne clôture pas « le cycle des façons culturales… La réévaluation est d’autant plus nécessaire que les historiens, à la suite des écrivains agronomes du XVIIIe siècle, considèrent souvent l’année culturale préparatoire comme une marque infamante d’archaïsme… la jachère aurait constitué un mal nécessaire de l’économie rurale, le verrou d’un cercle vicieux en attendant la libération ouverte par les prairies artificielles. » Il rappelle les travaux de François Sigaut qui ont bien distingué la friche de la jachère et montré que cette dernière s’effectue en début d’assolement.
En ce qui concerne l’assolement biennal, appliquée dans le Béarn, « se situe souvent dans des zones dominées par les friches, dans des régions où les procédés d’agriculture par le feu (écobuage et essartage) et le simple prélèvement du gazon (étrépage et soutrage) viennent « rompre » pour quelques années de production des pâtis qui retournent pour de longues années à la lande ou à la fiche. » Il ajoute qu’avec ce type d’assolement, il est nécessaire d’user de fumure « proportionnellement supérieure au triennal puisque l’estiado occupe la moitié des terres emblavées. » Ce qui entraîne « l’importance des saltus nécessaires à la production des engrais. » 28
F. Sigaut s’érige en faux dans l’affirmation que l’assolement triennal est supérieur à l’assolement biennal , selon lui les céréales de printemps sont d’un apport moindre si on la compare au blé d’hiver, chaque année. Il est d’avis que les deux se valent.
Les servitudes communautaires sont plus importantes dans les zones d’assolement triennal que dans celles d’assolement biennal.
Voici quelques études d’écrivains agronomes du XVIIIe siècle au sujet de la jachère.
D’abord, citons J.J. Menuret, docteur en médecine.29 Il est en possession d’une propriété de deux cents arpents dans une plaine aride, composée d’une argile rouge. S’il reconnait que la culture était facile, il constate que « le produit en était bien faible », ne récoltant que de l’épeautre et du seigle. «… les épis minces, courts & rares donnaient peu de paille & de grain ; le fumier qu’on pouvait répandre en petite quantité sur le terrain, le brûlait plus qu’il ne le fécondait ; il fallait souvent redoubler les années de jachère pour obtenir une récolte passable… ». 30 D’où son idée de planter du sainfoin, de la famille des légumineuses, utilisée à former des prairies artificielles. Il le fait au printemps et obtient en automne une « seconde poussée, qui dans quelques endroits, prêta à la faulx, dans d’autres servi à faire paître les bœufs ; on le laissa subsister une seconde année ; le fourrage fut encore plus abondant, le regain fut renversé & enterré par un labour profond, le terrain ensemencé après un nouveau travail… » Il note que les « Grangers-Métayers » sont alors intéressés. Il continue à entreprendre des essais et sème avec du sainfoin, du blé, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du sarrasin. Il rappelle que les Comices Agricoles louent l’utilité des prairies artificielles et notamment le sainfoin comme fourrage. Il note que cette plante a le don d’écarter les mauvaises herbes et les plantes parasites, mais aussi d’accroître la fécondité du sol, en favorisant « l’emploi et l’utilité des fumiers ».
Puis citons le marquis de Guerchy. 31 Il écrit que les deux préjugés à combattre pour le « succès de l’Agriculture » dans le pays sont : « la suppression des jachères & l’éducation des bêtes à laines en plein air. » Il remarque que ces conseils sont peu suivis à l’intérieur du royaume. Il espère que la Société royale d’agriculture de Paris fera le nécessaire afin de diffuser l’information.
L’engrais pose un problème. Celui d’origine humaine est peu utilisé, s’il est récupéré pour enrichir la terre des cultures maraîchères, particulièrement autour de certaines villes, comme à Laval, ce n’est pas la règle commune. On se tourne davantage vers l’usage des excréments animaux, mais se pose alors le délicat problème de sa rareté.
La fumure est réservée en règle générale pour les terres proches du village. En montagne, les ovins laissés sur les champs dans l’intention de les nourrir et de fertiliser le sol ne suffisaient pas. « On devait, panier en main, parcourir les pacages pour ramasser bouses et crottin. Stocké, ce fumier était sorti en décembre et janvier avec celui, fort pauvre, des étables et des bergeries, puis épandu les mois suivants sur les champs et les prairies. » 32
Le marnage est pratiqué, on s’en procure auprès des carrières, les marnières, il est important car il permet de bonifier la terre en neutralisant l’acidité du sol. A Gomer, par exemple, le Corps de Ville, en 1756, accepte de partager une part du bois communal à la condition expresse que les villageois de la commune puissent extraire de la marne. 33 Autres engrais utilisés, la tuie (touya ) qui correspond à un mélange de fougères, d’ajoncs et de graminées que l’on trouve sur la lande propre au climat océanique et qu’on s’en sert comme litière pour le bétail notamment durant la saison froide et qu’on utilise ensuite pour enrichir la terre que l’on cultive au printemps, la cendre recueillie des maisons, mais on se doute bien qu’elle se révélait insuffisante .
Le fumier est transporté par des tombereaux.
L’écobuage , qu’il ne faut pas confondre avec brûlis, consiste à extraire la couche superficielle du sol au printemps à la houe ou à la pioche , à utiliser les mottes de terre gazonnée que l’on a mise à sécher aux mois de juillet et d’août dans le but de réaliser des fourneaux de combustion circulaires le plus généralement, et, enfin, à utiliser la cendre obtenue comme engrais en l’épandant dans les champs avec une pelle.34
Afin d’illustrer cette analyse sur l’engrais, citons Jean Lassansaa qui s’est penché notamment dans sa monographie sur Billère sur son usage. Il mentionne qu’on y pratiquait durant longtemps pour enrichir la terre l’enfouissement de la paille, du chaume, de la cendre, des déchets de légumineuses. Il rajoute aussi qu’on utilisait l’engrais d’animal, de la marne et de la jachère dans le cadre l’assolement biennal « faute de bons amendements, ce qui, selon lui, est un « signe et facteur de pauvreté. » Puis, à partir du règne de Louis XIV, on mêle de plus en plus, avec « le fumier des troupeaux » la « litière faite de touyas que l’on allait chercher surtout dans le Pont-Long (formés d’ajoncs, de fougères, de genêts et de bruyères. Chaque paysan essaya d’avoir sa fougeraie et sa touya. Il rajoute qu’on usa de « prairies artificielles » soit des « champs ensemencés en légumineuses, trèfle, luzerne, sainfoin, vesce, etc » ce qui porta « un coup mortel aux vieux usages agraires. » 35
Pour terminer, sur la partie traitée, on laboure, on herse et on sème. Outre l’engrais procuré par ce procédé, ce dernier permettait également d’éliminer les mauvaises herbes, les parasites, mais aussi, dans les terres acides, argileuses en modifiant la constitution physique du sol. 34
f- La relation homme- outils - animaux domestiques dépend aussi de l’étendue travaillée.
Il est nécessaire de distinguer, en effet, les jardins des prairies et des champs. Dans le premier cas, le travail se fait à la bêche, à la houe, il se trouve non loin du domicile, on l’enrichit davantage en engrais en rapport avec les champs. On l’appelle « la culture à bras ». Les nécessités peuvent par ailleurs pousser le paysan à la pratiquer en montagne lorsque les pentes sont trop abruptes, sur les hautes terres, pour l’usage de l’attelage. Puis viennent les prairies et les champs, dans certaines régions françaises comme la Normandie, la primauté des premières est certaine. Dans la dernière catégorie, on cultive des plantes connues ou « nouvelles » avec des outils liés aux animaux domestiques.
Pour pallier cette faiblesse des engrais et notamment à celle des prairies, des landes ou forêts (ce que l’on nomme saltus), la communauté depuis longtemps a cherché à imposer des obligations - les pratiques communautaires - comme celles de moissonner, de faner à la même date et en même temps, mais aussi la vaine pâture. Le terroir de la paroisse était alors morcelé si on pratiquait l’assolement triennal en trois soles dédiées l’une aux céréales d’hiver (que l’on sème en automne afin qu’ils germent comme le blé ou le seigle et que l’on récoltera en début d’été, juin ou juillet ), l’autre aux céréales de printemps (ne supportant pas l’hiver, que l’on sème au mois de mars et que l’on récoltera en juillet comme l’avoine ou l’orge) et enfin la dernière destinée à la jachère ou le repos (pour que la terre puisse se régénérer), les agriculteurs faisaient tourner les cultures (rotation). Le paysan devait obligatoirement détenir des parcelles dans les trois soles.
Guillaume Daudin 36 écrit que le fait de passer de l’assolement biennal à l’assolement triennal « même s’il faisait reculer la jachère… n’était pas… un « bonus » sans coût ». Pour lui c’était un « moyen d’économiser sur la terre en tant que facteur de production au prix d’une utilisation plus intensive du facteur de production humain. »
Les animaux gardés par le berger de la communauté venaient paître sur le quartier-jachère, mais également dans les deux autres soles après avoir terminé la récolte. L’assolement triennal était davantage utilisé dans le Nord et l’Est de la France dans le paysage d’openfield (champs ouverts en lanières, c’est le domaine de la grande culture céréalière) où l’habitat est groupé, sinon, on usait de la pratique de l’assolement biennal (blé d’hiver et jachère). L’habitat était davantage dispersé dans l’Ouest de la France où les champs étaient par contre clôturés - le fameux bocage avec un bétail plus important - tandis que dans le Sud on retrouvait un habitat groupé mais avec des champs moins réguliers, où les jardins et les arbres fruitiers s’additionnent à la vigne, l’olivier, le blé en relation avec l’application de l’assolement biennal. En Aquitaine, l’assolement biennal concerne le maïs et le blé.
f- Le foin
A côté de la culture des céréales, il y a les prairies.
Le climat océanique qui règne en Béarn est propice à la croissance de l’herbe. De plus, le relief montagneux avec ses pentes souvent abruptes ne favorise pas le développement de cultures.
Ce que l’on appelle la fenaison correspond à trois étapes, la coupe, le fanage et la récolte du fourrage.
La coupe du foin a lieu généralement au printemps et au début de l’été, c’est-à-dire à partir du mois de mai jusqu’au mois de juillet.
On fauche le foin (« feeas ») à la faux (« dailhe ») excepté en montagne où il est nécessaire d’utiliser la faucille vu que les prés sont localisés sur des pentes abruptes et qu’ils sont généralement de petites superficies.
Planche et légende sur "le foin", tirée de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (source: http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie).
Faucille à droite du tribulum (ou traîneau à dépiqueter).
La fauchaison, en montagne, se déroule à des périodes différentes, ceci en raison de l’exposition des prés à l’ensoleillement.
La fenaison, si elle était une opération relativement éreintante, l’était d’autant plus en montagne. Jean-François Soulet nous décrit ces femmes des vallées d’Aspe et d’Ossau qui « dès trois ou quatre heures du matin, maniant la « dailhe » sur d’étroits replats, ne s’accordant un temps de repos que pour éponger leur front ou chercher dans le coffin la pierre à affûter... Le foin... après avoir été étendu, retourné, mis en tas, doit être porté jusqu’à la « borde » la plus proche. » 37
Jean Poueigh nous restitue très bien le déroulé de la fenaison : «... la ligne des faucheurs (lous dalhaires) étage de biais ses échelons ascendants. Elle se meut avec une régularité symétrique, commandée par l’impulsion de celui qui a pris la tête et que les autres ont à distance successivement imitée. Partis d’un bout, tous abattent horizontalement leur rangée, andain après andain (andan, andaiàdo de fèn), d’un courbe et uniforme enveloppement de la faux (dàio, dalh ou dàlho), inlassablement répété jusqu’à l’extrémité opposée. Car ils n’avancent pas droit devant eux, comme le laboureur, mais de côté, à la manière des crabes, sans hâte, le corps se ployant à demi en oscillations balancées de droite à gauche sur les jambes arquées. Par intervalles assez rapprochés, l’un d’entre eux s’arrête, se redresse, saisit dans l’étui de bois (ou la corne de bœuf) -lou coier, coudié, coudié, cup, cousso-cubét, pendu à sa ceinture, la pierre à aiguiser - l’asugadouire ou pèiro à dàio, et affute dextrement le fil émoussé de sa lame, opération qui se traduit par amoula, asuga, harga la dàlho. » 38
Le même auteur mentionne que les chants de fenaison se nomment cantes ou cansous dalhaires.
Lorsque les pentes dans les vallées béarnaises sont trop abruptes, le faucheur est contraint de s’attacher à l’aide d’une corde, soit à un arbre soit à la confier à quelqu’un d’autre. Le foin coupé doit ensuite être transporté par dos d’homme à la grange. Pour la facilité de la manœuvre, il attache les herbes fauchées soit par des liens d’osier tordus (armerous) soit par des « cordages qui terminent des crochets spéciaux soumètes, ariès), faits de morceaux de bois, courts et plats, mais assez épais pour résister à la traction, et percés de deux trous dans lesquels passent les cordes ou les liens, que l’on tend alors et dont on fixe les bouts au moyen de nœuds. » 39
Jean-François Soulet nous cite une technique utilisée en vallée d’Ossau. L’Ossalois « amasse le foin dans une vaste toile, appelée « leytère »... dont les bouts sont noués entre eux, et porte ce fardeau sur la tête ». Le même auteur fait également référence à l’ « arria » ou la « saumette », « instrument très simple, ayant pour base un cadre de bois sur lequel est placé perpendiculairement un étrier ; au sommet de celui-ci, un pieu relié à une corde permet d’arrimer une grosse quantité de foin. Un seul homme peut ainsi porter cinquante à quatre-vingts kg de fourrage jusqu’à la grange ». 40
Dans les zones dans lesquelles le relief est trop contraignant, des bâtiments ont été construits, les bordes. Ce sont des granges proches des prairies, des planches de châtaignier (véritable répulsif d’insectes) servent de plancher à l’étage, s’il existe, qui sert de dépôt du foin. Ces bordes sont « spécialisées » vu que le fourrage contenu dépend des bêtes qui peuvent y pénétrer et s’alimenter. Le paysan déposait le fourrage à travers l’ouverture qui se trouvait soit au niveau du sol ou à l’étage qu’il escaladait à l’aide d’une échelle.
Borde près de Sarrance.
Si jusqu’au XVIe siècle, le matériau de prédilection est le bois, il disparaît ensuite au profit du pisé et des galets roulés ensuite.
Borde en ruine près de Sarrance.
Le foin, ensuite, doit être étalé. Ce travail est le plus souvent confié aux femmes et aux enfants. Ensuite vient l’opération consistant à faner ou retourner le foin à la fourche (« bira ») pour que le soleil l’assèche. Ce travail se pratiquera le long de la journée à l’aide du râteau (« arrastère ») ou de la fourche (« hourque »). Sec, le foin est ramassé afin d’obtenir des bottes puis transporté dans une borde ou grange. La famille est là, tout le monde connaît le travail qu’il doit faire, si l’homme fauche, la femme use de son râteau pour assembler des tas. Puis, il y a ceux qui s’affairent en liant les gerbes en utilisant des cordons de paille.
Planche et légende sur le battage en grange, tiré de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert (source: http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie).
La fauchaison était plus facile lorsque l’herbe était humide, ce qui explique qu’elle se pratiquait soit à l’aube, soit le soir.
Pour le transport, en plaine, on utilise la charrette à quatre roues (ou « bros ») munie de ridelles droites. Les roues cerclées de fer sont l’exception. Les deux bœufs ou vaches étaient protégés des mouches par un tissu. Quant les pentes sont trop raides comme en montagne on utilise des chariots conçus à cet effet. En effet, leurs roues sont réalisées de telle façon qu’elles évitent les dérapages grâce à des roues cloutées pour bien adhérer au sol. Si la pente est trop abrupte, on utilise l’âne pour transporter par exemple le fourrage, à cette fin, on pose sur lui des paniers d’osier. Si cela s’avère impossible, l’homme doit se contraindre à user que de sa force physique, il « amasse le foin dans une vaste toile, appelée « leytère » en vallée d’Ossau, dont les bouts sont noués entre eux et porte ce fardeau sur sa tête...» ou alors il prend « l’arria » ou la « saumette », « instrument très simple, ayant pour base un cadre en bois sur lequel est placé perpendiculairement un étrier ; au sommet de celui-ci, un pieu relié à une corde permet d’arrimer une grosse quantité de foin... cinquante à quatre-vingts kg de fourrage » et de porter « jusqu’à la grange ». 41
Le rythme des travaux comme nous le rappelle Jean-François Soulet « s’accélérait d’une manière presque insoutenable : récolte, mise en tas, liage et transport de l’orge ; récolte des pois et des haricots ; fauchaison, fenaison et transport des regains ; récolte et dépiquage du millet et du sarrasin ; préparation des bottes de paille (« les saumants ») pour les couvertures. » 42
Ces outils sont utilisés bien entendu selon le rythme des saisons, véritable calendrier agricole. Pour donner un aperçu voici celui de la région toulousaine, proche du Béarn. Au mois de janvier, c’est l’époque du labourage des céréales (le maïs comme en Béarn) ; au mois de février, on sème l’orge, l’avoine, on s’occupe de planter les arbres ; aux mois de mars et avril, on laboure à nouveau les champs de blé et la vigne, on sème le maïs ; aux mois de mai et de juin, on laboure encore les terres à blé (afin notamment d’éliminer les mauvaises herbes), on sarcle le maïs ; au mois de juillet, c’est la fenaison et la moisson ; au mois d’août, on procède au dépiquage, on laboure à nouveau, c’est aussi la période de la fumure ; au mois de septembre, on procède de nouveau au labourage des champs de blé, on récolte le maïs, on vendange ; au mois d’octobre, on stocke le maïs, on sème le blé, l’avoine ...; au mois de novembre, on laisse reposer la terre et, enfin, au mois de décembre, on plante à nouveau des arbres et on laboure les terres à maïs.43
En règle générale, dans le royaume de France, on sème les céréales d’hiver à l’automne. Ces « bleds » (nom donné à toutes les céréales) correspondent au froment, au méteil (froment mêlé de seigle). Ensuite, les céréales de printemps sont semées le plus souvent au mois de mars (on les surnomme d’ailleurs les « mars »), on trouve l’avoine, l’orge, le millet.
En Béarn, le froment (« forment) est semé à la Toussaint, à la Noël, c’est l’avoine (« civade »), alors que le millet (« milh ») plutôt à la Saint-Jean.
La fenaison, si elle était une opération relativement éreintante, l’était d’autant plus en montagne. Jean-François Soulet nous décrit ces femmes des vallées d’Aspe et d’Ossau qui « dès trois ou quatre heures du matin, maniant la « dailhe » sur d’étroits replats, ne s’accordant un temps de repos que pour éponger leur front ou chercher dans le coffin la pierre à affûter... Le foin... après avoir été étendu, retourné , mis en tas, doit être porté jusqu’à la « borde » la plus proche. » 40
Dans les montagnes pyrénéennes, Christian Desplat nous décrit l’année agraire appliquée en Bigorre mais que l’on peut transposer en Béarn dans nos vallées. La saison des travaux agricoles débute à la Saint-Martin, en novembre, lorsque la transhumance s’achève et que les ovins descendent des estives. Les « foires se multiplient : c’est le temps des fermages, celui pendant lequel l’argent circule ». On ramasse les châtaignes. Entre les mois d’octobre et de février, les jours raccourcissent, on s’affaire autour du cochon. Puis à partir du mois de février, les travaux agricoles reprennent notamment avec « la montée des brebis aux estives en avril, foins en mai-juin, céréales en juillet… Ce calendrier, qui réglait le travail dans le temps, correspondait aussi à une maîtrise de l’espace modulée par la composition du terroir. » 44
Tous ces outils, les labours et les semailles finies en automne et l’hiver s’instaurant, le paysan prendra soin de les réparer, de les entretenir. Ceci jusqu’à l’arrivée du printemps, saison où toute l’activité agricole renaîtra.
h- Autres outils à main pour travailler la terre :
- La bêche (ou Lou paloun) est un instrument composé d’une partie de fer large d’une vingtaine de centimètres et d’une longueur approximative de trente centimètres. La douille insère un manche d’une longueur de 1 mètre environ. Un hoche-pied permet au paysan d’enfoncer l’instrument dans la terre en y posant son pied. Son usage consiste à retourner la terre et à la fendre verticalement.
La houe (ou houssero) a une forme rectangulaire mesurant une trentaine de centimètres en longueur sur une vingtaine de centimètres en largeur. D’un côté, un tranchant et de l’autre une partie percée pour insérer le manche. Cet outil sert à remuer la terre précédemment travaillée ou à déchausser la vigne.
- Le râteau (ou arrastet) est un outil fait d’une traverse de bois armée de dents de bois ou de fers et muni d’un manche de bois. Il sert à ramasser le chaume après la moisson et à donner une forme arrondie aux sillons après avoir amassé les tas de terres.
Râteau à droite du tribulum (ou traîneau à dépiqueter).
- La fourche (ou hourquo) de forme bifurquée est utilisée pour retourner le foin, le répandre ou le ramasser.
B) Le transport
Pour les distances plus ou moins longues et les exploitations plus ou moins importantes, il existe une variété de moyens de transport.
Pour le déplacement de petites distances (transporter du bois, le raisin vendangé...), si la pente est trop abrupte, le Béarnais détenant de petits revenus l’effectue à dos d’homme (à l’aide de hottes par exemple) ou en employant une civière à bras (« carcan »). Dans les reliefs accidentés, on transporte aussi avec ce que l’on nommait des « carras », sorte de traineau composé d’un châssis et de deux madriers terminés en forme arrondie. D’autres utilisent l’âne ou le mulet. Si l’exploitation est plus importante, l’usage de la charrette (lou car) devient indispensable (ou alors un tombereau). Cela sous-entend bien entendu la possession de bovins. Ces charrettes comportent deux ou quatre roues.
Philippe Wolff fait mention du «... currus, principalement utilisé par les charretiers béarnais », composé de quatre roues, d’une roue de secours, tracté par une paire de bœufs. 45
La charge est d’alors 7 à 800 kg. Pour le transport du foin, de la paille…on dispose sur la charrette horizontalement sur les ridelles - montants pleins ou à claire-voie posés sur les côtés - un cadre appelé « las ballanços ». Quant au tombereau, il repose sur deux roues et détient un timon, il est tracté également par une paire de bœufs. Marguerite Rambeau nous décrit une sorte de tombereau nommé « lu bros » qui ne comporte que deux roues ce qui lui permet d’être plus maniable. Sa caisse, en la basculant, peut permettre de vider son contenu. De plus, il est possible de doubler sa contenance en mettant sur les côtés des piquets. 46
a- Les jougs
Pièce de bois que l’on met sur la tête des animaux, bœufs ou vaches, pour les atteler. Il en existe plusieurs sortes. Une catégorie sert simplement à assembler deux têtes de bétail afin de les amener par exemple au marché. Il ne s’agit que d’une barre de bois trouée de quatre trous pour faire passer les cornes (« juhete). Dans ces dits trous, on passera des attaches dans le but de maintenir les bêtes.
Il existe d’autres jougs qui, selon le nombre de bêtes, peuvent être simples pour un seul animal, doubles pour deux et même trois lorsqu’il s’agit de dresser un jeune entre deux anciens.
Quant au joug utilisé pour des travaux de champs ou de transport, on utilise celui qui est constitué d’une pièce de bois réalisée avec un bois dur comme le noyer ou le frêne. Pour l’adapter aux cornes, il est sculpté. On cale les cornes avec des courroies.
Le joug est positionné sur la tête de la race blonde (« barétone ») et particulièrement sur les cornes qui sont en forme de lyre, vu que ce sont elles qui encaissent le plus l’effort. Par contre s’il s’agit de bovins possédant des cornes plus fragiles, on le pose sur la nuque.
Jougs en haut à gauche de la photographie : Musée du château de Lourdes.
Afin de le protéger des intempéries, du soleil, (éviter l’éclatement du bois) on le protège par une peau d’animal (« cuberte ») comme celle de mouton. Jean Poueigh mentionne que le « front des bovins attelés porte ordinairement une sorte de paillasson (« testère », sur lequel sont tendues les longes (« jùlhos ») ou courroies de joug (« joto, juàto »).
Pour les animaux eux-mêmes, l’attaque des insectes comme le taon ou la mouche pouvant les rendre nerveux, on appliquait des filets (« mousquès ») sur la face. Marguerite Rambeau précise que l’on protège les yeux par « un treillis de lin grossier « lu kapit » qui s’appelle « lu muske ». 47 En ce qui concerne leurs corps, on les protège par des draps, souvent de lin nommés « lah lyeytéres ». Marguerite Rambeau précise que ces dits draps étaient attachés « sous la queue « la kuwo » par des briudes « las krupyeros ». On en revêt « lu parel » pour le préserver de la fraîucheur du soir « lu seré », des refroidissements après la pluie et des piqûres de mouches oun de taons « tabaos » par grande chaleur « kalu ». » 47
Au centre du joug correspond le point d’appui où on accroche la corde, la chaîne ou le timon. A cet effet, on utilise une cheville.
En ce qui concerne les animaux accouplés sous le joug, on les distingue soit selon leur couleur du pelage, soit la forme de leurs cornes ou encore selon leur tendance à tirer à droite ou à gauche. Si on prend le cas des bœufs rouges béarnais, on les appelle « Roùi, Bouet... ». S’ils tirent vers le côté gauche ils seront nommés « biou senestrié »... Les animaux obéissent à la voix. Le bouvier leur lance « arre » pour qu’ils reculent ou « wo » pour qu’ils arrêtent ou « ha » pour qu’ils avancent.
Pour inciter les animaux de bât à avancer, on les pique avec une tige de houx, de coudrier ou de néflier nommée « agulhàdo ». Elle mesure près de 1, 75 m et est composée d’un aiguillon au bout et à l’autre extrémité d’un fer aplati nommé « darboussàdo » servant à nettoyer le soc de la charrue de la terre et à couper les petites racines.
b- Les colliers
Ils dépendent de l’animal auquel on les met. S’il s’agit d’un âne, le collier est en bois (ou en cuir si on a les moyens financiers) et on le place contre le poitrail tout en s’assurant de le protéger des frottements par des chiffons et de la paille par exemple.
S’il s’agit d’un cheval, le collier diffère de la traction lorsqu’elle est importante ou faible.
c- Le bât
C’est un dispositif que l’on pose sur le dos de l’animal qui sert de bête de somme afin de transporter de lourdes charges. On pense à l’âne, au mulet et au cheval.
Tout simplement, on peut utiliser le transport à dos de ces deux animaux par le biais d’un cacolet à panier (« banastos »), c’est-à-dire un bât composé de deux sièges ,à dossier accroché sur une armature.
Ce « bast » est fait en bois ou en osier. On utilise deux branches d’arbre dont la forme ressemble le plus à une courbe en arc. Elles sont alors solidarisées par des traverses dont la longueur correspond au dos de l’animal. On prend soin de protéger la bête par des tissus rembourrés avant de poser le bât. Si l’âne peut supporter une charge de 60 kg, le mulet, par contre, peut porter jusqu’à 120 kg, soit le double. 48
Notes :
1- Lavoisier, Antoine Laurent de, De la richesse territoriale du royaume de France, Editeur :Comité des travaux historiques et scientifiques, 1998.
2- Sigaut, François , voir son article sur https://mots-agronomie.inra.fr/index.php/Charrue,_historique_et_fonction.
3- Bayard, F., et Guignet, P., L’économie française aux XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, Editions Ophrys, 1991, p. 25.
4- Grandthan , George W. , “Division of labour : Agricultural Productivity and Occupation Specialization in Pre-Industrial France”, Economy History Review , vol. 46, n°3, 1993, p. 494.
5- Poueigh, Jean, Le folklore des pays d’oc, la tradition occitane , petite bibliothèque payot,1976, p.95.
6-Rambeau Marguerite, Etude ethnographique et lexicologique de la culture des céréales dans un village béarnais : Lussagnet-Lusson, Mémoire du diplôme d’études supérieures (Lettres Modernes), Université de Bordeaux, 1965-1966, p. 3.
7- Poueigh, Jean, op. cit., p. 94.
8- Rambeau Marguerite, op.cit., p. 6.
9- Dralet Etienne-François, Description des Pyrénées considérées principalement sous le rapport de la Géologie, de l’Economie politique, rurale et forestière de l’Industrie et du Commerce, Paris Arthus Bertrand 1813.
10- Rambeau Marguerite, op.cit., p. 17.
11- Cardo, Michel, Les instruments aratoires en Béarn et Pays Basque à la fin du XVIIIe siècle, Revue de Pau et du Béarn, n°24, 1997, p 287-292.
12- Desplat, Christian, La vie en Béarn au XVIIIe siècle, Editions Caïrn, 2009, p. 144.
13- Rambeau Marguerite, op.cit., p. 4.
14- Idem., p. 5.
15- Idem., p. 37.
16- Idem., p. 33.
17- Idem., p. 37.
18- Poueigh, Jean, op.cit., p. 106.
9- Moriceau, J.M, article « moissons », Dictionnaire de l’Ancien Régime, Editions puf Quadrige, 1996.
20- Soboul Albert, La civilisation et la Révolution française, tome 1, chez Arthaud, 1970, p. 99.
21- Rambeau Marguerite, op.cit., p. 7.
22- METHODE de battre et de fouler les grains à l'aire, dans les Provinces méridionales de la France, par M. AMOREUX, fils, Correspondant, à Montpellier. Mémoire d’agriculture, d’économie rurale et domestique publiée par la Société d’agriculture royale de Paris, p. 47.
23- Rambeau Marguerite, op.cit., p. 43.
24- Rozier abbé, article battage, Cours complet d’agriculture théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire, Paris, 1782, tome 2, p. 176.
25- Idem., article froment, tome 5, p. 155.
26- Idem., article battage, p. 173.
27- Rambeau Marguerite, op.cit., p. 46.
28- Moriceau Jean-Marc, Terres mouvantes, les campagnes françaises du féodalisme à la mondialisation XIIe- XIXe siècle, Fayard, 2002 ; Sigaut François, Pour un atlas des agricultures précontemporaines en France, Histoire et sociétés rurales, 2, 2e semestre 1994, p. 142-145.
29- Menuret J.J., Mémoire sur la culture des Jachères, Mémoire d’agriculture, d’économie rurale, et domestique publiée par la Société royale d’agriculture de Paris, p. 65.
30- Idem., p. 69.
31-Guerchy, marquis de, article tiré des Mémoires d’agriculture, d’économie rurale et domestique publiés par la Société royale d’agriculture de Paris, janvier 1787, p. 174.
32- Soulet J-F, La vie quotidienne dans les Pyrénées sous l’Ancien régime du XVIe au XVIIIe, chez Hachette, 1977, p. 93.
33- A.D.P.A., III.E 5363.
34- cf : Sigaut François, L’Agriculture par le feu. Rôle et place du feu dans les techniques agricoles de préparation de l’ancienne agriculture européenne, Paris-La Haye, Mouton, 1975.
Voir l’article, de Portières Roland, De l’écobuage comme un système mixte de culture et de production, Journal d’agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, Année 1972, 19-6-7, pp. 151-207.
35- Lassansaa J., Billère au fil des siècles, 4e chapitre, Revue Régionaliste des Pyrénées, 56e année, n° 201-202 Janvier à juin 1974, p. 54.
36- Daudin G, Commerce et prospérité. La France au XVIIIe, PU-Paris Sorbonne, 2005, p. 39.
37- Soulet, F., op.cit., p.95.
38- Poueigh, Jean, op.cit., p. 100.
39- Idem., p. 103.
40- Soulet, J-F, La vie quotidienne dans les Pyrénées sous l’Ancien Régime, Editions Hachette, 1977, p. 96.
41- Poueigh, Jean, op.cit., p. 96.
42- Soulet, J-F, op.cit., p 97.
43-Frèche, Georges, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des lumières vers 1670-1789, Paris, 1974, cujas.
44- Desplat Christian : Village de France au XVIIIe siècle, autoportrait », Editions atlantica, 1 97 ; p. 32.
45-Wolff, Philippe, Commerces et marchands de Toulouse (vers 1350-1450), Le Plon, Paris, 1954, p. 449.
46- Rambeau Marguerite, op.cit., p. 9.
47- Idem., p. 11.
48- Soulet, J-F, op.cit., p. 152.
Bibliographie :
- Bulletin des comices agricoles des arrondissements de Pau, Bayonne, Mauléon, Oloron et Orthez, Pau, Vignacour, 1860.
- Haudricourt, A.G., L’Homme et la charrue à travers le monde, Paris, La Renaissance de Livre, 2000.
- D’Alband, N., Nouvelle Méthode pour défricher les landes et les vieilles prairies, Pau, 1773.
- Desplat, Christian, Village de France au XVIIIe siècle. Autoportrait. Satournin et la baronnie d’Esparros, Biarritz, Atlantica, 1997.
-
Par Michel64a le 31 Octobre 2020 à 15:18
LE PAYSAGE RURAL BEARNAIS
Ce qui marque avant tout le monde agricole est son hétérogénéité.
Comment se présentait le paysage béarnais au XVIIIe siècle ? D’abord précisons que la province couvre à l’époque 4 186 km2.
Nous avons deux descriptions dressées par deux Intendants successifs qui nous ont laissé deux « Mémoires » lors du règne de Louis XIV. Le roi et le duc de Beauvilliers cherchent à partir de 1697 à dresser un tableau de la France afin de servir à ses successeurs dans leur gouvernement du royaume. En conséquence les Intendants établissent par le biais des « Mémoires sur l’état des Provinces » une description des provinces et des généralités qu’ils administraient .Ces Mémoires doivent également servir à instruire le successeur du roi, le duc de Bourgogne afin qu’il puisse administrer le pays par la suite. Nous possédons grâce à eux un exposé géographique, économique, juridique... détaillé des territoires de leurs ressorts. Ces documents furent connus du public, notamment en 1727 par leur publication par le duc de Boulainvilliers en trois volumes.
En Béarn, il s’agit des Intendants Pinon et Lebret. Le premier a écrit son « Mémoire » en 1698 et le second en 1703. 1
L’Intendant Pinon commence l’analyse de la géographie du Béarn en se référant aux gaves qu’il appelle « Gave béarnois » (il s’agit du gave de Pau) et le « Gave d’Oloron » constitué de ceux d’Ossau et d’Aspe. Pour chacun d’entre eux, il énumère les sources et les lieux de passage. Faisant le lien avec le domaine économique, il note que ces « rivières ne portent point de bateaux dans le païs à cause de leur rapidité. » par contre il constate qu’ils sont très poissonneux. 2 L’Intendant Lebret ne mentionne que l’étendue du Béarn et sa situation, il écrit que la province revêt une forme triangulaire de « seize lieues de Gascogne en sa plus grande longueur et douze lieues de largeur ».3
Comme le remarque Christian Desplat , les deux Intendants ne dressent pas une étude approfondie des montagnes si ce n’est Mr Lebret lorsqu’il s’agit d’aborder les forêts. De plus, le même auteur souligne qu’ils n’ont guère insisté sur les coteaux et les hautes plaines béarnaises. Pour lui, « ils ont excessivement privilégié le rôle des « ribeyres » (les terrasses alluviales) dans la vie économique et sociale de la province ». 4
Pourtant, il est vrai que pour le Béarnais du XVIIIe siècle comme celui d’aujourd’hui les montagnes représentent un élément important. Nos trois grandes vallées montagnardes que sont celles d’Aspe, d’Ossau et de Barétous ne représentaient pas de véritables barrières puisqu’elles correspondaient à un axe Nord-Sud par rapport à l’axe dominant des montagnes Ouest-Est. Si elles pouvaient devenir un danger d’invasion pour des conquérants elles recelaient aussi un avantage, celui des échanges qu’elles ont su très bien développer. A l’époque, les densités humaines y sont très importantes.
Les gaves dont nous avons fait allusion traversent des coteaux, eux-mêmes coupés par des vallées de moindre importance que nos vallées montagnardes, on peut mentionner celles de l’Entre-Deux-Gaves, le Vic-Bilh.
Rappelons avant tout que la vision des champs que nous avons actuellement ne correspond à celle qu’elle offrait au XVIIIe siècle. Les parcelles à l’époque sont de dimensions plus petites qu’aujourd’hui, si elles nous apparaissent avec des formes bien régulières ce n’est pas le cas dans le passé. En Béarn, dans les vallées des Gaves et les vallées montagnardes elles couvrent généralement une quinzaine d’hectares voire seulement dix. Elles sont plus importantes dans les zones de collines.
Quant au sol, selon le type de labour pratiqué, il peut apparaître plus ou moins inégal. Si l’on utilise la culture sur billons surtout sur des terres argileuses lourdes le sol ne montre pas la même apparence que si l’on pratique le labour en planches on cultive avec une charrue non réversible. Le contemporain de l’époque pouvait s’émerveiller des nombreuses couleurs qu’il voyait en apercevant les champs. Sur une parcelle donnée, plusieurs variétés de plantes coexistaient d’où des contrastes de tous types, la hauteur, la couleur. Si le paysan actuel emploie fréquemment des herbicides, au XVIIIe siècle les plantes sauvages comme les herbes et les fleurs étaient davantage présentes, comme par exemple le coquelicot.
Quant aux bois et forêts ils offrent de nombreuses variétés qui s’expliquent par le climat océanique qui domine (forte pluviosité dans les zones de plaines notamment), la diversité des terrains (comme par exemple des terres lourdes ou couvertes d’humus) et des types de reliefs comme la plaine ou la montagne.
On y trouve comme essences des chênes (pédonculés ou tauzins), des hêtres et des châtaigniers dans les zones du piémont et sur les coteaux, sur les versants montagneux les mêmes essences jusqu’ à près de 1 000 mètres d’altitude, au-delà des sapins. Le constat de l’Intendant Lebret dans son rapport de 1701 et le recensement général des forêts de 1785 déplorent l’état de dégradation de la forêt béarnaise dans son ensemble. Plusieurs causes expliquent cet état de fait. La croissance démographique , les défrichements, l’exploitation par la marine royale soucieuse de doter ses navires de mâts, des pratiques exercées par les Béarnais comme le soutrage (se procurer les feuilles mortes, le bois mort dans les forêts) , le pacage (droit de faire paître le bétail dans les forêts) , les forges sont également en prendre en compte (il en existe 9 en 1771).
D’après ledit recensement de 1785, il ressort que les bois communaux sont moins étendus en plaine que dans les zones montagneuses. Dans ces dernières, ils sont implantés sur les versants pentus et bien exposés. L’essence prédominante est le chêne.
L’avocat Charles de Picamith, dans son volume 2 de sa « Statistique générale des Basses-Pyrénées » datant de 1858, mentionne que par rapport à la superficie du département qui s’étend alors à 762 265 ha l’étendue de la forêt n’est que de 145 700 ha approximativement, qu’elle a baissée. Si on écarte les bois appartenant à l’Etat, aux communes et à quelques particuliers, il ne reste que « des bouquets d’arbres éparts sur des landes incultes ou à l’état de pâture et trop clairsemés pour mériter la dénomination sous laquelle ils se trouvent inscrits aux matrices cadastrales. »
Les deux vallées correspondant aux Gaves d’Oloron et de Pau atteignent des longueurs avoisinant les 60 à 80 kilomètres. Ces deux « arribères » sont orientées toutes les deux selon un axe Sud-Est Nord-Ouest. Les orages et fontes des neiges les grossissent et provoquent des crues dévastant parfois les terrasses alluviales.
Christian Desplat en décrivant les ribeyres (terrasses alluviales) nous dépeint un paysage agraire composé « d’un habitat fortement concentré, ...une grande diversité de cultures très imbriquées. Les rivières des gaves de Pau et d’Oloron offrent des paysages comparables. Un habitat groupé s’est installé sur la moyenne terrasse... ». Plus précisément, l’habitat groupé était un plus relâché sur la rive gauche du gave de Pau.
Entre les localités d’Orthez et de Pau les terrasses alluviales sont plus étroites expliquant des superficies agricoles restreintes et des habitats moins groupés. Près de Pau, la lande a néanmoins dominé durant longtemps ce qui permettait aux paysans de pratiquer le pacage et le soutrage. L’habitat était plus dispersé, les exploitations agricoles se greffant davantage aux champs.
Au bord du gave, « le lit majeur...comportait une « saligue », véritable forêt galerie aux multiples ressources » notamment pour les plus pauvres « qui lâchaient des troupeaux de chèvres dévastateurs ». Cedit lit majeur est pavé de galets où poussent des saules, des aulnes , des noisetiers… mais également des chênes et des peupliers par l’entremise des hommes.
En ce qui concerne la ribeyre d’Oloron le « cloisonnement est un peu moins prononcé », la cause en revient aux « enclosures du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle » 5
Il nous rappelle qu’à l’époque les crues des gaves étaient dévastatrices comme cela a été mentionné plus haut. A l’origine, ces terrasses ne sont pas globalement fertiles vu que le sol argileux qui repose sur des galets souffre d’une insuffisance de chaux et de phosphates. L’homme, par son travail, réussit à drainer, à fertiliser ce qui explique l’habitat groupé propre à l’organisation collective.
Il rajoute que dans les ribeyres la céréaliculture était associée à l’élevage. Les Béarnais ont cherché à introduire la viticulture au début du XVIIIe siècle mais n’ont pu produire qu’un vin de moindre qualité. Le même auteur mentionne que les ribeyres ont connu « une prolifération nouvelle d’enclos » mais « les rotations, la vaine pâture restèrent toutefois longtemps encore les traits dominants de leur économie agraires ». 5
Si l’on se penche plus profondément sur la plaine de Nay située globalement à la confluence des cours d’eau l’Ouzon et l’Ousse. Enserré par deux lignes de coteaux , le Gave de Pau dans lequel l’Ouzon se jette sert également de limite occidentale et est encadré par la saligue. La plaine s’allonge sur une distance d’ une vingtaine de kilomètres. Le Gave a imposé aux hommes sa loi lors des crues parfois si dévastatrices qu’elles détruisaient les habitations et les cultures obligeant la population à s’unir. La solidarité villageoise, le travail fait en commun afin de faire front aux caprices du cours d’eau expliquent comme cela a été écrit plus haut l’habitat groupé. Des règles furent prises, par exemple, pour forcer les habitants à ne pas édifier des bâtiments et à planter des arbres dans des zones bien délimitées. Bénéficiant de coteaux boisés aux alentours, la communauté se servait des terres lui appartenant pour l’usage du pacage des animaux et du soutrage. Ce dernier consistant dans ce cas à permettre chaque année la récolte de la fougère qui servait de litière procurant ainsi de la fumure. La plaine de Nay a toujours été considérée comme une zone agricole riche notamment dans la culture céréalière, surtout en blé et en maïs. L’élevage n’était pas négligé (chevaux, bovins).
Les rivières, au XVIIIe siècle, jouent un rôle de plus en plus important économiquement et même politiquement puisque les villes qui s’y rattachent dominent celles des coteaux. Il cite l’exemple de Morlaàs qui a « dû céder la place ». Même les routes royales ont abandonné les crêtes pour suivre les cours d’eau.
Le plateau de Ger est composé de « villages groupés », celui de Morlaàs, au contraire se distingue par des « villages dispersés, de fortes exploitations...et une présence nobiliaire importante... ».
Le Pont-long, « immense glacis alluvial », est un relais « de la grande transhumance », où les touyas, véritable fumier, permettaient aux cultivateurs de se passer de la jachère.
Le Nord et l’Ouest du Béarn sont constitués d’habitat dispersé avec une association polyculture et élevage. »
Le Vic-Bilh – vieille circonscription - présente un habitat dispersé où la viticulture et l’élevage étaient associés.
Son paysage est formé de vallées et de collines. Les versants est sont plutôt secs et sont plantés de bois alors que ceux de l’ouest sont davantage propices à la culture.
Les fermes ont des toits pentus, les façades sont plutôt orientées vers l’Est afin d’éviter les inconvénients dus à la pluie et au vent en provenance de l’Ouest. La tuile prédomine.
Quelques communes ne comptaient pratiquement que des fermes isolées enserrant un petit centre : Claracq, Sévignacq, Ribarrouy.
Ce que l’on appelle le pays des Luys et du Gabas qui s’étend du Vic-Bihl au Nord-Ouest du Béarn est aussi composé de collines avec des bois de chênes et de châtaigniers et de vallées constituées de landes et de bois. Les localités sont édifiées sur les hauteurs
Aux environs de Morlaàs, nous sommes en présence d’une « haute plaine » dans laquelle les villages sont « de taille médiocre ». « De fortes exploitations ponctuent un parcellaire coupé de très nombreuses haies. » 6
« Du Nord-est d’Oloron au Nord de Sauveterre-de-Béarn » les coteaux sont le « pays au bois ». Les vallées sont « encaissées, trop étroites... ». 7 Les « villages sont constitués d’exploitations isolées ».
« Autour de Bougarber et d’Arthez-de-Béarn, tous les villages sont de petite taille et l’habitat dispersé l’emporte au sein d’un bocage inégal. A une céréaliculture longtemps médiocre ces petits « pays » associèrent toujours un élevage vigoureux de porcs qui furent vendus à Arthez (« lou bitous d’Arthez »). Salés à Orthez, ils étaient enfin négociés à Bayonne ». 7
Toujours d’après le même auteur, la mise en valeur de la province se serait opérée « par épisodes successifs, sans toujours commencer par les meilleures terres. Dans tous les cas, il n’y eut aucune vague brutale de défrichements et la tradition attestait le lent passage d’une activité strictement pastorale à l’équilibre agro-pastoral qui prévalait encore au XVIIIe siècle. » 8
Jean Caput , pour sa part, dans son étude sur les anciennes coutumes agraires dans la Vallée du Gave d’Oloron écrit que « les vieilles formes d’exploitation », c’est-à-dire l’assolement triennal et l’exploitation communautaire, caractérisent les « ribères » (ou « ribeyres ») . Les communes sont quasiment autosuffisantes, elles détiennent des forêts importantes « sur les coteaux bordant de part et d’autre les vallées… échappant au monopole d’un particulier » même si ce dernier appartient à la noblesse vu que les paysans à l’époque détenaient des droits d’usage, et de citer la coupe, le ramassage du bois mort, la glandée et le pacage. 9
Prenons un exemple, le cas de Bruges.
La part de l’élevage dans ce village du piémont pyrénéen est importante en jugé aux nombreux conflits constatés entre la cité et les communautés environnantes telles Asson et Igon. Même si Annie Suzanne Laurent observe que « dans chaque propriété agricole, les surfaces de prés dont le terroir de 1782 donne la superficie, paraissent bien réduites. Leur total ne donne que 319 arpents sur 2911 arpents de terre, soit à peine 11% ». Elle ajoute pour expliquer ce chiffre relativement bas : « Il faut déjà penser que les terres labourables peuvent servir de terrain de pâture entre les récoltes et l’ensemencement. En fait, l’été, l’essentiel du bétail des membres de la communauté étant dans les estives, les prés n’ont d’intérêt que pour faire des réserves de foin et nourrir des animaux, peu nombreux, restés près de la ferme en raison de leur utilité journalière : quelques bêtes de somme, éventuellement une vache pour le lait…Au demeurant subsistent partout les vastes espaces que sont les châtaigneraies, bois et fougeraies. »
Ensuite, l’auteure se penche sur l’agriculture de subsistance. Les terres labourables concernent les 2/3 des terres. 10
Autre exemple, celui de la vallée du Gave d’Oloron qui est couverte de champs « découpés en longues lanières, groupés par quartiers et soumis à deux contraintes : l’assolement obligatoire et la vaine pâture ». Ce dit assolement était biennal et « la jachère inconnue ». Jean Caput l’explique par l’utilisation importante du fumier. « On faisait alterner les grains menus (millet, avoine et orge) semés au printemps et les gros grains (froment et seigle) semés en automne. La vaine pâture s’avérait presque inexistante « puisque la sole en jachère était utilisable seulement pendant quelques mois » puis lorsque la moisson avait été faite « les champs retombaient dans le domaine commun (devenaient vains)… » permettant au cheptel de la communauté de « pâturer sur les chaumes et dans les bois mêlés de landes », toutefois il fallait tenir compte du privilège du seigneur des « herbes mortes » (location vis-à-vis des « pasteurs transhumants ») tant décriées par les paysans comme on l’a vu dans les cahiers de doléances. La même auteure explique l’existence de ce système comme un résultat d’une « structure sociale particulière et une mentalité abolie ». Au niveau historique, les gens, constitués de petits propriétaires, « se partageaient une très mince bande de terre alluviale » et se regroupaient afin de ne pas « gaspiller des bonnes terres », écartant tout procédé de clôture comme les murettes et les haies. Tout le monde, même les paysans les moins fortunés, bénéficiaient du « pacage commun ».
Une division est opérée au niveau du terroir entre une « plaine supérieure » et une « plaine inférieure » correspondant aux surfaces cultivées « en amont ou en aval du village, ou bien des deux côtés du principal chemin rural, des croix précisant les limites ».
Quand les récoltes sont achevées, on introduit le bétail sur la moitié des terres du fait de la rotation des cultures. Mais au XVIIIe siècle, comme nous le verrons ultérieurement, certains propriétaires veulent corriger tout le système que nous venons de voir c’est-à-dire que « Certains laboureurs voulurent échapper à ce repos forcé et faire prédominer l’intérêt de l’agriculture intensive sur l’élevage extensif », une des raisons à ce phénomène est l’apparition d’un certain individualisme. 11
Lorsque les clôtures sont dressées de quels matériaux sont-elles composées ? Le même auteur nous détaille plusieurs types comme celle constituée de sep, de pieux ou de branches comme on pouvait l’observer à Sainte-Marie d’Oloron, de « muraille cimentée » dressée par les riches propriétaires de Barreau à Bugnein en 1754, de barrière afin de faciliter le passage du bétail, d’aubépines, de pieux (ou pau). 12
Les paysages montagnards béarnais sont découpés par les trois vallées que sont celles de Barétous, d’Aspe et d’Ossau. Les monts sont auréolés de croyances surnaturelles, ils occasionnent de la crainte. Les Béarnais pensaient que le pic du Midi d’Ossau servait de résidence à des géants qui s’engouffrait dans ses entrailles par le biais d’un escalier, de même que le pic d’Anie aurait été un lieu habité par des sorcières.
Du fait des contraintes climatiques, les vallées sont densément peuplées à l’opposé des montagnes. Aux villages qui parsèment le fond des vallées, les flancs des montagnes sont occupés par des champs, des prairies et des forêts qui se superposent. Leurs dispositions dépendent de leur localisation en rapport avec les versants correspondant à l’ombrée (ou ubac dans les Alpes, correspond à la partie à l’ombre) ou à la soulane (ou adret dans les Alpes soit la partie ensoleillée).
Les hommes ont du édifier des murettes de pierre pour consolider les bandes de terre qui leur servaient de champs.
Les toits des fermes sont couverts d’ardoises produites localement.
Si l’on se penche sur la vallée d’Ossau, celle des trois la plus importante sur le plan démographique, est partagée en deux zones. La première, d’une altitude moyenne de 500 mètres, est plus évasée ce qui explique que les Ossalois y ont établi plusieurs villages. Elle s’étend de Sévignac à Laruns approximativement. Les hommes y ont planté des grains mais ont dû faire face à des crues. La seconde se poursuit jusqu’à la frontière espagnole et s’élève en altitude. L’élevage lié à la transhumance a son importance vu que la production céréalière s’avère insuffisante. Les Ossalois retirent de la vente des animaux et des produits laitiers de quoi compenser ce manque à gagner. L’épizootie de 1774 qui décima grandement le cheptel bovin amena les Ossalois à privilégier les ovins.
Quant à la vallée d’Aspe elle s’étend du défilé d’Escot jusqu’au col du Somport sur une distance avoisinant une trentaine de kilomètres. Elle est plus encaissée que la précédente sauf au niveau du bassin de Bedous. Si dans cette zone il était possible de récolter des grains vu son caractère plat par contre dans tout le reste l’élevage prédominait. Le contrôle par les Aspois des pâturages était essentiel, ils appartenaient à la communauté alors qu’au fond de la vallée la propriété était davantage individuelle. Comme dans la vallée d’Ossau les pâturages à travers le droit de pacage étaient réglementés. De même au niveau des villages une véritable organisation sociale s’était établie depuis longtemps au profit des maisons dites casalères. La vallée grâce à l’altitude moins importante du col du Somport par rapport à ceux des autres vallées était une grande voie de passage des hommes et des marchandises vis-à-vis de l’Espagne et plus particulièrement de l’Aragon.
Enfin, concernant la vallée de Barétous , on peut la diviser elle aussi en deux parties, une située autour d’Arette, d’altitude moins élevée puisque la moyenne est de 400 mètres . On y trouve des collines où les prairies dominent et les bois sont peu importants. A l’opposé de la haute vallée dans laquelle on relève la forêt d’Issaux et le gouffre de la Pierre Saint-Martin niché dans un paysage calcaire.
On note que cette vallée offre de bons pâturages aux bovins qui ont été peu touchés par l’épizootie de 1774 et les ovins. L’élevage a été aussi l’activité économique qui a compensé la faiblesse des productions céréalières.
Dans l’ouvrage de Pierre-Yves Beaurepaire 13 une étude est entreprise sur l’appréhension et la représentation des paysans sur les terroirs. Pour eux, « l’espace vécu est d’abord un espace perçu ». Le temps est appréhendé en journées de travail ou selon le moyen de déplacement (pied, cheval) et non en heures, il travaille selon le rythme des saisons ou celui de « la course du soleil ». S’il doit aller vendre le fruit de sa récolte au marché de la ville voisine, il estime le temps qu’il met pour l’atteindre et pour revenir avant que tombe la nuit. Des éléments de bornages répartis dans le zonage vécu lui permettent de se repérer comme les croix dans les carrefours, les chapelles…Et de citer Jean-Michel Boehler 14 lorsqu’il écrit : « la traditionnelle lieue est une mesure bien trop grande par rapport à l’univers étroit de la
paysannerie. On préfère s’exprimer en langage imagé : les distances sont évaluées en portée de mousquet ou en jet de pierre…Le paysan apprécie le monde qui l’entoure en utilisant comme étalon les parties de son propre corps : le pied, la coudée, le pouce ». A travers les régions françaises, on peut discerner différentes unités de superficie mais elles sont déterminées en fonction du temps consacré au travail, si on prend l’exemple du laboureur qui utilise la charrue il appellera « arpent » l’ensemble de la zone que peut labourer ses bœufs ou ses chevaux entre l’aube et le crépuscule. De plus, sa perception de l’espace dans lequel il baigne est différente de celui du seigneur et de l’agent fiscal. Il privilégie les chemins, les bois, les terres, l’église, le château de son seigneur, son monde gravite autour de son village, de la ville voisine où il se rend au marché. Quant au seigneur, il perçoit sa seigneurie « comme l’étendue de sa mouvance, comme un espace juridique ». Il en fait dresser des cartes pour mieux asseoir ses droits qu’il prélève ,ce que l’on nomme les « plans terriers », surtout à partir du milieu du XVIIIe siècle.
Notes :
1- Mémoires des intendants Pinon et Lebret, Bull.SSLA de Pau, 2e série, tome 33, 1905.
2- Idem., p. 38.
3- Idem., p. 72.
4- Desplat, Christian, Pau et le Béarn au XVIIIe siècle, Editions Terres et Hommes du Sud
J & D Editions, 1992, tome 1, p. 20.
5- Desplat Christian : « Principauté du Béarn », Edition « société nouvelle d’éditions
régionales et de diffusion », 1980, p. 24.
6- Idem., p. 25.
7- Idem., p. 27.
8- Idem., p. 32.
9- Caput Jean : « Les anciennes coutumes agraires dans la Vallée du Gave d’Oloron »,
Bull.SSLLA. de Pau, 3e série, tome 15, 1955, p. 62-63.
10- Annie Suzanne Laurent, La bastide de Bruges de ses origines à la Révolution, TER,
Université de Pau et des Pays de l’Adour, Histoire de l’art et archéologie, 2001,
p. 67.
11- Caput, Jean, Opus cité, p. 65.
12- Idem., p. 68.
13- Beaurepaire Pierre-Yves : « La France des Lumières (1715-1789) », Collection
« Histoire de France » sous la direction de Joël Cornette, Belin, 2011, p. 549-553-569.
14- Boehler J.M : «Une société rurale en milieu rhénan : la paysannerie de la plaine
d’Alsace (1648- 1789) », Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1994,
tome 1, p.46.