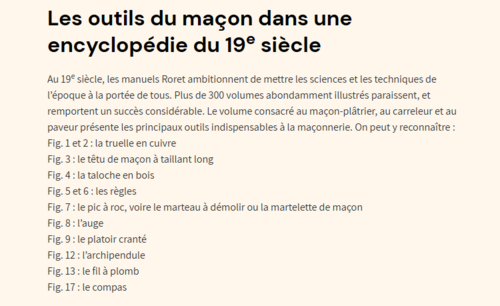-
Par Michel64a le 6 Août 2024 à 12:59
Les formes d’exploitation de la terre
a- Qu’en est-il dans le royaume de France ?
Le voyageur Arthur Young constate que tous les paysans français sont propriétaires, ce n'est pas tout à fait faux. En fait, la majorité d'eux possèdent en moyenne 2 hectares de terres. Qui est propriétaire en France ? La réponse est malaisée puisque cela dépend du lieu où on vit. Si on tente de généraliser, on peut avancer timidement que près d'un quart des terres appartient à la noblesse (22%), que le clergé en possède moins de 10 % (8%) contre près de 30 % pour la bourgeoisie, le reste, soit les paysans ,40%.
Les formes d'exploitation de la terre varient également d'une région à l'autre.
L’exploitation agricole, pour un paysan, est une unité de production permettant à lui et à sa famille de subvenir. La taille varie, si elle est petite (1 à 3 ha le plus souvent, elle n’offre qu’un complément de revenus pour certaines catégories de personnes comme un artisan rural ou un brassier. Les tâches se font à la main et les individus ne possèdent guère d’attelage. Viennent ensuite les exploitations moyennes avec des superficies avoisinant les 10 à 20 ha et qui ne bénéficiaient pas de capital important. Puis venaient enfin les grandes exploitations où les détenteurs possédaient, par contre, un capital important, un attelage et pouvaient s’adjoindre des salariés agricoles, permanents ou saisonniers, ce qui leur permettait de s’intégrer dans l’économie marchande.
De nombreux statuts anciens ou modernes coexistent, par exemple « l'albergement » , dans le Sud-Est, qui est un contrat de location entre un seigneur et un paysan moyennant une redevance annuelle ou le « bordelage », dans le Nivernais, correspondant à une redevance équivalant à une proportion de la récolte...Toutefois le fermage et le métayage s'implantent très progressivement. Le fermage est le bail annuel entre un propriétaire et un fermier correspondant aux alentours de 6 % du prix de la terre auquel il faut adjoindre des redevances en nature. Ce bail peut être versé en nature, en espèces ou les deux à la fois. D’un côté, le propriétaire apportait un capital immobilier comme la terre, les bâtiments et, d’un autre côté, le fermier apportait un capital d’exploitation, par exemple ses outils, son bétail... Etant donné qu’il est nécessaire de détenir des avances relativement importantes, ce type d’exploitation caractérise davantage les zones rurales des grandes plaines riches du Nord de la France et du Bassin Parisien. Ceci d’autant plus que l'humidité permet la culture de céréales de printemps et que l’on y produit plutôt pour le marché. Ces fermiers ont les moyens le plus souvent de s’allouer des valets, des serviteurs, un attelage afin de labourer, d’où le nom de « laboureur » qui leur est donné. Il arrive qu’il prenne à ferme la perception des droits seigneuriaux sur les tenanciers ou en bail à cens l’exploitation de moulins, de forges… La durée du bail variait selon le type d’assolement, le plus souvent s’échelonnant de 3 à 8 ans - concernant l’assolement biennal : 4,6 ou 8 ans, tandis que pour l’assolement triennal : 3, 6 ou 9 ans. Comme ce type d’exploitation s’intégrait de plus en plus dans l’économie monétaire et que le libéralisme économique s’imposait de plus en plus dans l’esprit d’agriculteurs, les preneurs n’hésitaient pas à spéculer sur les grains et à innover. Ce sont ces fermiers qui profitant de leur puissance économique tiennent de plus en plus dans le village une place de plus en plus grande. S’ils emploient des salariés, ils participent à l’économie du village en passant des commandes auprès des artisans. Cette domination est assurée aussi par le prêt qu’ils assurent auprès des autres paysans comme l’attelage, des outils... mais aussi de l’argent, ce qui entraîne bien sûr une dépendance des demandeurs. Cette domination s’exerce alors d’autres manières, ils peuvent devenir des receveurs seigneuriaux, exercer des charges dans la communauté.
Tandis que le second concerne beaucoup plus les zones pauvres notamment dans l'Aquitaine (bail entre un propriétaire et un métayer qui lui doit une partie de la récolte, le premier lui fournissant le capital soit le bétail, les semences, la charrue…), ils produisent un peu de tout sur de petites parcelles. La métairie « est le plus souvent une petite exploitation, assurant à peine la subsistance de l’exploitant, alors que le seigneur (le propriétaire) est à peu près assuré de revenus en nature par le cumul de plusieurs métairies ». 1
Le contrat établi est de courte durée en général. Le locataire se charge de cultiver, d’entretenir les bâtiments... Le système s’implante bien dans les régions où les capitaux agricoles et l’économie monétaire faisaient défaut. Mais il ne suscite pas non plus la recherche d’innovations. La condition des métayers n’a pas arrêté de se dégrader sous l’Ancien Régime. Par exemple, on constate que le bailleur est amené à faire de plus en plus d’avances, notamment en ce qui concerne le bétail, entraînant une situation d’endettement structurel de la part du locataire.
Les deux formes de tenure peuvent également coexister.
Les paysans se différencient entre eux par la possession de la charrue et des animaux de trait et la terre, bien entendu. D’abord, le laboureur, qui peut être à la fois exploitant de faire-valoir direct et fermier. Il peut vivre suffisamment pour vivre dans l’indépendance) et il fait partie du groupe des notables des paroisses. Il intègre la petite partie de ceux qui détiennent le marché de l’emploi. Leur part, dans la communauté, correspond le plus souvent à moins de 10 %.
Certains d’entre eux sont même en étroite relation avec les seigneurs lorsqu’ils afferment un fragment de la réserve et des droits seigneuriaux, ils peuvent même travailler pour eux comme intendant. Ce qui peut parfois engendrer des heurts au sein de la communauté lorsque des troubles surgissent envers les droits seigneuriaux et qui pointent parfois, en réalité, les fermiers. 2
D’autres diversifient leurs activités, ils assurent des occupations artisanales comme celle de tisserand.
Vient ensuite le petit propriétaire qui peut être contraint de travailler hors de chez lui pour subvenir. Pierre-Yves Beaurepaire précise que ces exploitants, souvent appartenant à des couples apparentés, tentent d’établir ensemble un capital d’exploitation, par exemple un train d’attelage. Il rajoute une autre classe de paysans « moyens » que l’on appelle « métayers », haricotiers, bordiers… qui sont détenteurs de 5 à 10 hectares de terres et qui louent d’autres parcelles afin d’accroître leurs revenus. Eux également ont la possibilité de travailler pour les « coqs des villages » (laboureurs) ou s’exercer à l’artisanat. Leur vie serait plus « enviable » dans les régions de polyculture et d’élevage « car les contrastes économiques et financiers semblent moins accusés » du fait d’une moindre nécessitée d’outillage et de « travail salarié ».3
Enfin, le brassier ou journalier, qui ne possède pas de terrain, que l’on nomme le sous-prolétariat et qui, pour subsister, est contraint à la mobilité et à une embauche qui peut s’avérer désastreuse, l’entraînant alors au chômage, voire le vagabondage. Les journaliers représentent souvent plus de la moitié des individus de la communauté du village. Ils sont propriétaires parfois de quelques tronçons de terres et de jardins. Pour P.Y.Beaurepaire, les nouvelles cultures permettraient à ces brassiers, journaliers ou manouvriers de leur donner davantage d’emplois puisqu’il devient nécessaire de « sarcler, piocher, butter ». 4
Pour terminer, penchons-nous sur les domestiques de ferme qui ne possèdent rien. L'artisanat rural est nécessaire pour pallier le manque de revenus qu'offre l'agriculture à beaucoup de paysans.
Ces paysans intermédiaires peuvent évoluer dans le temps soit positivement (passer de domestique, à journalier puis de petit propriétaire d’une dizaine d’hectares) mais également négativement (régresser socialement, car il n’est plus possible au paysan propriétaire de garder une exploitation viable et se trouve dans l’obligation de louer ses bras…).
L’activité des ruraux ne consiste pas seulement au travail agricole outre les artisans dont l’activité est liée aux besoins locaux comme les forgerons, les charrons, les meuniers… Il existe des individus que l’on inclut dans ce que l’on nomme la « manufacture dispersée », une production à domicile. Ils font partie intégrante de la production industrielle, surtout dans l’industrie textile (tissage) notamment lors de la morte-saison. En gros, cela consiste à ce qu’un paysan fabrique des toiles entre autres en usant d’un outillage lui appartenant souvent. Un marchand fabricant de la ville lui apporte la matière première, à lui à charge de la transformer. Il viendra récupérer le produit fini et lui versera un gage de façon. Le paysan dépend totalement de ce fait du marchand, devenant ainsi ce que l’on nomme des façonniers. Rien à voir avec le maître artisan œuvrant en ville qui est, lui, indépendant.
La terre pour les paysans a pour finalité la subsistance et peu comme une source d'enrichissement pour la majorité d'entre eux.
b b- Et pour ce qui concerne le Béarn ?
Les propriétés rurales sont exploitées selon deux méthodes. L'une, le faire-valoir- direct et, l'autre, le métayage. Le premier est propre à la mentalité béarnaise désireuse de conserver le patrimoine familial à travers le système d’héritage incombant à l’aîné (homme ou femme), le cadet, s’il reste, étant considéré comme une aide. Ce mode est associé à la notion d’ostau (maison). M.P Foursans-Bourdette note que « la location de terres indépendantes des propriétés est peu courante. 5 Le fermage est inconnu.
Quant au métayage, elle mentionne que les nobles sont généralement propriétaires des métairies, par contre, les bourgeois le sont très rarement. Le contrat est établi pour une durée de six ans, à mi-fruits, auprès d’un notaire. La seule condition établie est le partage des fruits en nature, ceci par moitié. Pour simplifier, le bail à mi-fruit associe le capital d’un propriétaire et le travail fourni par un exploitant. Exemple de contrat passé entre un propriétaire et son métayer, en 1741, celui passé au sujet des terres dites « Pécarraté et Labarraque » à Espoey, stipulant que ledit propriétaire percevra de son métayer la moitié de deux porcs gras et la moitié des oisons des oies. 6 Par conséquent, le seigneur a intérêt à ce que tout se passe bien et veillera à ce que toutes les actions entreprises du métayer soient correctement faites. Second type de bail, celui de bail à ferme, il est signé pour une durée limitée. Le preneur s’engage à verser une somme fixe. Si dans le contrat, ce dernier afferme la totalité de la seigneurie, c’est lui qui prélève non seulement les revenus de la réserve, mais également des droits seigneuriaux touchant les tenures. Le fermier « délègue », le plus souvent, l’exploitation des terres par des métayers qui eux contractent des baux de métayage. Le métayage, selon Christian Desplat, venait en « aide et support » aux petits exploitants .7
Les « laboureurs » (représentants dans le Béarn, d’après Christian Desplat, la proportion de plus d’un quart de la population active qui assurent régulièrement leur subsistance en règle générale. Mais le même auteur rajoute que la différence « était négligeable entre certains journaliers aisés et de nombreux laboureurs ». En ce qui concerne les laboureurs de Pau, ils appartiennent à la moyenne bourgeoisie. Le même auteur écrit, que pour maintenir leur niveau de vie, ils appliquaient « strictement les règles de l’aînesse ». Leurs dots en espèces n’étaient pas très importantes, mais leurs réserves monétaires n’étaient pas négligeables. Leurs biens fonciers « au moment du mariage excédaient rarement un hectare » mais les animaux appelés « semences » comme la jument, la brebis donc capables de procréer étaient également abondants.8
Il existe les « sans terre », les journaliers ou manœuvriers. Christian Desplat les estime à un quart de la population active. Ils sont condamnés à ne pas pouvoir travailler durant l’hiver. Selon le même auteur, eux aussi, ont des conditions de vie diverses. Il cite, par exemple, le cas d’un Gersois, d’Auch exactement, venu s’installer à Pau, Barthélémy Tartanibe, n’ayant à sa possession que 150 livres. Mais, il se marie avec une femme, dispose de « 99 livres, d’un lit, de deux armoires, deux tabourets, des chenêts, de chandeliers et vaisselle d’étain, d’une poêle, d’un « fair à lisser », d’un miroir et de six paires de draps. » 8
Pour lui, ils sont « rarement démunis » car ils « possédaient maison et jardin et entretenaient quelques bêtes sur les terres communes ». 9
Leur existence dépend en fait de l'état de la récolte, il suffit d'une disette, d'une récolte catastrophique pour qu'ils soient réduits au chômage, voire même à la mendicité.
Jean Tucat cite l’exemple de Jean-Philippe de Béla qui, pour ses terres de Hours, versait un salaire, en 1781, de quinze sous pour la période d’été s’étalant du 25 mars au 8 septembre à ceux qui ne sont pas « nourris » tandis que ceux qui sont « nourris » le montant est de dix sous. La discrimination s’opère quand il s’agit de rémunérer les femmes, car lorsqu’elles ne sont « pas nourries » le salaire est de dix sous et de sept sous quand elles sont « nourries ». Pire, s’ils sont étrangers, notamment Espagnols, puisqu’ils ne reçoivent que « huit sous au lieu de dix » prétextant qu’il ne voulait « pas les payer plus qu’ils ne l’auraient été dans leur pays ». En hiver, l’ouvrier « non nourri » est payé douze sous, sinon s’il est « nourri » dix sous », tandis que la femme ne perçoit que huit sous lorsqu’elle est « non nourrie » et cinq ou six sous si elle est « nourrie ». 10
Qu’en est-il des valets des fermes ? Toujours dans l’ouvrage de Jean Tucat, il est mentionné que le rôle de la capitation de la localité d’Espoey dénombre 31 domestiques, autre exemple cité dans le livre de raison du chevalier Béla qui nous révèle les salaires des valets de ferme des années 1781 à 1790. Il leur est alloué de 75 livres à 250 livres en plus d’être logis et nourris, ceux qui perçoivent une plus grande rétribution sont le régisseur (150 livres) et le cuisinier (250 livres). Comme précédemment, les femmes sont moins bien rémunérées, moitié moindre vis-à-vis des hommes. Une distinction est faite entre les gages alloués au village d’Espoey et ceux de la ville de Pontacq puisqu’on verse en supplément des vêtements (chemises, vestes…).
Si les droits seigneuriaux sont contestés dans le détail, ils ne le sont pas dans leur globalité. Par exemple, dans le cahier des doléances d'Angaïs, on réclame la suppression de la banalité et les corvées, à Assat, on demande que tous les ordres de la société, enfin, dernier exemple, à Castetpugon, il est requis que les nobles payent la taille et contribuent aux corvées. Elle vit à la campagne du produit de ses terres. Nous ne nous attarderons pas sur la propriété ecclésiastique comme nous l’avons vu, car elle ne représente que trois millièmes de la superficie, ni sur la propriété bourgeoise, peu fréquente en Béarn. 11
Le Béarn a bénéficié, durant les XVIIe et XVIIIe siècles, d'un léger accroissement démographique, expliqué en partie du fait que la population est mieux nourrie, mais aussi grâce au vieillissement de la population et à l'immigration. Le pays, par voie de conséquence, devient une terre d'émigration. Le droit d'aînesse, implanté en force dans les coutumes béarnaises, provoque le départ des cadets qui, afin d'éviter d'être pauvres chez eux, préfèrent partir. On pense à ces Béarnais pauvres ou même membres de la bourgeoisie partant vivre en Espagne ou y travailler quelques mois. Ce courant migratoire remonte au Haut Moyen Age, notamment au moment de la " Reconquista", il s’accentuait au moment de graves crises comme la famine ou le chômage comme ces ouvriers oloronais frappés par la crise du textile suite au protectionnisme espagnol. A partir de la seconde moitié du XVIIIe, le départ des émigrés béarnais vers l’Espagne se ralentit. A côté de ce courant, il en existe un autre en direction de l’Amérique particulièrement vers les « Isles », on peut citer l’exemple de ce Pierre de Laclède, cadet, qui fonde la ville de Saint-Louis en 1764. Ce sont les Antilles puis Saint-Domingue qui sont les lieux les plus « courus » par les Béarnais. Qui sont-ils ? Des jeunes, instruits qui quittent le Béarn en général dans l’intention de revenir « fortune faite ».
L’abbé Bonnecaze 12 expose les problèmes de l’émigration et de l’immigration qu’il relie avec celui des cadets. A l’époque à laquelle il écrit, il déclare qu’il nous manque des bras dans les campagnes. Il fustige les villes qui « attirent beaucoup de Paysans par le scandaleux appas de la domesticité, elles en transforment en Artisans mous et lâches : mais il resteroit encore assez de bras pour la culture : que deviennent-ils donc ? Ils passent en Espagne : quoi, pendant que l’Espagne elle-même recrute nos campagnes !... cette singularité est l’effet de notre coutume…» qui « déshérite nos cadets, et qu’après que l’âge et la vigueur les ont, pour ainsi dire, émancipés, ils se hâtent d’aller chez l’étranger chercher une patrie comme pour se venger de ce que leur famille les traite en quelque sorte comme étrangers. Nos Paysans sont propriétaires, même de fonds assez considérables, ce qui soutient la culture : ils ont besoin de bras, ils font des enfants, compagnons plus agréables, travailleurs plus sûrs que des mercenaires. Mais lorsque ceux-ci se trouvent réduits à une si petite portion d’héritage qu’ils ne peuvent sortir de la maison paternelle que pour devenir Journaliers, ils s’expatrient. Souvent on aime mieux être pauvre ailleurs que chez soi. Quoiqu’on soit attaché à ses freres, l’on souffre de voir l’aisance d’un pere commun dans les mains d’un seul. Enfin l’Espagne est, depuis longtems, regardée comme un Pérou. Pendant que des Espagnols viennent ici chercher de l’ouvrage, nos Laboureurs vont en Espagne chercher fortune…»
Mais l'émigration n'est pas la seule réponse apportée aux problèmes soulevés par la croissance démographique. Par l'action des Intendants et l'introduction du maïs, le Béarn connaît, durant la seconde moitié du XVIIIème siècle, un « renouveau » économique. Mais la prospérité relative dans laquelle vit alors le Béarn n'est pas générale.
Comme ce sont majoritairement des ruraux, le village est bien entendu le cadre de vie par excellence , et de surcroît la communauté qui peut être source de bienfaits, pensons aux pauvres qu'elle s'est occupée, mais aussi être un facteur d'antimodernisme.
Notes :
1-Méthivier, Hubert, L’Ancien Régime, PUF, Que sais-je ?, 1968, p. 24.
2-Beaurepaire, Pierre-Yves, La France des Lumières (1715-1789), Collection « Histoire de
France » sous la direction de Joël Cornette, Belin, 2011, p. 549-553-569.
3-Idem., p. 570.
4- Idem., p. 574.
5-Foursans-Bourdette, MP, Histoire économique et financière du Béarn au XVIIIème, Bordeaux : Bière, 1963.
6- ADPA., III. E 5303.
7- Desplat, Christian La principauté de Béarn, Editions Marrimpouey jeune, 1980, p. 33.
8- Idem., p. 515.
9- Desplat Christian, Billère, aujourd’hui, hier village, Revue de Pau et du Béarn, n° 18, 1991,
p. 67.
10- Tucat Jean, Histoire de la région de Pontacq (Béarn et Bigorre) de 1701 à 1789, réédition
septembre 1987, RP AXO SERVICE PAU, p 108.
11- Cahiers des griefs rédigés par les communautés de Béarn, Limendous, extrait du BullL. SSLA de
Pau,années 1886-87, 2e série, tome 16, p. 296.
A.D.P.A., Castetpugon, 14 mai, C 1375.
12- Journal de l’Agriculture, du Commerce, des Arts et des Finances » , publié par l’abbé Dubahat
Bull SSLA , 2e série, tome 39, 1911, 212-213.
-
Par Michel64a le 30 Juillet 2024 à 20:08
Globalement, il est de coutume de différencier deux types de maisons en Béarn selon leur situation. Celle que l'on trouve en montagne qui présente un plan allongé, une hauteur moindre puisque seul un étage, voire deux, offre une façade plantée sur mur gouttereau. Cet allongement s'explique par la juxtaposition de l'habitation et des bâtiments agricoles. Elle est protégée par un toit à deux versants. Les pentes sont abruptes, on pourrait penser que c’est un moyen de bien évacuer la neige et la pluie. Or, ce n’est pas l’unique raison, comme on l’a vu précédemment dans un précédent article.
Ce type de maison est associé à l'habitat groupé.
Quant à l'autre type, il est commun dans les coteaux et les plaines alluviales. Ici, la hauteur la différencie du précédent, car les façades présentent deux ou trois étages, mais également le plan est tout autre vu que les divers bâtiments s'ordonnent autour d'une cour. Le toit diffère aussi puisqu’il est à deux croupes. Ces maisons sont disséminées dans le paysage selon des habitats dits dispersés.
Les maisons qui sont présentes dans les villages béarnais sont implantées « selon un parcellaire en lanières régulier qui résulte soit d’un urbanisme programmé, soit de dispositions constructives (largeur des maisons donnée par la portée des poutres. Sur la parcelle longue et étroite (pour celles qui ont conservé leur disposition originelle), la maison est implantée en front de rue, et présente sur l’espace public une façade en pignon (le faîtage est perpendiculaire à la rue). Lorsqu’à partir des XVIIème et XVIIIème siècles, des maisons sont reconstruites sur deux parcelles réunies, elles présentent sur l’espace public une façade plus longue, et leur faîtage est parallèle à la rue. Les maisons sont accolées et sont séparées par d’étroites venelles qui permettent aux eaux pluviales et domestiques de s’écouler. Cette disposition permet de gérer la mitoyenneté et génère une densité importante, limitant la consommation d’espace. »1
La ferme à cour est typique des zones de ce que l'on nomme en Béarn le piémont, par exemple le Piémont Oloronnais et aussi dans les vallées. L'image de bâtiments dotés de façades symétriques disposés autour d'une cour s'enracine au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Les fonctions sont distinctes, d'un côté les bâtiments à caractère résidentiel présentant une façade plus monumentale, plus longue et plus soignée (notamment par de l'enduit) orientée vers l'est (afin de bénéficier de l'ensoleillement et la protection face aux vents ) et, d'un autre côté, ceux destinés à l'exploitation non couverts d'enduits (les joints peuvent être garnis) ou protégés par un enduit à pierre rase.
En règle générale, comme le mentionne l’article paru dans la « Charte architecturale et paysagère », la demeure « est organisée avec un pignon sur rue (faitage perpendiculaire à la rue). La façade principale est tournée vers la cour et orientée à l’Est, bénéficiant ainsi de l’ensoleillement tout en se protégeant des vents dominants. La grange s’inscrit en prolongement du bâti principal, formant ainsi l’espace de la cour. Son faîtage est soit dans la même orientation que le bâti principal, soit orthogonal à celui-ci ».2
En plaine, l'exploitation agricole se constitue soit à partir de la cour centrale à laquelle on y pénètre par un portail, on l'appelle "maison-cour" ou la "maison-bloc" qui rassemble les activités agricoles et l'habitat. La cour est entourée de trois bâtiments (maison, étable et grange) et est fermée par un mur composé d'un portail donnant sur la rue ; l’ensemble compose l’enclos et forme une unité. La grange est dans la plupart des cas une extension du bâti principal, son faîtage est orienté dans le même sens que ce dernier ou alors à 90 °. Les bâtiments présentent des superficies plus importantes, notamment ceux consacrés à l'exploitation, vu qu'il est nécessaire de stocker davantage les moissons. De plus, la ferme est bâtie sur un terrain plat, le propriétaire peut opter pour l'édification de sa grange un peu plus éloignée que le corps principal.
Attention, cette cour ne présente pas un joli aspect comme on pourrait le concevoir. Actuellement, passé le portail, la cour avec les façades des bâtiments revêt une parure que l'on cherche à rendre belle puisque les visiteurs l'aperçoivent au premier coup d’œil. A l'époque, l'utilitarisme dominait. En effet, le paysan y déverse la tuie , ce que l'on nomme dans le Sud-Ouest les plantes (fougères, bruyères...) utilisées comme litières après les avoir coupées tous les deux ou trois ans. Mais, au fur et à mesure des semaines, cette dite tuie est salie par les déjections des animaux qui circulent et les restes alimentaires déversés par les occupants.
Si ce n'est pas le cas, le propriétaire aura à cœur de veiller à ce que la cour soit bien entretenue et qu'elle offre à la vue un beau spectacle, car elle assure une zone d’accueil. Son souci peut être pratique tout bonnement. Le choix de la calade en galets est le plus probant, ou alors tout simplement, on pose du gravier. L'avantage de ce revêtement est de protéger la cour de la boue et de la consolider. Aux galets, on peut adjoindre dans la réalisation de la calade des moellons de pierre.
Dans ce cas-là, comme on le fait actuellement pour des espaces constitués de pavés ou d’allées, des galets peuvent être posés sur un lit de sable qui permet une assise plane et stable mais aussi de procurer l'infiltration de l'eau.
La superficie de cette cour est d'autant plus importante que le propriétaire est aisé.
Elle permet d'établir un classement « économico-géographique » comme le nomme Jean Loubergé3 Dans les vallées montagnardes (Aspe, Ossau), les cours sont inexistantes, tandis que dans les collines les exploitations agricoles présentent des cours ouvertes vers l'extérieur. Ailleurs, on trouve « des fermes à cour demi-ouverte de grande taille et des fermes à cour demi-ouverte de petite taille ».
Cette cour est la plupart du temps précédée par un portail, qui lui aussi reflète le niveau du propriétaire. De cette ouverture, les humains, les animaux et le matériel agricole l'empruntent ensemble pour entrer dans la ferme. C'est à la fin du XVIIIème siècle que l'on différencie par des portes distinctes les humains et le bétail. Le bois est le matériau utilisé, c'est à partir du XIXème siècle qu'on voit apparaître les vantaux métalliques. L'avantage de ces derniers est d'être plus légers, de s'ouvrir par le biais de gonds, de ne plus être généralement surplombés par une toiture.
Outre le bois utilisé, la catégorie des matériaux comme la pierre, la décoration de l'encadrement sont autant de moyens de montrer son niveau social. Les vantaux sont doublés et décorés, certains en pointes de diamant ou de rosaces. Certains vantaux sont ajourés en haut et pleins en bas, notamment pour éviter les regards des curieux. Habituellement, les vantaux sont portés par des axes-pivots-verticaux. Toutes les fermes n'ont pas de portail et se contentent de disposer de deux piliers de chaque côté de l'entrée. Ces dits piliers sont de pierre, tandis qu'en guise de battants de bois, on place une barrière. Afin que les roues de charrettes ne détériorent pas les bases de piliers, on y ajoutait des pierres arrondies que l'on nomme simplement chasses-roues. Tandis que la partie haute des piliers était souvent décorée par des motifs comme des boules de pierre ou des urnes ou couverte de tuiles ou d'ardoises. Jean Loubergé fait référence à un Livre terrier 4 de Pardies-Monein daté de 1748 qui nous renseigne que les propriétaires payaient un petit impôt de 4 livres. Le même auteur précise que les portails monumentaux disparaissent progressivement puisqu’'ils sont une gêne pour le passage des matériels agricoles. Les portails de bois mesuraient un mètre cinquante environ, notamment en Batbielle et Ousse, et surplombés de toitures « à deux pans ou de « labasses ». 5
Dans certaines parties du Béarn, les portails sont dotés de porche couvert, comme on peut les observer à Buziet, Louvie-Soubiron.
Dans l'article intitulé « Focus les maisons traditionnelles en Pyrénées béarnaises », l'auteur distingue plusieurs types de maisons à cour 6 .
D'abord, il se penche sur la ferme à cour classique qui est courante dans la région d'Oloron et qui se caractérise par un plan en « L » et une grande cour semi-ouverte, distribuant l'habitation sur un côté et la grange-étable en fond de cour. Un petit bâtiment annexe ferme parfois le troisième côté, souvent un poulailler-porcherie reconnaissable à sa toiture asymétrique et à son clayonnage de bois. La maison est coiffée d'une toiture généralement à quatre pans, parfois à deux pans avec demi-croupes, mais toujours avec une légère inflexion en bas de la pente du toit, le coyau. » Quant à la façade principale qui donne sur la cour, elle est réalisée selon le style classique, « composée en symétrie à partir de la porte d'entrée centrale, et les fenêtres sont strictement alignées. Le pignon sur rue est généralement aveugle ou percé d'une seule petite fenêtre. L'utilisation du galet du gave pour la maçonnerie est systématique, enduit pour le corps de logis mais laissé apparent pour la grange. La cour a parfois pu conserver son revêtement en calade de galets. »
Dans la région Batbielle et Ousse, les maisons cossues présentent à l'observateur un corps de logis à trois travées et deux niveaux. Quant à celles qui sont modestes, elles n'ont qu'un seul niveau sous comble mais « restent néanmoins fidèles au principe de symétrie axiale ». 7
Puis, le même article se penche sur la maison à cour étroite, réduite qui forme un mince rectangle, vu que la cour ne sert qu'à pénétrer et non pas à permettre aux matériels agricoles de manœuvrer. « La façade de la grange-étable, en fond de cour, ne laisse parfois la place que pour une porte cochère ». 8 Ce type de maison se trouve dans la vallée de Barétous, « dans le secteur Buzy-Buziet-Ogeu, sur les rebords de coteaux dominant la plaine (Sévignacq, Sainte-Colome), et jusqu'en amont d'Oloron. Mais on la rencontre ponctuellement partout, y compris dans le bassin d'Accous-Bedous et les alentours de Laruns (Aste-Béon)».
Puis, on décrit un autre type, « plus rare », « une cour en largeur sur la rue, organisant la grange sur le côté et le logis en fond de cour (Aramitz). Elle met en scène avantageusement la façade noble de la maison ».
La maison à cour fermée est composée d'un mur qui sert à obstruer la cour elle-même, du bâtiment d'habitation, de la grange-étable et « une remise ou porcherie ». Elle se localise dans la région d'Herrère-Eysus-Escou, et on la retrouve du pays de Josbaig (Orin), jusqu'à Féas et Ance en vallée de Barétous ». Mais se rencontre peu ou rarement en montagne.
Dans les vallées d'Aspe et d'Ossau, on trouve une autre forme de plan, celle de « maison bloc ». Ce type d'habitat est rectangulaire, trois étages se superposent. Le rez-de-chaussée abrite le bétail, les humains au premier étage, sous le toit on stocke les productions . Lorsque la maison est située dans une localité, sa façade sous pignon, principale, donne sur la rue et correspond à une face étroite.
L'avantage de la maison bloc, lorsqu'elle est bâtie sur un flanc d'un relief, est de permettre au paysan d'accéder rapidement à l'étage ou au grenier.
Ce type de bâtiment est absent dans la vallée de Barétous et peu présent dans ce que l'on nomme le bas-pays.
Un autre type de maison se démarque, celui de la maison à grange accolée ou « en longueur ». On la rencontre dans les petites localités des vallées de Barétous, d'Aspe, d'Ossau, de Josbaig, dans le Piémont oloronnais.
Le bâtiment s'aligne sur la rue sur une longueur de plus de 20 m. Dans le même article cité plus haut, on précise les caractéristiques suivantes. « Le logis s'identifie généralement par trois travées de baies axées sur une porte d'entrée centrale. Cette organisation révèle un plan intérieur en deux grandes pièces organisées de part et d'autre d'un couloir, au rez-de-chaussée comme à l'étage. La partie grange-étable, quant à elle, se devine grâce à l'emplacement de la porte cochère et de petites ouvertures sans menuiseries servant uniquement de puits de jour et de nuit .»9 Son intérêt demeure dans le fait de pouvoir s'adapter à « l'évolution de la famille » et aux « configurations complexes des rues complexes des villages ».
Pour terminer cette énumération de types de maison, on citera, comme le fait l'article cité plus haut,« la maison de ville ». Pas de caractère agricole, la maison présente une façade sur l’alignement de la rue et l'arrière borde un jardin. L'article la qualifie de « bourgeoise » vu qu'elle s'orne d'un décor de pierre sculptée, de lucarnes de toit à fronton... Le toit présente une forme à quatre pans. Les deux pans sont le fait des maisons de ville plus modestes.
Si nous sommes en ville ou dans un village, le bâti est orienté à l'alignement de la rue. De même, la maison, les bâtiments agricoles, le portail et le muret (pouvant avoisiner les 2 m de hauteur) servent à délimiter la rue.
Attenant aux bâtiments, le jardin potager, le tout constituant une surface avoisinant la moitié d'un arpent, ceci dans les zones de plaine. Il se situe généralement à l'abri des regards. Il accorde aux propriétaires l'assurance d'un régulateur thermique du fait de l'ombrage qu'il fournit et contribue à l’infiltration de l'eau. On vit à côté des animaux. En montagne, l'enclos est de plus de petite dimension. La maison est appelée "case», on vit à l'étage (cuisine et chambres) au-dessus des bêtes et de la charreterie.
Si l’on a affaire à une métairie, la maison du propriétaire est attenante et apparaît beaucoup plus opulente.
On s'imprègne lorsqu'on le peut du style classique, c'est-à-dire que l'on cherche à donner au bâtiment la symétrie chère au classicisme ou des éléments caractéristiques comme le toit à la Mansart que l'on trouve dans l'ouest béarnais. Les lucarnes sont à la fois source d'éclairage et de ventilation. Elles permettent également de rompre la monotonie de ces immenses toits.
Quant au vitrage, il n’est utilisé dans les maisons rurales vraiment qu’à partir de la fin du XVIIIème siècle. Au Moyen Age, en France, certains utilisent des toiles de lin, du papier huilé. Dans les villes, on commence à recourir à des verres, mais l’usage des volets intérieurs persistent avec ses inconvénients, le froid et l’obscurité dans les pièces.
Le verre est peu fréquent et coûteux vu qu’on le fabrique par le procédé du soufflage comme cela se fait avec les bouteilles. Ces petits morceaux de verre (en « cul-de-bouteille) sont nommés sibles, et on les assemble à l’aide de plomb.
Les vitres réalisées sont donc encore petites. Afin de les protéger des risques de chocs notamment dans ce que l’on nomme l’imposte (la partie qui surmonte le haut d’une fenêtre), la majeure partie des habitants recouraient à des cadres de bois permettant de fixer des volets indépendants fermés (châssis à volets de bois) par des verrous ou des targettes que l’on coulisse. Pour lutter contre le froid, le procédé de division quadripartite de la baie était un palliatif. On installait aux quatre ouvertures (guichets) de différentes dimensions (deux grandes en bas et deux petites en haut) des volets, ce que l’on nomme la croisée. Des montants de pierre divisaient lesdites ouvertures. Ce type de fenêtre disparaîtra au XVIIIème après avoir résolu la question de la portée du linteau - se fragilisant en abandonnant son appui. En même temps, les techniques verrières s’améliorent, on réalise des carreaux et des châssis plus imposants que l’on pose dans des grandes demeures lors du XVIIIème siècle. En même temps, les croisillons sont disposés de plus en haut jusqu’à disparaître, de ce fait il ne reste plus que deux battants éclipsant le meneau. Les volets sont fermés soit par une « barre de bois verticale pivotant sur un axe central et bloquée par des pattes en haut et en bas de la croisée » soit par des verrous à poignée tournante.10 Youri Carbonnier décrit également l’usage de la fermeture à l’espagnolette (tige de fer munie d’une poignée et de crochets qui s’encastrent dans des gaches) lors de la guerre de succession d’Espagne.
On tente de montrer aux autres sa position sociale à travers des éléments de la maison comme les portes ou portails que l'on enjolive.
Les planches et les contre-planches constituent les portes à partir des XVIIème-XVIIIème siècles. Elles sont assemblées à l’aide de « clous retournés à tête apparente, une double épaisseur de planches d’inégale largeur, posées horizontalement côté rue et verticalement côté intérieur. Une poignée de ferronnerie complète la porte. Si cette dernière est composée de deux vantaux, un couvre joint la protège de la pluie et de l’air. Le portail (appelé charretière lorsqu’il permet le passage d’un véhicule ou cochère s’il est utilisé par des carrosses) quant à lui, il est bien entendu plus large, de 1.80 à 2 mètres et il est aussi composé de planches et de contre-planches, de même qu’il peut être équipé d’une porte piétonne. Au niveau de la décoration, le portail est doté des « mêmes éléments de décor sculpté et de ferronnerie que la porte ». 11
Mais, il faut noter que tous ces changements se déroulent lentement. A la fin du XVIIIème siècle, on peut encore observer que les toits des maisons sont encore couverts de bardeaux et de chaumes aux alentours de Nay. Le chaume a des avantages et des inconvénients comme nous l’avons analysé dans un précédent article. L’inconvénient majeur réside bien entendu dans le risque d’incendie qu’il provoque, mais il offre aussi bien des avantages. D’abord, on pouvait s’en procurer aisément, il suffisait de découper des longueurs adéquates sur les pailles de céréales comme le blé, puis, il durait relativement longtemps, une cinquantaine d’années, ensuite, il cachait les imperfections de la charpente si cette dernière s’affaissait, et, enfin, cela revêtait un bien important, isolait correctement la maison en toute saison.
Le simple journalier demeure dans une maison dotée d'une seule pièce que l'on appelle "maysou".
Sont-elles confortables ? Peu à peu, avec la généralisation de la pierre et du carrelage qui remplacent peu à peu le sol battu, humide, de la spécialisation des pièces, un peu de confort apparaît surtout chez les riches propriétaires.
Quant à la maison de type dit bourgeois , elle est qualifiée ainsi car « elle se compose de manière indépendante des maisons riveraines, grâce à une toiture à deux pans avec croupes. La maison se perçoit comme une unité, non liée au bâti attenant. La façade principale est la façade noble du bâti… sa composition est particulièrement soignée et son ordonnance, d’inspiration classique, est dominée par la symétrie. Elle est organisée par travées verticales d’ouvertures généralement axées sur la porte d’entrée. La façade est enduite et les encadrements de ses baies en pierre de taille sont laissés apparents pour souligner l’excellence de la composition. » 12
Exemple de plan type d'une ferme béarnaise (sur les hauts coteaux):
Références :
- 1-Charte architecturale et paysagère, Pays d’Art et d’Histoire Pyrénées béarnaises, Aspe-Barétous-Josbaig-Ossau-Piémont Oloronais, tome 1 : Lire le paysage, comprendre les implantations, décrypter l’architecture, article : s’implanter sur la parcelle, Les maisons de village en alignement sur la rue, p. 64.
- 2- Idem., article : s’implanter sur la parcelle, les bâtiments formant une cour, p. 60 .
- 3- Jean Loubergé, La maison rurale en BEARN, Les cahiers de construction traditionnelle, Contribution à un inventaire régional, Editions Créer, révision en 2014 par EDICENTRE, p 33.
- 4- Villages et maisons rurales dans la vallée moyenne du gave de Pau, Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, T. 29, fascicule 1, 1958, p. 39.
- 5- Cauep, L'habitat traditionnel en Batbielle et Ousse, p. 3.
- 6- Cauep , Focus les maisons traditionnelles en Pyrénées béarnaises, 8.
- 7- Cauep , L'habitat traditionnel en Batbielle et Ousse,CAUEP, 4.
- 8- , p. 10.
- 9- , p. 13
- 10- Article de Youri Carbonnier : Portes et fenêtres p. 428, L’ancienne France au quotidien, sous la dir. de Michel Figeac, Armand Colin, 2007.
- 11- Charte architecturale et paysagère, Pays d’Art et d’Histoire Pyrénées béarnaises , cit., article : Former et équiper les baies, La porte et le portail, tome 1, p. 104.
- 12- , article : Composer la façade, La maison de type bourgeois, p. 84)
-
Par Michel64a le 30 Juillet 2024 à 20:07
Les exploitations agricoles sont analysées selon la description régionale donnée par Jean Loubergé dans son ouvrage « La maison rurale ».
1) La vallée d'Ossau
Carte extraite de la carte Cassini, source:
https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/france-en-cartes/la-carte-de-cassini?mode=desktop
- Généralités
Parmi les trois vallées pyrénéennes béarnaises, elle est la plus importante tant sur le plan démographique que sur le plan politique. Sur ce dernier point, il faut se rappeler qu'elle était régie par un For et un Conseil de vallée ou « Universitat ». Sur le plan économique, l'élevage a été la principale richesse de ces pasteurs qui utilisaient les estives, en été, pour y faire paître leurs bétails et, en hiver, la transhumance.
Les villages d’une même vallée, par leur unité géographique, historique, politique, juridique et économique, recèlent des similitudes dans l’architecture.
Géographiquement, la vallée glaciaire d’Ossau se distingue principalement par deux zones, l’une plus élargie, plane et moins élevée, bordée de collines (villages englobés : Arudy, Bielle, Sévignac…), le Bas-Ossau, et l’autre, accidentée, étroite et plus élevée, le Haut-Ossau. Le verrou de Castet marque la limite entre les deux. La vallée s’étire avec une orientation sud-nord.
La neige est plus contraignante dans la seconde partie. En ce qui concerne le climat, trois facteurs le déterminent. L’influence océanique (vent, pluie, douceur), du fait de sa position australe avec l’Espagne - bénéficiant de l’anticyclone - elle profite parfois de son débordement en rejetant la pluie, et enfin le phénomène du foehn, vent chaud et sec.
Le Haut-Ossau est essentiellement drainé par deux cours d’eau, le gave d’Ossau et son affluent, le Valentin qui prend sa source aux Eaux-Bonnes. Il est nécessaire de tenir compte de ces paramètres pour les constructions des maisons puisque dans la première partie la densité humaine était plus importante que dans la seconde. En effet, dans la zone la plus élevée, peu d’habitants vivaient de manière permanente, si ce n’est à Goust et à Gabas, deux hameaux. Quant à la zone la plus basse, elle comportait dix-huit villages concentrant la majorité de la population de la vallée d’Ossau.
- Les villages
Ils sont disposés en habitat groupé favorisant une vie communautaire. Certains possèdent de vastes places centrales, mais elles ne constituent pas la norme. Véritables carrefours, des éléments balisent l’espace public tels qu’un arbre planté, un lavoir, une fontaine ou un calvaire. Des bancs peuvent être ajoutés afin d’accroitre la convivialité.
Ils se sont construits autour de l’église, d’une rue principale (« carrère ) et de ruelles (« carrérots »). Leur implantation dépend des critères comme ceux de la présence d’eau et de terres agricoles vacantes. La majorité des maisons sont attachées à l’espace rural.
Dans l’article intitulé « Charte architecturale et paysagère », on lit que selon les époques, « les fermes se localisent différemment dans le territoire. A la période la plus ancienne (XVIème siècle) elles s’installent dans le haut des pentes en suivant le rythme des talwegs. La crête et la mi-pente sont occupées plus tard (XVIIe, XVIIIe siècle) selon les chemins transversaux. Les routes de fond de vallée génèrent de nouvelles installations lorsque la pression agricole est plus forte (XVIIIe siècle. » [1]
Plusieurs villages se sont implantés au fond de la vallée, bénéficiant ainsi des facilités de communication, des terres de culture, mais subissent l’ombre donnée par les montagnes lorsque ces dernières cachent les rayons de soleil, surtout en hiver. Autre inconvénient, l’air froid s’accumule dans les fonds de vallée puisqu’il est plus lourd que l’air chaud.
Ils s’étirent en pente et le long d’une rue unique. La majorité des localités sont divisées en quartiers distants souvent d’un ou de deux kilomètres, à quoi il faut ajouter les quartiers de granges. Par exemple, Bilhères est composé de trois quartiers : Arrius, Lies et Ourdos. Les rues sont généralement étroites, pas toujours droites. Les maisons sont soit distantes les unes des autres par des minces venelles soit collées. Les entrées des villages sont marquées par des croix, ce qui délimite la commune (tradition qui remonte au XIème siècle).
Le gave d’Ossau sert d’axe médian aux deux routes qui lui sont parallèles. Par elles, on accède aux villages puis aux granges.
En quelques mots, les paysages naturels sont composés de zones rocheuses (étages nival et alpin) qui s’échelonnent globalement au-delà des 2 300 m d’altitude. Puis, viennent les zones de pâturages, domaines des bergers et de leurs abris, comprises entre 1 700 m et 2 300 m d’altitude (étage subalpin). Ensuite, viennent les forêts de conifères (sapins) et de feuillus (hêtres) selon l’altitude comprise entre 800 m et 1 700 m (étage montagnard) et leur exposition au soleil (soulane ou sud et ombrée ou nord). Enfin, en bas (moins de 800 m), les terres de culture, des chênes et les habitations (étage collinéen).
Si les villages se sont établis sur les versants, les constructeurs des maisons ont dû s’adapter aux contraintes du relief et, par conséquent, à la pente. Les niveaux (les étages) des maisons s’accordent à cette dernière. Cette-Eygun offre un bon exemple de village implanté dans la pente avec ses terrasses.
La mitoyenneté des demeures n’est pas rare.
- La maison rurale
Jean Loubergé[2] décrit la maison ossaloise de la manière suivante : un rez-de-chaussée comprenant « une grande porte cochère à vantaux fermés » et un étage ne présentant côté rue que « quelques rares fenêtres ». Intimement liée à l’économie pastorale, elle est constituée d’un « seul volume, ordonnée en hauteur ; le bétail (mais aussi le matériel agricole) est au rez-de-chaussée tandis que le logement des hommes est à l’étage, surmonté d’un grenier dans lequel étaient conservés les grains, et éventuellement, le foin. » Le sol du rez-de-chaussée est en terre battue. Il est divisé en emplacements spécifiques pour tous types d’animaux (brebis, vaches, ânes…) et parfois une pièce attribuée au saloir à fromages, orientée à l’Ouest ou au Nord pour la fraicheur. Les fromages sont entreposés sur des étagères de bois de sapin. Des soupiraux dispensent peu d’aération.
Lesdits animaux sont abrités par des petites constructions, comme des porcheries (porcaus), des poulaillers (pouralhères) clôturés par des treillis de bois. Des râteliers à barreaux de buis sont disposés.
Un plancher de bois sur solives séparait les animaux et les hommes vivant à l’étage, procurant à la fois la chaleur en hiver et la possibilité de surveiller, mais dégageant des fortes odeurs. Il advient parfois que les animaux sont abrités dans une grange peu éloignée, tandis que l’étable sert alors de remise.
Une « seule porte d’entrée pour toute la maison, une porte cochère à deux vantaux de bois de chêne qui sont directement fixés aux murs par des gonds majestueux. »
Avant la fin du XVIIIème siècle, il n’existait qu’une seule porte cochère servant aux hommes, aux animaux et au matériel agricole. La largeur des portails avoisine les 1,80 m à 2 m généralement. Par la suite, on distingue les hommes des animaux.
Certaines d’entre elles se démarquent par leur esthétique, leur passé (datant du XVIème siècle). Réalisées avec des « grosses pierres de taille, elles présentent un linteau en anse de panier ou avec accolade ; et de gros clous forgés renforcent les vantaux de bois. L’un de ceux-ci peut s’ouvrir à mi-hauteur… » permettant ainsi d’aérer et d’éclairer l’intérieur.
Les clés d’arc (ou claveaux centraux ou de voûte ; pèirus clau) offrent aux yeux des variétés de motifs gravés. Elle clavette le linteau qui est généralement constitué de cinq blocs de pierre. Architecturalement, elle participe à l’inclinaison des charges du bâtiment et donc du mur vers les piédroits.
Certaines clés de voûte évoquent la fécondité par des symboles comme les fleurs avec ou sans vases, les arbres (symbole de vie) …, la prospérité, la protection. D’autres motifs sont plutôt religieux, tels les monogrammes IHS (abréviation de « Jesus Hominum Salvator » ou « Jésus Sauveur des Hommes ») ou AM (Ave Maria). A Sainte-Colome, par exemple, on peut observer sur la porte de l’ancien presbytère un linteau sur lequel est inscrit en béarnais : « de bonne hore et betleu – berges pla quant importe de – sabe per quau porte cau entra – dens lou ceu STMF 1709 » (soit : de bonne heure et bientôt – vois bien combien il importe - de savoir par quelle porte - il faut entrer dans le ciel S.T.M.F. 1709). D’autres encore ne présentent pas de motifs, mais des dates de construction ou de rénovation.
Il est nécessaire de rappeler qu’en Béarn, le nom de la maison (oustau) est plus important que le nom de famille et, par conséquent, le fait d’adjoindre un cartouche correspond à une signature du propriétaire.
A Béost, au numéro 2 de la rue Carré du Hourc, un cartouche mentionne la date 1784. A l’époque la maison appartenait au maître-maçon Sassoubs. Politiquement, il ressort qu’il est royaliste puisque des fleurs de lys apparaissent (ce motif peut aussi évoquer la conjuration du « mauvais œil »), de plus, il exhibe également son métier car il a fait marteler des outils.
Les portes sont dotées de heurtoirs dont certains sont ornés. Les seuils (parquilles ou calade, usoirs ou espace du domaine public entre une maison et la rue) sont élaborés avec des matériaux tels des galets, des dalles de pierre. « Sécurisant le devant de porte, en l’inscrivant en retrait de la rue, ils supportaient des usages domestiques ou de petit artisanat, et s’agrémentent pour cette raison d’un banc (généralement en pierre).[3]
Si le rez-de-chaussée comporte peu de fenêtres, c’est au premier étage que l’on les trouve. Les plus anciennes baies remontent au Moyen Age, notamment la fin. Elles présentent un arc brisé. Au XVIème, la forme de l’arc se modifie et se transforme en plein cintre. Puis, l’arc en anse de panier domine, parfois décoré par une accolade. Enfin, à la fin du XVIIIème siècle, se superpose l’arc dit segmentaire, c’est-à-dire un arc semi-circulaire. Le raccordement de l’arc et des piédroits est brisé.
Certaines fenêtres sont à meneaux. Dans la majorité des cas, elles datent du XVIIème siècle. Ce qui est le cas dans le vieux Bielle où elles ont été récupérées sur le prieuré Sainte-Anne fondé au XIème siècle qui a été incendié en 1569 au moment des guerres de religion par les Huguenots de Montgoméry et détruit lors de la Révolution.
Un escalier de bois est accolé au mur et proche du portail afin d’accéder à l’étage.
Le même auteur mentionne qu’à l’origine une seule pièce composée l’étage, munie d’un évier de pierre taillé dans un seul bloc permettant l’évacuation des eaux usées sur les venelles ou la chaussée souvent empierrée. La pente des rues concoure à l’écoulement des eaux. On y trouve également un four (hournère) en saillie et une cheminée. Le four peut s’ouvrir sur la cheminée, à l’extérieur il présente une forme arrondie, avec un toit plat ou conique, surmonté d’ardoises.
Four à pain à Bielle, rue d’Aspeigt.
Des cloisons mobiles sont utilisées au début avant d’être remplacées par des cloisons fixes de bois ou des murs de briques. La lumière pénètre par quelques petites fenêtres (aux ouvrants de bois). « Des œil-de-bœuf apportent un complément de lumière à la cuisine favorisant aussi le tirage de la cheminée. » 2 La fumée de la cheminée est évacuée fréquemment par une petite ouverture carrée. A l’arrière, on note parfois un balcon en bois ou de pierre, surtout s’il était exposé au sud. Il pourvoyait au séchage les produits agricoles. Le grenier, où on stocke le foin, était accessible par un escalier de bois raide ou une échelle. Jean-Pierre Dugenne3 précise que l’escalier de bois possède « une rampe, pourvue d’une main courante dont l’extrémité est sculptée. Il s’agit le plus souvent d’une tête de serpent. Le poteau de départ est, lui aussi, ouvragé. » Ce qui n’était pas le cas des maisons les plus modestes, certainement. Le volume du grenier est plus restreint que celui que l’on rencontre dans le bas pays vu que les récoltes sont moins importantes, peu de lucarnes.
Si la maison est bâtie en flanc de pente, on accède au grenier par l’extérieur, ce qui facilite, comme on l’a écrit précédemment, le stockage des grains ou du foin. Si ce n’est pas le cas, on emmagasine à l’aide de poulie. En raison du faible nombre de récoltes, l’auteur précise que sa hauteur était moins importante que dans le bas pays. L’aération est produite par quelques lucarnes ou de petites ouvertures de ventilation qu’on nomme outeaux. Le foin a l’avantage de servir d’isolant pour les pièces d’habitation du premier étage (n’oublions pas la chaleur dégagée par les animaux parqués au rez-de-chaussée).
Si, par cas, il n’y a point de grenier, on emmagasine les « ustensiles de grenier et de ménage, ainsi que les provisions alimentaires conservées là pour les repas importants (produits de porc en particulier)[4].
Rarement, des maisons sont dotées de latrines.
Les murs sont bâtis le plus souvent en pierres cassées (notamment ramassées dans les champs) et taillées contre les galets du gave, la toiture à double pente couverte d’ardoises et de coyaux, les lucarnes pour la ventilation citées plus haut. « Le toit, à deux versants, est porté par une charpente à chevrons formant ferme, assemblés à mi-bois sans faîtière, en contreventés par deux pièces de bois placées obliquement sous les chevrons. »[5] Le bois des charpentes provient de la forêt environnante ; coupe tolérée par l’administration de la Maîtrise des Eaux et des Forêts.
L’ardoise domine, comme le rappelle l’abbé Bonnecaze[6] lorsqu’il écrit : « Les maisons sont couvertes d’ardoise qui est assez commune dans les montagnes ».
Les ardoises sont acquises auprès d’entreprises locales situées sur les ardoisières, notamment à Geteu et Louvie Soubiron.
Globalement, l’espace dans ces habitations est des plus restreints, ce qui pose la question de la cohabitation pour les membres de la famille qui y vivent, qui peuvent avoisiner la quinzaine dans le modèle appelé « famille souche ». Ce qui explique la bonne coexistence, surtout dans la cuisine alors la principale salle commune, c’est l’autorité souveraine du chef de la famille, les rôles attribués aux différents membres de la famille et le temps relativement réduit de la présence entière de ladite famille lors de la prise des repas en commun et durant les veillées.
La femme, comme le rappelle Jean Dugenne, « file la laine, tisse le lin ou autres fibres végétales ou animales. Le métier à tisser occupe une place de choix, près des ouvertures. » [7]
En dehors de la maison, à l’arrière, une petite cour et un petit jardin la jouxtaient, atteignable du rez-de-chaussée par un portillon.
Souvent, un banc de pierre est accolé à la façade, servant alors de lien entre l’espace privé et l’espace public que constitue la rue, comme on en trouve à Bielle.
Maisons bloc à pignon à Arudy, rue du pont Germe.
ARUDY : maison avec banc de pierre, rue Mayos
- La périphérie des villages
En périphérie des villages, on observe parfois des maisons-cours en équerre, avec toutefois des cours de dimensions moins imposantes.
La maison à cour fermée s’observe plutôt dans le piémont et dans le fond de vallée, rarement en montagne. Ces maisons de fond de vallée sont généralement conçues plus grandes pour remédier aux besoins des cultures plus importantes. Ce type de maison présente alors une cour encadrée par des bâtiments agricoles et le lieu d’habitation qui sont davantage écartés. Elle s’ouvre sur la rue par un portail surmonté parfois, comme on l’a vu plus haut, par un monogramme rappelant la famille. On emploie pour l’édification des murs le galet, abondant dans le gave, et la décoration en « feuille fougère » égaye la vue. Jean Cazaurang [8] écrit : « Chemins et routes sont assez larges pour qu’y soient transportées des pièces de pierre taillée lourdes ; il n’est plus nécessaire d’avoir recours à des éléments multiples disposés en arc pour l’encadrement des portes ; les linteaux monolithes allongés et rectilignes deviennent de plus en plus nombreux dans le sens de l’aval des gaves. »
- Les quartiers des granges
Dans ces villages de montagne, on remarque ce que l’on nomme les quartiers des granges. Ces granges foraines ou bordes parsèment la moyenne montagne et servent de « relais » entre la haute montagne et le fond de vallée. Elles étaient occupées à la belle saison pour le fauchage. Elles sont le reflet de la richesse de leurs propriétaires lorsqu’ils en possèdent plusieurs. Les granges-étables sont non seulement le refuge des pasteurs, mais aussi celui du foin. Ce foin issu de prairies bocagères, après être fauché, est transporté à l’aide de tissus (Ihèiteras ou mantas) ou de châssis de bois (arqueta ou saumeta) que l’on déplace en tirant ou en le chargeant sur ses épaules. Ils y vivent avec un troupeau qui ne transhume point, c’est-à-dire composé de vaches de trait, de juments mulassières. « Les granges sont en quelque sorte des dépendances des fermes-mères, ce qui évite d’avoir d’immenses greniers ou étables… Cette dispersion des bâtiments favorisait, à l’époque où la pénurie de main d’œuvre n’existait pas, une certaine spécialisation. Telle grange était consacrée aux brebis, telle autre aux juments… »[9] Le plateau du Bénou offre un bel exemple.
Elles sont bâties souvent à flanc de pente dans le but d’accéder facilement au grenier (boquèr) à l’aide simplement d’une échelle (souci aussi de se protéger du vent, de soutènement), ou alors, on entre par une rampe.
Elles sont proches d’un point d’eau et à l’abri de risques naturels comme les avalanches, mais également des bois pour les protéger des vents. Elles sont implantées de façon à se protéger de l’Ouest et bénéficier des avantages offerts par la nature comme les reliefs, notamment les rochers pour la protection. Autre point, elles se localisent en bordure des parcelles, limitant ainsi l’espace agricole, « dans le respect des courbes de niveau, le long des voies et des chemins existants. » [10]
Les murs sont élevés en opus incertum soit en petit appareil réalisé en pierre cassée de forme et de dimension irrégulières. Le matériau est prélevé au plus près : calcaire, schiste, flysch… Puis, on trie selon la forme, la qualité : linteau, pierre d’angle… Peu de fenêtres, généralement petites, éclairent l’intérieur. Les ouvertures sont orientées le plus possible en direction des prairies, au Sud et à l’Est et non pas vers l’Ouest. Le bardeau puis l’ardoise ou la lauze irrégulière les coiffe. Pour supporter le poids de la neige et les rafales (surtout provenant du sud), on renforce la charpente en ajoutant une panne en diagonale, nommée la « ligue »[11]. Les pannes sont des poutres horizontales que l’on pose sur des fermes et qui supportent des chevrons. Le faîtage est conçu dans le sens de la pente. La surface du grenier (fenil) est relativement importante afin de stocker le plus possible de fourrage. Le plancher séparant le grenier du rez-de-chaussée est conçu souvent simplement en « branches de Châtaignier (réfractaire aux insectes) posées les unes contre les autres. » [12] Si la quantité de foin entreposé dépasse le volume du grenier, on l’entasse en meules à l’extérieur de la grange, accumulé autour d’une perche (barguera), souvent de frêne car « souple, donc facile à travailler, qui durcit ensuite au séchage. »
Par exemple, à Aste, le quartier d’estives ou des granges (ou cabanots) localisé au Port d’Aste est relié par un sentier muletier entretenu collectivement. Ces granges étaient disposées en arc de cercle suivant le rebord de la moraine sur plus de 500 m, à 1 030 m d’altitude. Les habitants confectionnaient des murets de retenue. Réalisés souvent en galets, ces andains (ici, bandes de matériaux disposées au sol) sont constitués de grosses pierres et de plus petites leur servant de blocage, sans liant. Ils pavaient même le sol avec de grosses dalles. Ces cabanots abritaient le bétail qui ne transhumait pas.

Chemin muletier et granges d'Aste disposées en arc de cercle.
Au-dessus de la moyenne montagne, le berger se réfugie dans des cabanes d’estive. Elles aussi, elles peuvent être rassemblées en quartiers (3 à 5 cabanes). Certaines ne se réduisent parfois qu’à un abri naturel constitué de pierres sèches servant alors à se protéger provisoirement des intempéries pour une nuitée. D’autres sont bâties avec des murs de moellons irréguliers sans liant, la fumée s’évacuant simplement par un orifice entre la toiture de pierres plates et le mur. Ces pierres plates sont étendues sur une trame composée de perches de bois. L’encadrement de la porte et de son linteau est fait en bois. Le berger se repose et confectionne le fromage à l’extérieur sur une banquette de pierre.
2) La vallée d’Aspe
Extrait de la carte Cassini, source:
https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/france-en-cartes/la-carte-de-cassini?mode=desktop
- Généralités
Du Nord au Sud, de Gurmençon au col du Somport, la longueur de la vallée avoisine les 40 km. Elle est étroite, si la vallée d’Ossau a une forme de U, celle de la vallée d’Aspe a plutôt la forme de V. Les montagnes qui la bordent culminent aux alentours de 1 500 -2 000 m d’altitudes. Celles qui dominent le fond de la vallée ont des pentes assez raides à l’opposé de celles qui se trouvent plus hauts qui sont plus dégagées. La zone autour de Bedous se trouve quasiment à mi-chemin de la vallée. L’élevage, au XVIIIème siècle, reste dominant. Historiquement, la vallée d’Aspe, reste la grande voie de communication entre l’Espagne et le Béarn, pensons à la borne milliaire romaine trouvée près du col du Somport, l’hospice de Sainte-Christine implantée du côté espagnol accueillant les pèlerins de Saint-Jacques Compostelle… Outre les pèlerins, cet axe voit circuler les commerçants transportant du bétail, de la laine (industrie oloronaise), des métaux (fer…), du bois (chemin de la mâture, quais du port d’Athas).
- Les villages
La quinzaine de villages se trouvant dans la vallée sont du type habitats groupés. De part et d’autre de la zone autour de Bedous où le plan des localités est celui du village-rue, les autres se sont implantés majoritairement sur un replat bien exposé. Ou alors, les hommes ont opté pour l’altitude quand le choix d’une bonne orientation s’offrait comme à Lescun face au cirque qui porte son nom.
Les maisons ont des similitudes avec celles que nous avons décrites au sujet de la vallée d’Ossau.
Comme l’écrit Jean Loubergé[13], « la plupart des vieilles maisons sont des maisons à un seul volume, avec un rez-de-chaussée réservé au bétail et un étage où se logent les humains ; on retrouve les grandes portes cochères, avec linteau en anse de panier ou en ogive, avec les beaux vantaux de chêne renforcé de clous. »
En effet, le plus souvent, les maisons sont étroites, les façades verticales et, par conséquent, peu d’ouverture à l’étage, généralement une seule. Le rez-de-chaussée servait donc d’abri aux animaux (bovin, porcin par exemple) et d’entrepôt au matériel agricole. Au premier étage, le volume est consacré au logement avec pour commodité un four en saillie comme on l’a vu à la vallée d’Ossau, tandis qu’au grenier, on entrepose des céréales ou du foin.
Des maisons ne répondent pas à ce schéma, elles sont plus larges.
Les maisons se jouxtent dans la partie centrale du village, alors qu’en périphérie on observe plutôt des maisons-cours comportant des « granges-étables séparées du logis ».
Dans l’ouvrage intitulé « Pays aquitains » déjà mentionné, il est écrit que « les maisons à cour fermée, absentes de communes telles que Lescun, sont très nombreuses dans la basse vallée en aval d’Accous. Cette cour se transforme alors facilement en cloaque dans lequel s’écoulent les déjections du bétail, mêlées à des tiges de maïs et à de la fougère pour former de l’engrais. »5
Une recherche d’ornementation est visible sur les façades des maisons afin de démontrer une certaine aisance. Un souci de décoration est perceptible sur les fenêtres « à double entablement de pierre ; au-dessus et au-dessous de l’ouverture ; également des fenêtres à meneaux et des portes comportant une date ou des représentations symboliques. » Les plus anciennes anses sont en arc brisé ; aux XVIème et XVIIème siècle un autre type d’arc le supplante, l’arc en plein cintre. Enfin, à la fin du XVIIIème, viendra l’arc segmentaire. Ici, pas trop de différences notoires par rapport aux maisons ossaloises.
Outre son utilisation pour la confection de la couverture, le bois est le matériau employé dans les galeries que l’on retrouve sur les façades du premier étage. Le plus souvent orientée au Sud (pour le séchage des productions), elles s’appuient sur des jambes de force ou parfois sur des poteaux. La profondeur oscille entre 1,50 m à 2 m. On trouve à Urdos une exception, une galerie qui enjambe une rue-calade, reliant deux maisons.
Le souci de décorer le sol se retrouve dans les deux vallées. Les calades (ou revêtement réalisé en moellons ou en galets) ornent soit les rues ou chemins (carrerot) soit les cours dans les maisons à cour, ou encore simplement le devant-de-porte, le bord d’une fontaine ou d’un abreuvoir. On rappelle qu’elles n’offrent pas seulement à l’observateur un joli aspect, mais qu’elles servent à protéger de la boue.
Les distinctions à remarquer se cherchent sur les détails. Jean Loubergé signale que « les maisons à façade sur pignon sont mieux représentées en vallée d’Aspe qu’en vallée d’Ossau. » Autre différence, l’étroite porte réservée aux humains donnant accès « à une cage d’escalier séparée de l’étable-bergerie. » La dissociation homme-animal est plus accentuée.
Pour leur construction, le même auteur rappelle qu’au Moyen Age, on utilisait pour la confection des murs, des moellons grossiers extraits sur les montagnes environnantes, et de la pierre taillée pour les encadrements des portes et des fenêtres, les chaînes d’angles, les éviers et les cheminées.
Pour ce qui est du toit, au XVIème siècle, on pose des lauzes ou des ardoises « épaisses et grossières tirées d’ardoisières locales (…Osse et Aydius en vallée d’Aspe). »[14] Le même auteur avoue qu’il ne peut guère affirmer que le bois (abondamment présent dans les forêts environnantes) a pu être utilisé pour les murs et les couvertures. Il conjecture, car il avance que les « bergeries sommaires, isolées des villages, sont toujours des constructions de pierre. »
Exemples :
Pierre Dejean[15], en étudiant le plateau de Lhers, dresse une description de l’habitat. Nous sommes dans un habitat dispersé, ce qui procure aux exploitants l’avantage d’être au plus près de leurs terres. La ferme est composée d’une habitation, d’une grange plus grande. Les deux sont construites avec des galets roulés. Les deux bâtiments sont généralement parallèles, l’un « étant quelque peu en retrait de l’autre ; entre les deux se trouve une cour, avec un abreuvoir qu’alimente l’eau dérivée d’une rigole voisine. » A des fins d’autosuffisance concernant les légumes, on se dote près de la ferme, d’un « petit jardin potager, enclos de murettes… ».
La maison présente une hauteur basse, une « forme allongée, aux murs épais, percés d’ouvertures rares et étroites…, pas d’étage. » En ce qui concerne les pièces d’habitation, la cuisine reste l’élément prédominant de la maisonnée avec sa cheminée, le four à pain et l’évier de pierre comme cela a été écrit plus haut. Il est précisé que toutes les maisons du village possèdent un saloir derrière la cuisine, « une pièce obscure dont les moindres ouvertures ont été tapissées par un fin grillage et où les fromages de brebis s’alignent sur des étagères. »
ACCOUS : four à pain, rue d'Alouet
ACCOUS : four à pain, rue d'Alouet
Quant à la grange, elle « sert à la fois d’étable et de fenil : le rez-de-chaussée abrite les bestiaux ; au-dessus, le grenier à foin s’ouvre par une large fenêtre à deux volets qui est orientée d’ordinaire du côté le plus ensoleillé. »
La localisation des bâtiments d’habitation et d’exploitation n’est pas choisie au hasard. On prime « les replats ou sur les bosses de terrain, dans les endroits dégagés et ensoleillés ». Globalement, ils « s’allongent parallèlement ou obliquement à la direction du bassin… », mais aussi orientés vers « le soleil et la lumière. » Cette source de chaleur sera profitable pour aérer et sécher le foin à travers les ouvertures des granges.
Toujours concernant les granges, l’étude s’élargit sur celles qui sont implantées sur les prairies, dans lesquelles on engrange le foin récolté. Elles sont utiles, lorsqu’en hiver le paysan constate que le foin stocké dans la grange de la ferme est épuisé il y mène le bétail. En été, elles servent de « relais » lors des travaux agricoles qui durent toute la journée.
3) La Vallée de Barétous
Extrait de la carte Cassini, source:
https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/france-en-cartes/la-carte-de-cassini?mode=desktop
- Généralités
Elle se situe à l’Ouest des deux précédentes vallées. Elle se découpe géologiquement en deux parties, la basse vallée composée de roches tendres du flysch et la haute vallée constituée de roches calcaires. Si les altitudes de la première avoisinent en moyenne les 400 m, la seconde culmine à 1 660 m à La Pierre-Saint-Martin. Comme ses voisines, les vallées d’Aspe et d’Ossau, l’économie qui prédominait au XVIIIème est essentiellement agricole, et surtout pastorale, avec ses élevages de bovins, d’équidés et d’ovins.
Six villages composent la plus petite des trois vallées, mais l’habitat est plutôt dispersé à l’inverse de ses voisines. Toutefois, le centre des localités est dense.
- Les matériaux
Au niveau des matériaux de construction des maisons, les murs sont faits soit en galets roulés en fond de vallée (ruisseaux Le Vert, Le Vert d’Arette et Le Vert de Barlanès) soit en pierres cassées sur les hauteurs. On peut observer parfois les deux ensembles.
Pour lier ces matériaux, on utilise de la chaux, du sable (notamment du sable gris de rivière). L’usage des matériaux durs se généralise surtout aux XVIIème et XVIIIème siècles.
La charpente est conçue bien entendu avec du bois provenant des forêts de la montagne, particulièrement du chêne pour sa résistance.
La couverture se réalise historiquement avec du chaume et du bardeau, puis au XVIème siècle, plus exactement à la suite des guerres de religion, avec des ardoises provenant globalement de la vallée voisine, la vallée d’Aspe.
- Les types de plan
Le plan, d’après Jean Loubergé[16], est quelque peu différent de celui des deux autres vallées, puisqu’il n’y a pas de « maison bloc en hauteur », ce qui corrobore l’idée selon lui que la vallée de Barétous est « moins montagnarde que ses voisines de l’Est ». Par contre, il y a « fermes à un seul volume sous le même toit, mais avec grange-étable juxtaposée au logis sur la même façade » (visible surtout au centre d’Arette et d’Aramits). De même que l’on rencontre des « fermes à cour complètement fermée, peu nombreuses » (à Féas et Ance), des « fermes avec logis et grange-étable disposés en équerre sur une cour en façade ». Des fermes ont une disposition en équerre délimitant une cour à l’arrière, d’autres « se composent de bâtiments non jointifs entourant la cour sur trois côtés ; car l’importance de l’élevage fait qu’il y a souvent, dans une même ferme, deux grands bâtiments réservés au bétail ». 11
Enfin, un autre type de plan, « assez fréquent…, la ferme cour, mais à cour très réduite, car si le logis a une large façade sur la cour la grange n’y a qu’une façade sur mur pignon et quelque fois même une demi-façade seulement, juste la largeur de la porte cochère. » Mais ce schéma a un inconvénient, la forme de la cour est rectangulaire avec des largeurs trop étroites qui ne permettent pas aux charrettes de manœuvrer et de charger le matériel agricole lourd. Sa seule fonction réside dans l’accès à l’habitation et à la grange-étable et sa particularité découle de l’importance de l’économie pastorale. Le même auteur signale que ce plan se retrouve aussi « sur une bande de piémont de part et d’autre d’Oloron » ce qui poserait la question de son origine : Vallée de Barétous ou la zone géographique oloronaise.
Les façades sont ornées par des linteaux, décor « peut-être moins fréquent qu’ailleurs ». Jean Loubergé pointe Issor où on l’on observe « de beaux linteaux de portes ornés de motifs, principalement des rosaces. »[17]
4) La région d’Oloron-Sainte-Marie
Extrait de la carte Cassini, source:
https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/france-en-cartes/la-carte-de-cassini?mode=desktop
- Généralités
Le piémont oloronais comprend la localité et la zone qui englobe les rives des gaves d’Oloron, d’Aspe et d’Ossau.
A l’époque qui nous intéresse, les principales activités agricoles se composent de l’élevage et de la culture céréalière. Auxquelles il faut ajouter l’artisanat textile (notamment lainier) qui employait une main d’œuvre rurale. L’Espagne, particulièrement l’Aragon, était un acteur commercial important. Cette région a été de tout temps occupée par l’homme.
Jean Loubergé [18] distingue différents types d’habitats. Ils sont caractérisés par des « alignements de villages groupés. Les habitants se réunissaient autour de l’église, la maison commune. « Le souci d’économiser les terres agricoles, les nécessités de la défense ont conduit les maisons à se grouper dans une continuité minérale à l’alignement de la rue, sur des parcelles étroites et profondes. »[19] Dans l’ancienne vallée du Gave d’Ossau, il n’y a qu’un alignement… », tandis qu’ils sont deux dans la vallée du gave d’Aspe et du gave d’Oloron, « un de chaque côté de la rivière ». Les villages, dans la vallée du gave d’Oloron, sont plus nombreux et présentent souvent la particularité d’être des villages-rues, par exemple Préchacq-Navarrenx.18
Plus on s’éloigne des montagnes, plus la culture nécessite des bâtiments plus imposants vu que le paysage devient plat. On distingue plus nettement les habitations et les bâtiments agricoles comme la grange, on élève les murs pour des raisons de sécurité et de renom.
- Les matériaux
Les propriétaires visant l'autarcie recherchent avant tout à limiter tout achat de matériaux en provenance des régions éloignées, se souciant au contraire à se fournir dans les carrières locales.
Les matériaux de construction sont les mêmes que ceux que nous avons vus précédemment, c’est-à-dire des galets. Jean Loubergé précise qu’ils sont pris dans du mortier de chaux gris. Proche des collines dont on extrayait du calcaire pour alimenter les fours à chaux, on utilisait des moellons de pierraille.18 La recherche de l’autarcie se reflète dans la quête des matériaux. Ces derniers devaient se trouver le plus près du lieu de la construction.
Dans les reliefs plats, les chemins ou les routes sont plus larges et permettent de transporter des pierres taillées plus importantes.
Peu de chaînage d’angle taillé, mais dans les demeures plus cossues on dispose les galets en feuilles de fougères qui on l’a déjà écrit ne répondait pas seulement à un souci esthétique mais également technique vu que cet agencement autorisait la fixation du mortier de chaux vive sur les façades.
Outre les galets, on utilise les moellons de pierre (pierres de petite dimension grossièrement équarries).
Pour les portes et leur encadrement, on pose des linteaux allongés et non plus plusieurs éléments pour former des arcs, et ceci s’observe dans les zones plus dégagées.
Le corps de logis devait être mis en valeur, d’où « la finition d’un enduit, régulièrement rafraîchi par des badigeons, qui pouvaient être blancs ou teintés. Les dépendances agricoles ne faisaient pas l’objet d’un tel soin et étaient le plus souvent laissées à la pierre apparente. »[20]
En ce qui concerne la toiture, elle varie du Sud au Nord de la région. Celle en amont de Navarrenx se caractérise comme une « zone de transition où toits d’ardoises et toits de tuiles plates coexistent dans le même village, mais elle est peu étendue et on ne trouve guère les deux matériaux sur un même toit ».
Les couvertures en ardoises…ne se sont définitivement imposées qu’au XIXe siècle, au détriment des couvertures végétales de bardeaux ou de chaume… »[21]
Ce sont là encore les murs du logis qui sont enduits et « régulièrement rafraîchi par des badigeons, qui pouvaient être blancs ou teintés. Les autres bâtiments à caractère agricole sont fréquemment laissés à la pierre apparente. » [22]
- Les différents types de plan
L’influence montagnarde persiste, ce qui explique que les cours ne sont pas grandes et qu’elles soient fermées. Le portail peut être inséré dans le mur, il est alors plus petit que lui, ou alors il est pris dans la maison si cette dernière débouche sur la rue.
Quant aux plans des exploitations, ils sont très distincts.
Une maison béarnaise « classique » dépeinte par CAUE 64 22 se dégage par « l'affirmation du corps de logis qui se distingue franchement des bâtiments de l'exploitation agricole. Sa façade se développe sur le mur gouttereau, dans une symétrie composée autour de l'axe dessiné par la porte. Généralement cette façade s'offre aux regards par l'intermédiaire d'une petite cour, ouverte sur la rue ou le chemin. » Ce modèle « issu de l'architecture « savante » qui se répand dans tout le Béarn au cours des XVIIIe et XIXe siècles, témoigne du désir des propriétaires paysans d'inscrire dans l'architecture la pérennité et la qualité de la lignée familiale. »
Mais on peut distinguer d'autres types de plans.
Les uns sont « à plan en équerre et cour demi-ouverte ; les signes extérieurs de richesse n’y sont pas très fréquents » (hormis les piliers des portails coiffés de boule ou d’un petit toit d’ardoises). Aux environs d’Oloron, les galeries « ne sont pas rares dans les maisons rurales ».
D’autres, dans la zone Buzy-Buziet-Ogeu et à Gurs et à Sus, on trouve la « ferme-cour aux bâtiments disposés en équerre ». La partie habitation présente une ample devanture côté cour tandis que la grange comporte « une façade sur mur pignon, ce qui donne une cour étroite et longue, et dénote… la prédominance de l’élevage sur la culture. » 18
Vue de l'extérieur, la maison à cour fermée donne la sensation d'être en présence d'un bloc massif doté seulement de quelques ouvertures (porte charretière et peu de fenêtres); On la rencontre dans les quartiers, mais aussi dans les villages où elle peut même être le modèle prédominant comme à Escou.[23]
Enfin, dernier type, « entre Herrère et Eysus en amont, Navarrenx en aval : ce sont des fermes à cour intérieure complètement fermée par des bâtiments et par conséquent invisible de la rue ». 18 Les murs donnant sur la rue sont hauts et exhibent des portes charretières imposantes (pourtàus) et sont composées de deux vantaux de bois, quelquefois une porte pour piétons. L’influence des montagnes se fait sentir. Pas de décoration ostentatoire, si ce n’est parfois que des petites toitures à deux pentes. La cour est entourée de bâtiments. Le logis « comporte un étage » et « occupe un des côtés, ce qui lui permet d’avoir deux pièces donnant sur la rue par des fenêtres ». Autres bâtiments, la grange se tient au fond (détenant en pignon, sous la toiture, une ouverture en demi-lune pour la ventilation du foin), une « étable-porcherie occupe le troisième côté ; enfin le bâtiment surmontant la porte-charretière, quand il existe, fait office de grenier ou débarras. »18 L’explication de ce plan, d’après l’auteur, résiderait par le besoin de la famille de se replier sur elle-même. Mais aussi par le souci de détenir de nombreux bâtiments d’exploitation vu la prédominance de l’agriculture et ses productions variées.
Aux alentours de Navarrenx, on peut observer « un autre type qui combine sous un même toit la maison d’habitation et la grange-étable, avec double entrée sur la rue, ainsi à Audaux ». Dans « un secteur des collines qui séparent la vallée du Gave d’Oloron de celle du Gave de Pau », on rencontre fréquemment « la ferme à cour complètement fermée ».18
Exemples :
- A Castetnau-Camblong, la maison Cabane située sur la « Côte Vieille, possède un porche d’entrée doté d’une porte monumentale donnant sur une cour peu importante. La demeure familiale se trouve à gauche, une grande grange surmontée d’un fenil en face et, à droite, une remise. La ventilation est procurée par des croisillons en bois.[24]
- A Narp, la maison Bonnecaze, proche de la salle communale, possède une façade en partie composée de « pisé », « peut-être le seul exemplaire de tout l’arribère ». [25]
Ferme (de 1761) à Préchacq-Navarrenx présentant deux entrées sur la façade donnant sur la rue : une porte cochère et une porte pour piétons.
5) La vallée du Gave de Pau, entre Pau et Orthez, englobant en partie le « Cœur de Béarn »
Extrait de la carte Cassini, source:
https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/france-en-cartes/la-carte-de-cassini?mode=desktop
- Généralités
Le Gave de Pau est bordé par une zone marécageuse dont est issue une végétation que l’on nomme dans la région, la saligue. Cette dernière est née des divagations du cours d’eau à travers son passé. La terrasse alluviale est globalement réduite, excepté aux environs de Pardies-Monein. Jean Loubergé précise que cette « exiguïté… a réduit la surface des quartiers de culture a pour conséquence des villages plus espacés avec une disposition linéaire moins nette. »[26] Sur ce qu’il nomme la « terrasse ancienne », soit la zone à partir de Pau constituée d’éléments grossiers, de landes et large souvent de deux kilomètres, l’habitat groupé était inconnu. « Les fermes étaient proches de leurs champs…le métayage y était répandu ». Les hommes retiraient de cette lande le pacage et le soutrage.26
- Les villages
Les villages « bien groupés de la rive gauche… qui ont un plan circulaire » (Pardies-Monein, Mallacq…) et les villages « à habitat semi-dispersé de la terrasse ancienne » (Labastide-Monréjeau, Audéjos…) « sont fidèles au plan classique ». L’exploitation agricole est constituée de « deux ou plusieurs bâtiments autour d’une cour, la disposition en équerre étant la plus fréquente ; la construction en galets est quasi générale ; le logis a une façade symétrique avec porte centrale, sur mur gouttereau. »
A l’Ouest du Béarn, et notamment aux alentours d’Orthez, J.J. Cazaurang décrit la disposition de l’habitat… « au milieu, sous le pignon, s’ouvre la grande porte de la grange-étable, l’habitation des hommes se logeant dans l’appentis. Quant à la technique, la maçonnerie à moellons cassés est la règle, avec des exceptions en faveur du galet ; des briques pleines « sarrous » viennent fréquemment en remplissage. »
De nombreuses maisons ne comportant pas d’étages ne sont pas rares, ceci s’expliquant par un nombre important de petits paysans. Le souci d’étaler sa richesse ne s’observe pas vu qu’il n’y a « peu de portails monumentaux, peu de cartouches au-dessus de la porte d’entrée du logis, pas de pavement central en pierres de taille sur toute la hauteur de la façade. » [27]
- Les matériaux
En ce qui concerne, la couverture, à partir de Lescar, l’ardoise et la tuile-picon se côtoient, alors que cette dernière prévale à partir de Lacq. Aux environs d’Orthez, la toiture se présente haute et pentue, supérieure ou égale à 45°, ce qui a pour effet de limiter la largeur des bâtiments. En effet, les dimensions de la charpente en hauteur et la superficie des combles seraient alors surdimensionnées. L’usage de la tuile picon est liée bien souvent à des constructions à façade en gouttereau, éléments que l’on rencontre au cours du XIXème siècle. Un mur gouttereau est un mur latéral qui supporte les gouttières, les gargouilles et qui contraste avec le pignon, mais aussi se dit d’un mur sur lequel repose la base de l’égout d’un toit. Au XIXème siècle, effet, l’habitation se démarque seule du reste des autres bâtiments d’exploitation, la façade-gouttereau et la tuile picon s’imposent.
Une analyse est consacrée à ces maisons à façade en gouttereau dans l’étude faite par CAUE64. Le toit brisé, à la Mansart, s’est étendu dans la région d’Orthez dans les riches demeures. Il comprend deux parties, la partie inférieure est la plus pentue, et est « couverte de tuiles picon, ou parfois d’ardoises, tandis que la partie supérieure, moins pentue reçoit parfois de la tuile creuse. » Ce type de toit procure au logis une « apparence aristocratique » et, aux bâtiments agricoles, de donner un plus important grenier et un « possible développement en largeur. »[28]
« A côté de la tuile plate classique, de forme rectangulaire, apparaît une tuile plate se terminant à sa partie inférieure par un arrondi, ce qui donne une couverture dite en « écailles de poisson ». [29]J.J. Cazaurang 27, de son côté, mentionne que si l’on exclut quelques maisons de maître, des châteaux et des églises, « la tuile rouge sombre à tonalités de pêche mûre, règne, couvrant des toits dont le pignon central, pointu, surmonte un ou deux appentis singulièrement plats ».
La génoise à plusieurs rangées ou des modillons « soutiennent la toiture au-dessus de l’égout. »Dans l’article issu de CAUE64 mentionné plus haut, il est écrit que la génoise est une avancée formée par un, généralement deux, quelque trois rangs de tuiles creuses superposés en débord du mur ». Selon la « fantaisie des maçons, la tuile peut se présenter par sa face concave ou par sa face convexe. Parfois même, les deux sont mêlés dans une même génoise. » [30]
Maison à Bosdarros, rue Pierre Bidau, comportant une inscription au-dessus de la porte. IHS (Iesus Hominum Salvator = Jésus Sauveur de l'Humanité) BERNARD DE PARDEILHAA LAN 1746.
Trois photographies prises d'une maison à Bosdarros, chemin de Rébénacq.
* Exemples de maisons rurales dans les coteaux de Jurançon
Jean Loubergé [31]écrit au sujet des maisons rurales avant le XVIIIème siècle, qu’elles étaient « très mal construites ». Il donne l’exemple d’une maison située à Jurançon, la maison du Pasa, dont nous avons un rapport assez détaillé fourni par des experts, maçons et charpentiers, daté de 1732. C’est une métairie « assez importante », constituée de la maison, d’une grange, d’une basse-cour, d’un jardin, d’une vigne, de hautins, de taillis et de châtaigneraie, de bois, de fougeraie et de terres labourables. Voici la description donnée par l’auteur : « Les murs étaient de qualité médiocre, faits de cailloux et terre pour la grange, de pierres brutes ramassées dans les coteaux pour la maison d’habitation ; seuls les cantons [angles des murs en pierre] des deux bâtiments étaient faits de pierres taillées. Les experts estiment que les murs de la maison menacent d’une ruine prochaine, la muraille étant « calcinée faute de l’avoir crépie » ; quant aux murailles de la grange, elles sont hors de leur aplomb et seraient tombées depuis longtemps dedans ; le verdict est qu’il faut les démolir au plus vite. La charpente est également en mauvais état car les poutres ont plié ; leur section était trop faible et elles contenaient par ailleurs un trop fort pourcentage d’aubier. Enfin le toit de la maison est en bardeaux et celui de la grange moitié bardeaux, moitié pailles. »
Il précise que dans le Jurançonnais, de nombreuses maisons qui risquaient de tomber en ruine « furent remplacées, dans le courant du XVIIIe siècle, pour des maisons mieux construites, avec murs de cailloux pris dans un mortier à chaux et à sable. Dès 1730, à peu près à la même époque que l’expertise de la maison du Paysa, la métairie d’Aressi (aujourd’hui maison de Nays) est déjà bâtie à chaux et à sable ; mais le toit est encore fait de bardeaux, de même que le toit des granges. » A cette période, «certaines maisons d’habitations » se voient dotées de « terrasses construites, soutenues par des murs de pierres brutes », telle la maison du Paysa. Peut-être s’agissait-il d’une « marque distinctive de domaine résidentiel. »
Maison de métayer au XVIIIe siècle, au château de Rousse à Jurançon. Façade étroite sous pignon, côtés allongés. Four accolé au mur, protégé par un toit mais caché par la haie. Porte donnant accès à une pièce faisant office de cuisine et de salle commune, à l’arrière se trouve une petite chambre. A l’étage, le grenier occupe tout le toit.
Aubertin: maison avec un four à pain
6) Le Nord-Ouest du Béarn
Extrait de la carte Cassini, source:
https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/france-en-cartes/la-carte-de-cassini?mode=desktop
- Généralités
Le paysage, ici, offre un relief peu élevé vu que les montagnes sont éloignées, ce qui explique que les altitudes sont peu élevées. En ce qui concerne les deux gaves, ceux d’Oloron et de Pau, ils présentent des terrains accidentés. Celui d’Oloron, la vallée est d’abord étroite puis s’évase dans la zone aux environs de Sauveterre-de-Béarn, celle de Pau a, au contraire, une vallée élargie avant d’aborder Orthez où elle devient encaissée. Au niveau climatique, nous sommes plus proches de l’océan que les autres parties de la province et, par conséquent, le vent et la pluie provoquent davantage d’effets sur les bâtiments.
Le calcaire crétacé est présent sur les collines, il est blanc, aisé à façonner, et procure une chaux de bonne qualité. Les carrières les plus connues se trouvaient à Orriule, Castetarbe…
Religieusement, cette région est incluse dans le diocèse de Dax jusqu’à la Révolution expliquant, selon Jean Loubergé, que l’on trouve des maisons de type landais (exemples à Labastide-Villefranche). Le même auteur rappelle la dualité entre collines et vallées pour ce qui concerne la mise en valeur et l’habitat. Il écrit que les « grandes vallées ont connu une mise en valeur précoce, la culture céréalière et l’habitat groupé », alors que dans les collines, « la mise en valeur a été plus tardive… où le boisement tient… une grande place ; la bourgeoisie d’Orthez, salies, Sauveterre s’y tailla de belles propriétés et le métayage fut très pratiqué. Aussi l’habitat en fermes dispersées y domine-t-il ; et l’économie agricole fut longtemps orientée vers une polyculture combinant céréales, vigne et élevage. »
- Les matériaux :
Trois cours d’eaux traversent cette partie du Béarn dans le sens sud-est / nord-ouest. L’utilisation des galets extraits des trois vallées est importante. Mais, il est en concurrence avec la pierre calcaire ou marneuse exploitée sur les collines, notamment du côté de Salies-de-Béarn. Le calcaire, aux XVIIème et XVIIIème siècles, servait spécialement pour les encadrements des ouvertures. La plâtrerie de Caresse était réputée. Jean Loubergé écrit que les tailleurs de Laàs étaient très réputés.[31] L’ophite (carrières de Leren et de Caresse) était utilisé pour les soubassements des maisons, sa provenance. Les carrières de sable autour de Salies étaient renommées.
- Les types de plan des maisons rurales :
A signaler, que la maison présente dans cette zone offre la particularité d’une maison de transition, en effet, les régions des environs (basque, landaise) jouent une influence.
Il y a celles qui présentent un « plan à en équerre, avec logis et bâtiments d’exploitation disposés autour d’une cour qui est plus vaste dans les collines que dans les vallées. » Un autre type, aussi répandu (le genre « ferme-bloc »), la cour étant seulement bordée par une seule bâtisse rassemblant hommes, animaux, matériel agricole et récoltes en deux parties, le logis et la grange-étable. Le « logis a une façade symétrique, avec porte centrale et une pièce sur chaque côté, et la grange-étable, qui lui est juxtaposée, s’ouvre sur la cour par une grande porte cochère. »
L’abbé Bonnecaze[32], dépeignant la localité de Bellocq, écrit que les maisons présentent une « forme particulière… la plus favorable pour loger beaucoup sur une moindre étendue, en mettant la famille et les animaux domestiques, entre les mêmes murs et sous le même toit, séparés par des couloirs et des murs de refend. La façade principale est toujours sur la rue, derrière la maison une très petite cour pour le fumier et les ébats des petites bêtes, le reste du rectangle occupé par le jardin… Il rajoute que dans les places certaines familles, plus aisées, ont agrandies leurs bâtisses. « … on voit, dans beaucoup de maisons, deux chambres ouvrant sur la rue séparées par le large couloir qui abrite les instruments d’agriculture, quelquefois même la façade plus allongée, sans que la construction s’écarte de la forme autrefois usitée… »
Une variante se trouve autour d’Orthez. « Une construction, accolée à l’arrière du logis, sert d’étable, elle a un toit en appentis qui est recouvert de tuiles-canal »31
Au nord-ouest de la zone étudiée, Jean Loubergé précise qu’il existe deux types de maisons uniques dans leur genre.
Le premier type se distingue d’une grande grange-remise qui s’ouvre par une vaste porte cochère, elle est surmontée d’un grenier-fenil, son toit est très pentu et est recouvert de tuiles plates. De chaque côté, deux bâtiments plus bas abritant, pour l’un, l’étable et, pour l’autre, l’habitation. Cette dernière est constituée de deux ou trois salles en enfilade, « la cuisine étant toujours la première de celles-ci, en façade sur la cour. » L’ensemble est recouvert d’un galetas, « car le toit très plat est couvert de tuiles canal. » On le rencontre dans une zone entre le nord d’Orthez et aux alentours de Sauveterre-de-Béarn, il porte le nom de « glousse » ou de « clouque ». Ce nom évoque la poule qui déploie ses ailes pour protéger ses petits. Ce sont les métayers qui l’adoptaient davantage.
L’autre type est caractérisé par un toit dit à la « Mansard », moins présent dans le sud-ouest. Grâce à la surface du toit que procure ce type de couverture, les propriétaires ont obtenu des greniers et des fenils plus vastes. Jean Loubergé mentionne qu’on le rencontre aux environs de Puyoo et de Sauveterre-de-Béarn, par l’existence de charpentiers qui avaient opté pour cette spécialisation et le souhait des propriétaires de copier le modèle urbain présent à Orthez et Salies. Ces dits propriétaires étaient fortunés.
La maison à façades en pignon est la plus commune. Elle est « percée d’une large porte charretière en son centre. La saillie d’une pierre évier, d’une cheminée, ou la présence d’une porte nous montrent qu’une travée [division du plan correspondant à une portée de poutres ou de solives entre ses deux appuis, généralement deux murs] latérale, généralement au sud, abritait le logement. »[33]
Deux photographies prises de la maison Chrestia (où naquit le poète Francis James) à Orthez : maison à cour du XVIIIe siècle, avec galerie de bois donnant sur la cour, au sud.
- Les matériaux
En ce qui concerne la tuile, son usage entraîne répercussion sur l’architecture. Si on utilise la tuile creuse, il est vital de disposer seulement d’une couverture comportant une légère pente, inférieure à 30 °, ce qui procure l’avantage d’élargir la maison en largeur. Par contre, si on met la tuile picon, la pente est alors supérieure ou égale à 45 °, raccourcissant la largeur de la bâtisse. D’autre part, la tuile creuse est posée fréquemment sur les façades en pignon, alors que la tuile picon correspond plutôt à des bâtiments à façade en gouttereau.[34]
La décoration telle la gênoise, la frise ou la corniche n’est pas absente. Rappelons que la gênoise est « une avancée formée par un, généralement deux, quelquefois trois rangs de tuiles creuses superposées en débord du mur. Au gré de la fantaisie des maçons, la tuile peut se présenter par sa face concave ou par sa face convexe. Parfois même, les deux sont mêlés dans une même génoise. » [35]
Corniches d'une maison datée de 1782 à Orthez, rue Saint Gilles.
7) Le pays des Luys et du Gabas
Extrait de la carte Cassini, source:
https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/france-en-cartes/la-carte-de-cassini?mode=desktop
Cette région forme un triangle dont les sommets correspondent aux localités de Garlin à Orthez au Nord, d’Orthez à Pau à l’Ouest et de Pau à Garlin, par conséquent, délimitée par le Vic-Bilh et le Nord-Ouest du Béarn. Ses reliefs sont composés de vallées et de collines où l’argile est quasi omniprésente. La végétation est constituée sur les collines de bois de chênes et de châtaigniers et sur les ribeyres des landes ce qui explique que dans le passé cette région était pauvre. Le bocage tapisse le paysage.
Dans la zone nord-ouest de ce triangle, le défrichement s’est effectué sous l’impulsion à la fois de l’abbaye de Larreule et des seigneurs, implantant des bourgs sur les hauteurs. On pense à Morlanne, Arthez-de-Béarn… En dehors de cette contrée, l’habitat dispersé est maître, ce qui occasionne un centre modeste des villages.
Les habitants pratiquaient la polyculture, utilisaient le bois des forêts qui pourvoyait « un appoint indispensable aux paysans avec la vente du bois de chauffage et les châtaignes, sans compter la chasse et le braconnage. »[36]
Le Vic-Bilh se retrouve dans cette région en ce qui concerne les constructions. On y voit d’un côté des grandes exploitations « avec des bâtiments nombreux » et des petites « sans étage ne comportant que deux pièces et une porcherie-poulailler d’importance très réduite ». Au Nord, près des Landes, de nombreuses « petites maisons basses… il y a une indication sociale. »
- L’ornementation
Un fronton de petite dimension est « assez fréquent dans la partie Sud-Est, au Nord de Morlaas, en façade de maisons couvertes d’ardoises ; il s’y associe avec la présence sur les murs de façade et quelquefois sur les murs pignons, de motifs ornementaux en crépi blanc qui se détachent sur le crépi gris… »
Au sujet de la couverture, l’ardoise est remplacée progressivement au fur et à mesure que l’on avance en direction du Nord-Est par la tuile-picon. Parallèlement, « les motifs en crépi blanc disparaissent. » Toujours, dans le Nord-Est, on retrouve les petits frontons.
Couverture en tuiles picon, maison à Orthez, rue Saint Gilles.
Les tuileries dans la zone étudiée sont nombreuses, notamment à Sauvagnon, du fait de la forte présence de l’argile permettant de réaliser non seulement des tuiles, mais aussi des « grosses briques de construction pendant l’été, des adobes pendant l’hiver pour occuper la main d’œuvre... »
Autre décoration, la génoise parcourt le dessous de l’égout du toit.
Dans cette région des Pays des Luys et du Gabas, le matériau de construction de prédilection reste l’argile, utilisée « soit sous forme de torchis ou de pisé, soit sous forme d’adobes qui trouvent ici une utilisation non négligeable. »
8) Le Vic-Bilh et le Montanérès
Extrait de la carte Cassini, source:
https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/france-en-cartes/la-carte-de-cassini?mode=desktop
Vue partielle d'un paysage du Vic-Bihl prise près du château d'Arricau-Bordes. Plaine de Lées.
- Généralités
Si le Vic-Bilh (« vieux pays ») est la zone la plus ancienne incorporée au Béarn, le Montanérès, à l’opposé, a été rattaché au milieu du XIème siècle. Son paysage est parsemé de collines et de vallées. Les hommes ont privilégié l’occupation des lignes de crête et les versants des collines orientés vers l’Est. Leurs villages sont composés d’un centre étriqué et d’habitats dispersés. Quelques bourgs se détachent comme Lembeye et Garlin. Les paysans produisent de la polyculture, de la vigne qu’ils exportent sous l’Ancien Régime. Nous sommes en présence d’une région de petites propriétés et, par conséquent, dans laquelle on ne dégage guère beaucoup de revenus. On y vit quasiment en totale autarcie. Le maïs s’est implanté à la suite notamment de défrichements des landes. Des artisans confectionnent des tuiles à l’aide de l’argile extraite sur place, souvent sur le sol de la combe. Comme ce dernier possédait la caractéristique d’être meuble, on pouvait confectionner le liant des galets et des briques. La demeure terminée, on se servait du creux obtenu dans le sol pour s’en servir de mare.
- Les types de plans
L’emplacement de la maison, est comme partout ailleurs, bien choisi. Eviter de trop l’implanter sur des hauteurs balayées par les vents, sur les rives d’un cours d’eau pour éviter les crues (« les arribères »), au fond des vallées pour ne pas subir les problèmes de santé. Quel choisir ? Une combe (« come ») « à mi-coteau, le plus souvent abritée des pluies d’ouest et des frimas nordiques, tournée vers l’est. » Pour mieux protéger la maison des vents océaniques, on plantait fréquemment des haies.
Comme la grande majorité des paysans, ils se doivent d’être autosuffisants, ce qui explique que les fonctions soient concentrées autour d’une cour.
De ce fait, à côté de maison, la ou les granges (les terriers mentionnent souvent « les »), une cour, un jardin. Il faut y adjoindre le four, le poulailler-soues, le puits, la clôture de galets… »[37]
L’ensemble correspond généralement à un arpent.
Jean Loubergé décrit les fermes comme des « fermes-cours, la cour étant séparée de la rue par un mur bas ou seulement une barrière de bois. » Se détachent uniquement quelques grandes exploitations agricoles qui sont constituées d’une « maison d’habitation à étage et des granges-étables souvent importantes, avec deux ou trois portes charretières. » A l’opposé, les petites fermes sont pléthores puisque la paysannerie, à l’époque, est composée surtout d’humbles agriculteurs. Le même auteur souligne qu’elles « sont fréquemment accompagnées à l’arrière d’une construction en appentis, avec couverture de tuiles-canal, et on y relève souvent cette trace d’archaïsme que l’absence d’un couloir central. Elles sont basses, sans étage. »
La grande majorité des fermes se compose donc de deux bâtiments, un logis et une grange étable, soit disposés en équerre, soit assemblés sous un même toit.
Dans la plupart des cours, on trouve un puits, situé près du logis en général.
Dans les villages, les maisons suivent le tracé des routes et se disposent en vis-à-vis.
Si on devait établir un parallèle entre la propriété rurale, la catégorie sociale des exploitants et la maison rurale, on pourrait distinguer trois types de tenures. Le casau correspondrait entre 10 et 12 ha, l’ostau entre 7 et 8 ha et, enfin, le botoy , moins de 7 ha. Ce dernier genre appartient à un ouvrier agricole, possédant une petite demeure de deux pièces, construite avec du pisé, une grange également de moindre importance, multifonctionnelle (grange, remise, écurie, étable). Quant à l’ostau, c’est elle qui représente le type même de maison traditionnelle du Vic-Bilh. Vu la quantité de surface dont il est propriétaire, il n’est pas obligé de travailler pour un autre paysan plus fortuné, il peut vivre non misérablement. A Casteide, une maison (nommée Bergerée) en 1759 est estimée à 440 livres. La description est la suivante : une porte d’entrée implantée au sud, une façade comportant deux ouvertures, des murs « à chaux et à sable », une couverture d’ardoises. On ajoute à cela un appentis servant de cuisine au nord, fermé d’un mur de terre, recouvert de tuiles. Il détient aussi deux granges. La valeur de l’ensemble est estimée à 600 livres. Enfin, dernière catégorie, le casau, ses finitions sont plus élaborées, le propriétaire restant discret. On élève un étage, on agrandit la maison par rapport aux autres paysans, on soigne les encadrements des ouvertures des granges, on entoure la cheminée d’un joli manteau de bois… Il embauche, lors des travaux saisonniers, le propriétaire d’un botoy. S’il emploie de façon permanente des ouvriers agricoles, il les loge dans l’arrière-cuisine, le comble ou dans la grange.[38]
En dehors de ces trois types de tenures, il existe un petit groupe de riches propriétaires.
Les dimensions de ces maisons, surtout si elles comportaient deux pièces (pièce principale, cuisine) et un vestibule, sont de 14 à 16 mètres. Si elles sont dotées d’un étage, elles varient peu en réalité. Au niveau de la largeur, la moyenne se situe entre 7 et 10 mètres approximativement. Quant à l’épaisseur des murs, on constate une moyenne comprise entre 0,60 m et 0,65 m. Enfin, la hauteur des murs oscille dans une fourchette entre 3 et 6 m.
Un grand portail monumental donnant sur la rue, quelquefois surmonté d’un toit, permet d’accéder à une cour intérieure autour de laquelle s’ordonnent le logis et les dépendances. Ce portail le plus courant est constitué de « deux cadres de châtaigner dans lesquels sont passées des barres de fer soudées dont le bout est martelé en pointe de flèche. »
Mais aussi, il existe, comme dans la plaine de Nay, des portails de bois, en chêne ou en châtaigner, d’une hauteur de plus de 2 mètres. Le bas est barré par de larges bandes verticales. « … parfois, une zone intermédiaire d’une vingtaine de centimètres de haut est garnie de petits barreaux tournés, ou plus fréquemment de planches transversales, tandis que la partie supérieure est formée de barreaux de bois carrés sur l’angle. Ces vantaux très lourds sont généralement maintenus dans des crapaudines de pierre en bas et dans la poutre de couvrement en haut, car ce sont là des vantaux de corps-de-passage ou de portails couverts traditionnels du Béarn et en général de la zone des Pyrénées centrales. » Moins courants que ceux qui sont couverts d’ardoises ou de tuiles.[39]
Pour les plus pauvres, le portail se matérialise seulement par un appareillage de branches.
Un petit jardin (« casalet ») fait fréquemment partie intégrante à la ferme.
Exemples de plans de maisons rurales:
Deux photographies prises à Moncaup : ferme présentant une façade avec un petit fronton central, une toiture en tuile picon. A droite, un poulailler et une porcherie, avec une galerie de bois.
- Les matériaux
Au niveau des matériaux, on utilise le galet et des « moellons de pierraille » pour les grandes fermes généralement, mais aussi l’argile qui abonde dans cette région. En effet, elle est usitée dans la composition des pisés (tapis) dans le monde rural en ce qui concerne les habitations, les bâtiments annexes. Cette partie du Béarn utilisera le plus longtemps ces matériaux organiques.
Si on use de la pierre, avant le troisième quart du XVIIIème siècle, on opte pour du grès, à partir de cette époque la pierre des Pyrénées (ou le marbre gris) la remplace progressivement,
Le calcaire est rare, peu de gens n’ont pas les moyens de faire venir de la chaux. La brique n’est pas inconnue, on l’emploie « dans les encadrements des ouvertures, ou noyée dans l’opus incertum. » [40]
A l’intérieur des demeures, on séparait les pièces par des cloisons (« parets ») réalisés en torchis (« mélange de croisillons de chênes, de lattes de châtaignier, de crin ou d’une argile grossière… ») [41]Ce torchis permettait de réaliser parfois des plafonds.
Les murs, comme nous l’avons vu dans d’autres parties du Béarn, sont souvent disposés selon le système dit de « la fougère », c’est-à-dire en alternant les rangées de galets inclinés dans un sens opposé.
Ces murs, afin de les protéger, sont enduits de chaux (recouverts préalablement d’un enduit grossier), si possible, chaque année. Les façades offrent à l’observateur la vision d’un « ocre tirant sur le doré. » A des fins de décoration, on badigeonne le bas des murs sur une hauteur avoisinant les cinquante centimètres. On opte pour le brun rouge, couleur que l’on retrouve également à l’intérieur des maisons.41
Les maçons, à des fins ornementaux, pouvaient jouer, lors de la pose de l’enduit, du « contraste entre des parties lissées et grattées, claires et ocrées… quant ils ne recomposaient pas la façade par des bandeaux ou des panneaux. Parfois même, ils inscrivaient dans l’enduit des motifs décoratifs : cœurs, croix latines, « croix basques », rosaces, guirlandes… » [42]
Les murets qui séparent la ferme de l’extérieur sont généralement peu élevés (1,20 à 1,50 m). Réalisés en galets, suivant la disposition « de feuille de fougères », peu fréquemment enduit.
Ces murets englobent, on l’a vu, le logis et les dépendances. Outre la grange-étable, viennent s’ajouter le poulailler et la porcherie, la plupart du temps assemblés sous un même petit bâtiment, couverts par un toit à deux pans et accolés au logis (parfois intégrés au four afin de profiter de la chaleur).
- Les toitures
Quant à la toiture, ces régions se distinguent par la tuile picou plate qui domine dans le Vic-Bilh (parties Nord et centre ; l’ardoise dans la partie Sud) alors que l’ardoise règne dans le Montanérès. La tuile picon (et l’ardoise) remplacent les matières organiques au départ sur les habitations, ensuite aux granges. La couleur de la tuile picon donne à la toiture une couleur chaude rousse. Elle peut être ouvragée, avoir un embout arrondi ou parfois donnait des « tons alternés en losange dans un souci esthétique. » (andré anglade)La tuile-canal couvre les toits plats de la zone démarrant « à partir de Castéra-Loubix ». Mais Le chaume, les bardeaux recouvraient également de nombreux bâtiments, le chaume sera utilisé jusqu’au début du XXème siècle.
Le bois de charpente est constitué surtout de châtaigniers et de chênes.
- L’ornementation
Le fronton que nous avons vu précédemment est aussi présent dans le Vic-Bilh, essentiellement à partir de la fin du XVIIème siècle. On rappelle que le toit, et la forte pente qui le distingue, permet une grande surface. Une petite baie est positionnée sous le fronton. La lucarne-fronton a deux fonctions, décorer en rompant la monotonie de la façade et servir « un peu » d’aération et d’éclairage, le plus souvent à un grenier (« soulé ») ou une chambre de dimension réduite (la crampette »), réservé souvent à un domestique.(
Il est courant au nord de Morlaàs, « entre Thèze et Garlin, à la limite ouest du pays… »41
Le souci de la décoration est palpable avec la génoise, sous la toiture, composée de « tuiles creuses maçonnées, souvent portées par des moulures de briques formant des ressauts successifs. » Les fonctions de cette corniche sont multiples : soutenir les pieds de chevrons, protéger les murs du ruissellement des eaux de pluie, décorer en jouant sur les effets d’ombre et de lumière. La génoise « enveloppe la lucarne-fronton qui se trouve ainsi fermement liée au mur. »42
Au sujet de cet élément décoratif, elle est fréquemment affichée « dans la façade des grandes constructions de style classique à partir du XVIIe siècle. »[43]
Fréquemment un balcon (« arrayadiu ») est disposé à l’arrière de la demeure, son utilité est la même que celle que nous avons analysée auparavant, c’est-à-dire faire sécher les récoltes, le linge…
En ce qui concerne les fenêtres, on en observe deux rangées ou, pour les maisons de paysans fortunés, de quatre. Le souci de symétrie joue à plein avec le fronton.
Certaines maisons « présentaient un curieux mur fronton, très haut, un peu semblables à celui des petites églises du Vic-Bilh à ceci près que la base seule était de pierre taillée, le reste était fait de galets ou de torchis en colombages. » Ce dit mur pouvait comporter plusieurs petites ouvertures, peut-être des niches à pigeons. Des appentis, avec des inclinaisons plus douces, recouvraient les dépendances.
André Anglade, par la suite, décrit l’intérieur des maisons de la région.
Les portes d’entrée dans le Montanérès sont coiffées d’arcatures « en plein cintre ou anse de panier », du fait de l’influence reconnue de la Bigorre, toute proche.
Au-dessus de la porte d’entrée, il est courant de voir une inscription, un nom, une date. Le propriétaire est fier de porter le nom de sa maison. Aux chronogrammes, on associe généralement le nom, aux XVIIème et XVIIIème siècles.
Il faut se méfier de la date, car parfois, elle ne correspond pas toujours à l’édification. Lorsqu’adviennent un changement familial, un souhait de restaurer la façade, on corrige le linteau.
Cette même porte d’entrée, surmontée du fronton, donne sur la pièce principale. Une fenêtre placée à droite de l’entrée éclaire l’intérieur de ladite salle. Un petit couloir sera ajouté, « par la suite », pour accéder au grenier. Un petit réduit est aménagé sous l’escalier, servant soit de débarras, soit de chambre d’enfant. Dans cette salle, on observe une cheminée « sur le mur de droite », elle est légèrement rehaussée, « assez imposante par sa profondeur avec ses coins (cantons ou cornets) réservés aux anciens. » Un four lui est accolé, la partie qui se trouve à l’extérieur est « de forme arrondie couverte d’un petit toit... », habituellement orienté au nord.
Nombre de fours ont été ajoutés au XIXème siècle. Au siècle précédent, le four banal était parfois le seul utilisé, comme à Morlaàs ou dans d’autres localités.
Dans les maisons plus cossues, à gauche de l’entrée, « vers le sud généralement, était une pièce de réception ou d’apparat » qui deviendra plus tard soit une chambre d’invités, soit une salle à manger « lorsque le gain de place et la mode favorisèrent des mœurs plus urbanisées… »
Dans le logis, à l’arrière, parfois, d’autres pièces sont accolées : « un appentis, à vocation utilitaire, arrière-cuisine, « hournère », remise, ou chai. », ou tout simplement des chambres.42 (hournère : fournil) Le toit décline très bas et, de ce fait, protège, lorsque c’est un appentis, la bâtisse des vents de pluie.
Les plus aisés ajoutaient occasionnellement un étage pour installer des chambres. Mais, en général, il n’y a pas d’étage vu le manque de solidité des murs, donc on préfère étaler en longueur la maison.
A ce propos, il ne faut point omettre le fait que lorsqu’un événement familial survenait, on réaménageait ou on agrandissait la maison, si bien entendu on en avait les moyens. Si le projet de reconstruction se concrétisait, il était courant de le réaliser en tranches. L’exemple de la ferme Berdaille de Taron est significatif. En 1762, on construit la grange suivie de l’écurie en 1764, on dresse un étage à la maison en 1767.[44]
Ces agrandissements, ces adjonctions montrent l’augmentation du niveau de vie des propriétaires, cela se répercute aussi à l’intérieur par l’obtention de mobiliers.
Quant à la décoration des ouvertures, à la suite de l’abandon des matériaux dits organiques (torchis…) et leur remplacement par des matériaux durs comme les galets que l’on recouvre d’enduit ; les « points sensibles de la construction, encadrements de portes et de fenêtres, angles de murs, cheminées… font appel à la pierre ou à la brique. »42
En ce qui concerne les volets, on les dispose à l’intérieur. A la fin du XVIIIème siècle, ils correspondent à « un bâti de bois décoré d’une moulure en carré ou en losange. » On les peint soit de brun rouge, soit de gris bleu, ou , enfin, mais « plus rarement en vert foncé. »
Le sol, souvent de terre battue, peut être revêtu de briques de pavement, quelquefois une bande de 2 mètres de galets longent la demeure.
- Les artisans
Les censiers, les actes notariés où on dresse des contrats de constructions révèlent des noms d’artisans. Le charpentier Dominique Courtialh s’engage, le 2 janvier 1791, auprès de Bernard Lagabarre, à réaliser des travaux sur la maison, et, par conséquent, elle sera « prête à être couverte et à être fermée en torchis. » à la livraison. Il est inscrit qu’il fournit le boisage. Le tout pour une somme qui s’élève à 54 livres.
Les maçons sont peu nombreux, et nombre d’entre eux, sont à la fois maçon et charpentier. Comme ce dénommé Marsan, « architecte » gantois, qui peut se prévaloir d’avoir réalisé le retable d’Anoye, la chaire de Vieillepinte et la chapelle Saint-Jacques de l’église de Moncaup.
Quant aux tailleurs de pierre, au vu des nombreux encadrements de pierre des ouvertures réalisés durant le XVIIIème siècle, il s’avère que leur nombre était relativement important.[45]
9) La plaine de Nay (La Batbielle ou « vallée vieille »)
Extrait de la carte Cassini, source:
https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/france-en-cartes/la-carte-de-cassini?mode=desktop
- Généralités
Cette région forme un triangle de près de 25 km délimité par trois cours d’eau, à l’Ouest par l’Ouzom et le Gave de Pau et à l’Est par l’Ousse. Dans le Béarn, elle est considérée comme la région la plus riche (agriculture, artisanat rural, fabrication de textiles à Nay). En réalité, ce n’est pas une plaine, mais plutôt une large vallée circonscrite par des coteaux. C’est une zone agricole où l’arbre se cantonne seulement sur les coteaux et sur la saligue le long du Gave où se sont déposés des alluvions composées d’argile et de sable. Ce Gave est essentiel vu que les constructeurs y puisent le gravier et le galet, mais peut engendrer des catastrophes lors des crues capables de détruire plusieurs fois le pont de Nay. Sur les récoltes et les habitations, ses effets sont nuisibles vu que son cours sort de son lit souvent. Ce qui explique que pour lutter contre ces accidents, les hommes doivent se regrouper et former des gros villages et un habitat groupé. Pour l’aménagement de ces terres, on interdit l’implantation de bâtiments et d’arbres. De plus, « sur les coteaux avoisinants, de terres communales maintenues volontairement incultes pour servir à la fois au pacage des troupeaux et au soutrage nécessaire pour avoir de la bonne fumure. » L’auteur rappelle que le mot soutrage vient de soutre donc de la fougère servant alors de litière pour le bétail ou de fumier.[46]
Les paysans produisaient du « blé et maïs [qui] se succédaient en assolement », du lin. Ils élevaient des bovins et des chevaux « le long des cours d’eau (Gave ou ruisseaux affluents) des prés humides enclos de haies… » Ils servaient également de « main d’œuvre rurale travaillant à domicile » grâce à l’industrie textile à Nay, expliquant « le nombre des villages et leur importance. »
- Les villages
En ce qui concerne les villages, l’auteur mentionne qu’ils sont « sans plan bien défini, à l’exception des deux anciennes bastides de Lestelle et de Montaut; celles-ci, fondées au XVIe siècle par le regroupement de peuplements préexistants plus diffus… » Pas d’habitations trop éloignées les unes des autres en milieu rural dans la période qui nous intéresse, excepté par pure nécessité les moulins au bord des cours d’eau.
Lorsqu'on observe les inscriptions mentionnant les dates, il ressort qu'à partir de 1780, le nombre d'édification de bâtiments s'accroît beaucoup, la conjoncture économique explique en grande partie ce fait.
- Les types de plan
Le logis et les fonctions agricoles ne sont jamais réunis sous un même toit. Ces dernières (écurie, étable, fenil... assemblés sous un même bâtiment portent un nom commun, la borde.
A côté de ce bâtiment, s'en adjoignent d'autres comme le four.
Les exploitations agricoles sont constituées de bâtiments entourant une cour généralement spacieuse. Les bâtiments, habitation et grange-étable, sont de forme rectangulaire généralement. La façade du logis ne donne pas fréquemment sur la rue et est orientée à l’est ou au sud-est, à l’abri du vent et de la pluie, donc, au soleil. Conséquence, la « façade d’une maison a pour vis-à-vis l’arrière sans ouverture de la maison voisine. »[47] Incidence sur le plan des villages, comme à Assat ou à Noguères, « transversales à la direction générale de la vallée, même la façade de la maison d’habitation est invisible de la rue, comme la plupart des rues de villages ont une direction N.O.-S.E., c’est-à-dire la direction générale de la vallée, et que la façade de la maison s’ouvre au Sud-Est, c’est d’ordinaire le pignon qui se trouve en bordure de la rue ; celle-ci présente alors une succession caractéristique de pignons placés à une certaine distance les uns des autres, chacun étant séparé du pignon de la maison voisine par toute l’étendue de la cour. » [48]
Comme le prouve la maison Sallanabe à Saint-Abit qui date de 1702, les maisons comportant un étage et comportant trois travées existaient.
- Les matériaux
Le galet roulé du gave prédomine dans la construction, le torchis ou le pisé sert pour les « cloisons intérieures de maisons modestes et il y est parfois renforcé de carcasses d’épis de maïs. »
Le galet, au Moyen Age, n’est pas fréquemment utilisé, car le mortier de qualité, nécessaire pour la résistance du mur en tant que liant, n’est pas courant. Par contre, il le sera davantage aux XVIIème et XVIIIème siècles.
La région bénéficie de la richesse des matériaux qui parsèment son sol, outre le gave qui fournit les galets, il procure aux bâtisseurs du sable.
Les galets sont liés au mortier. L’auteur précise qu’à partir du XVIIIème siècle, on fait venir l’ardoise depuis Lourdes pour la toiture, qu’on utilise la chaux de bonne qualité produite dans les fours de Montaut.
La pierre, vu son prix élevé, est réservée aux œuvres ou à des parties des bâtiments que l'on considère digne d'intérêt.,
Le calcaire abonde dans cette contrée, en effet, des carrières se trouvant à Nay et à Saint-Abit, procuraient un calcaire à grain de qualité apte à la sculpture.
La chaux provenant des fours de Montaut, comme on l'a vu dans un précédent article, fournissait un très bon liant.
Le crépi ne recouvre pas systématiquement les bâtiments, ce sont surtout les habitations qui en sont badigeonnées. Lorsqu’elles le sont, elles sont ornées sous la retombée du toit d’une « génoise formée d’une ou deux rangées de tuiles creuses présentant leur tranche et recouvertes d’un crépi blanc. »48
Sur l'habitation, l'enduit est plus « raffiné », « il peut jouer des effets de lissé et de gratté, il peut être rehaussé d'un badigeon, généralement teinté d'ocre, mais parfois de rouge, voire de bleu, il peut être découpé en registres par des cordons... Mais l'enduit, quels que soient ses qualités, se soumet toujours à l'ornement de pierre. »
Les bâtisseurs n'hésitaient pas à « tricher », la « vraisemblance suffisait et peu importait que les corniches, les chaînes ou les cordons qui rythmaient la façade fussent faits de pierre ou d'un enduit à son imitation. » Par exemple, des angles de corniches étaient taillés dans la pierre, alors que les éléments droits sont réalisés avec du mortier « tiré au calibre ».[49]
Lorsque l'enduit est appliqué sur des bâtiments utilitaires, il est plus grossier.
Outre les grandes exploitations, les petites ne sont pas dotées d’étages (ou surmontées seulement d’un grenier) et une grange-étable leur est accolée. On trouve « des maisons sas dépendances (sauf une porcherie-poulailler) ayant abrité autrefois des brassiers ou des artisans ; dans les villages proches de Nay, où les tisserands étaient nombreux, les métiers à tisser se trouvaient dans une pièce basse accolée à l’arrière du bâtiment et couverte d’un toit en appentis. On rencontre surtout ce type de constructions aux extrémités des villages. »
- Les différents types de plan
Le plan général des fermes forme une équerre constituée de deux bâtiments, le logis et la grange-étable, « leur façade sur mur gouttereau encadre la cour. » Un espace séparait couramment les deux bâtiments afin d’éviter tout risque d’incendie. Plus tard, à partir de la fin du XVIIIème siècle, des propriétaires qui se sont davantage enrichis, élèveront d’un étage la maison d’habitation par souci d’agrandissement mais aussi par vanité. « Un couloir central qui donne accès à l’escalier individualise désormais les deux pièces du rez-de-chaussée, cuisine et salle à manger ou parfois même salon, tandis que les chambres sont à l’étage ; au-dessus de celui-ci, le grenier garde toujours son importance. »48
L’abbé Bonnecaze, d’ailleurs, se moque de cette vanité à étaler son élévation du niveau de vie. En écrivant sur les habitants de Coarraze, il les décrit comme des gens aimant le luxe « qui les rend pauvre ; ce défaut est presque général dans ce lieu. Ils ont la fureur de bâtir des maisons et la folie de la vanité, et c’est ce qui les perd. » [50] Il rédige cette étude à partir de 1772.
Les grandes exploitations comportent le bâtiment d’habitation avec un étage surmonté d’un grenier, des granges-étables avec plusieurs portes cochères, souvent avec des encadrements de pierre en arc surbaissé. Elles encadrent de trois côtés la cour qui est fermée par un mur de près de deux mètres de hauteur. L’accès à la rue se fait grâce à deux portes, l’une pour les piétons plus petite et l’autre pour les charrettes.
Les signes de richesse dans cette zone sont nombreuses que ce soit des petites ou des grandes fermes. De la rue, on remarque les portails encadrés par des piliers surmontés de décors divers comme des boules, des pignes, des coupes…, de toits-couverts. Un terrier de 1748 de la localité de Pardies-Monein démontre que cette dernière marque de distinction se payait par un impôt de 4 livres. Parfois, le portail « un arc surbaissé et recouvert de dalles plates provenant des carrières d’Arros… »[51] Autre type de portail, celui à deux grands vantaux de bois sur lesquels on dépose un toit recouvert d’ardoises, ce genre est très représentatif dans cette région, mais on le retrouve également dans la vallée du Gave d’Oloron et dans la vallée de l’Ousse.
Lorsqu’on pénètre dans la cour, on remarque au-dessus de la porte d’entrée du logis des linteaux ouvragés, des cartouches réalisés sur du calcaire provenant notamment de la carrière de Saint-Abit, ou des carrières locales. Une pierre de forme rectangulaire généralement, d’un mètre de large sur une trentaine ou quarantaine de centimètres de largeur, contient soit la date de construction, une inscription, le nom du propriétaire, un motif décoratif (volutes, grappes de raisin, parfois stylisé). Les propriétaires aisés n’hésitent pas à donner à cette plaque des dimensions ostentatoires, du haut de la porte d’entrée jusqu’au toit. Les artistes majoritairement sont des artistes locaux.
Le sol de la cour est occasionnellement pavée, « en gros cailloux roulés du gave fichés en terre, qui offrent à l’œil leur bout arrondi ; mais souvent ce pavage n’existe que le long des bâtiments, formant une chaussée pour aller de l’un à l’autre tandis que le reste de la cour, domaine de la volaille, est en terre battue ; dans un coin, le puits ou la pompe ; dans un autre coin, un petit bâtiment bas formant poulailler-porcherie. »
A côté de ces grandes fermes, les petites, les plus courantes, sans étage, comportaient des dépendances également de taille réduite. De ce fait, la maison comportait seulement qu’un rez-de-chaussée et un grenier. Parfois, le logis était moins important que la grange. La porte d’entrée, située au centre de la façade de la maison d’habitation donnait sur une salle servant à la fois de cuisine et de salle commune (dotée d’une grande cheminée qui, de sa hotte, couvrait des bancs), à côté, séparée parfois seulement d’une cloison de planches, une chambre. De la salle commune, un escalier accédait au grenier « la plus belle pièce de la maison, haute et aérée, avec sa magnifique charpente en forme de nef, caractérisée par l’absence de grande poutre faitière. »48 Ce grenier sert à faire sécher la récolte grâce à l’air qui peut s’introduire par des fenêtres mansardées, mais aussi de chambre que l’on peut aménager par le biais d’une cloison et qui s’ouvre par une fenêtre disposée sous le pignon du toit. « C’était la chambre de l’héritier. Les cadets et les grands-parents dormaient dans des appentis attenant dans la cuisine ou à la grange, ou dans des alcôves de la salle commune, généralement placées sous l’escalier qui conduisait au grenier. »48 Ce plan intérieur peut être modifié en ajoutant une pièce au rez-de-chaussée.
- La toiture
La toiture des maisons et des granges-étables se caractérisait par une forte pente, des bardeaux ou du chaume qui seront remplacés par des tuiles plates ou des ardoises. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, les bardeaux et le chaume sont encore utilisés comme l’atteste le cadastre de Bésing daté de 1774.
Sur 16 maisons d’habitation, 4 sont revêtues de paille, 6 de bardeaux et 6 d’ardoises ; concernant les granges, sur 19, 16 sont couvertes de paille, 1 de paille et de bardeaux. Autre document qui atteste encore la présence de bardeaux et de chaume, le récit d’un Bordelais aux mois de juin et juillet 1765. Arrivé à « l’Estelle » (Lestelle-Bétharam), il raconte que toutes les maisons qu’il a vues « sont toutes couvertes à deux eaux ou d’ardoises, dont les carrières ne sont pas éloignées, ou de petites tablettes de hêtre qui imitent celles-ci, ou de paille artistiquement arrangés. »[52]
La tuile et l’ardoise s’implanteront surtout à partir du début du XIXème siècle avec l’accroissement de richesse des gens.
La raison de ces fortes pentes, le souci de détenir un grand grenier, d’utiliser un savoir-faire des charpentiers que l’on retrouve aussi dans les Pyrénées centrales.
Lorsque ces toits à forte pente sont recouverts d’ardoises ou de tuiles, on distingue deux sortes de forme : la « croupe » et la « demi-croupe ». « La forme dite « croupe » donne un toit à quatre pans ; la pente, très rapide en haut, s’adoucit dans le bas pour chercher appui sur les murs… » La cause est à chercher dans le souci de rejeter l’eau de pluie loin des murs. « Le toit « demi-croupe » comporte deux grands pans tombant sur la façade et l’arrière de la maison, et deux pans très courts, souvent à peine marqués, sur les pignons… ce toit … permet l’ouverture sous les pans courts soit d’une bouche d’aération entre toit et mur quand il couvre une grange, soit d’une fenêtre à l’étage quand il couvre une maison d’habitation. »48
- Ornementation
La sculpture se dévoile dans le travail de la pierre et du bois sur les supports suivants : portes et portails. D'après Didier Sorbé, les sujets d'inspiration dépendent du matériau utilisé. L'art populaire (roses, marguerites, soleils, frises et dents de scie...), l'architecture savante (pilastres toscans ou ioniques...) influenceraient les tailleurs de pierre et les maçons, tandis que ce serait la géométrie qui inspirerait les artisans du bois.
Le décor des linteaux s'inspire du répertoire classique : « guirlandes florales, cornes d'abondance, coupes et corbeilles débordant de fruits... L'analyse révèle des séries sous lesquelles se devinent des motifs d'atelier, dont certains sont directement issus des gravures des traités d'architecture. »49
Références :
- Araguas Philippe, Maisons rurales du canton de Garlin, in Cahiers du Vic-Bilh, n°3, juin 1978,p. 20-25)
- Araguas Philippe, Variations autour de l’ostau béarnais du Vic-Bilh et Portrait-robot d’une maison rurale du Vic-Bilh, in Le Festin, n° 31-32, Automne 99, pp. 35-41 et 42-49.
- Pierre Bidart et Gérard Collomb , Pays aquitains, Paris, Berger-Levrault, 1984, coll : L'architecturale rurale en France »
- Cazaurang J.J., Maisons béarnaises, Musée béarnais, Pau, 1978, tome 1.
- Loubergé Jean, La maison rurale, Contribution à un inventaire régional, Edition Créer, 2014.
- Les articles de CAUE 64.
[1] Charte architecturale et paysagère, rubrique : implanter les formes bâties, les fermes, bâti rural dispersé, p. 32.
[2] Jean Loubergé, La maison rurale en BEARN, Les cahiers de construction traditionnelle, Contribution à un inventaire régional, Editions Créer, révision en 2014 par EDICENTRE, p.41.
[3] Charte architecturale et paysagère, tome 1, rubrique : Former les tissus urbains, Les rues de village, leurs variations, p. 42)
[4] Jean-Pierre Dugenne, Les inscriptions et décorations de l’habitat rural ossalois, Edité par Chez l’auteur, 1986, p. 2.
[5] Pierre Bidart et Gérard Collomb , Pays aquitains, Paris, Berger-Levrault, 1984, coll : L'architecturale rurale en France », p. 59.
[6] Abbé Bonnecaze, Variété béarnaises, BULL.SSLA. de Pau, 1910, 2e série, Tome 38, p. 124.
[7] Jean-Pierre Dugenne, Les inscriptions et décorations de l’habitat rural ossalois, Edité par Chez l’auteur, 1986, p. 2.
[8] - J. J. Cazaurang, op.cit., p.40.
[9] Ossau, visages d’une vallée pyrénéenne, CAUE 64, Parc National des Pyrénées, p. 45.
[10] Charte architecturale et paysagère, tome 1, rubrique : implanter les formes bâties, le bâti d’usage agricole, les bordes, p. 34.
[11] J.J. Cazaurang, op.cit., p.38.
[12] Ossau, visages d’une vallée pyrénéenne, op.cit., p. 46.
[13] Jean Loubergé, La maison rurale en BEARN, op.cit., p. 47.
[14] Jean Loubergé, La maison rurale en BEARN, op. cit., p. 49.
[15] Un centre de vie montagnarde dans la Vallée d’Aspe. Le plateau de Lhers, Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, Pierre Dejean, tome 3 , fascicule 4, 1932, p 477-479.
[16] Jean Loubergé, La maison rurale en BEARN, op.cit., p. 53.
[17] Idem., p. 54.
[18] Jean Loubergé, La maison rurale en BEARN, op.cit., p. 69.
[19] Caue 64, L’habitat traditionnel en Oloronais-Jurançonnais, p.3.
[20] Caue 64, L’habitat traditionnel en Oloronais-Jurançonnais, p.3.
[21] Idem., p. 6.
[23] Caue 64, L’habitat traditionnel en Oloronais-Jurançonnais, p.5.
[24] Monique Femenia, L’Arribère, ses villages et leur Histoire, Cercle Historique de l’Arribère, I.C.N., 2021, p. 117.
[25] Idem., p. 305.
[26] Jean Loubergé, op,cit., p. 63.
[27] J.J.Cazaurang, op.cit., tome1, p. 42.
[28] L’habitat traditionnel en Béarn des gaves-Soubestre, CAUE64, p.4.
[29] Jean Loubergé, op,cit., p. 64-65.
[30] L’habitat traditionnel en Béarn des gaves-Soubestre, CAUE64, p.6
[31] Loubergé Jean, Le peuplement et la vie dans les coteaux de Jurançon aux siècles passés, Revue de Pau et du Béarn, n°9, 1981, p. 32.
32- Jean Loubergé, La maison rurale en BEARN, opus,cit., p. 79.
[33] Études historiques et religieuses du Diocèse de Bayonne : comprenant les anciens diocèses de Bayonne, Lescar, Oloron et la partie basque et béarnaise de l'ancien diocèse de Dax / M. l'abbé V. Dubarat, directeur ; M. l'abbé P. Haristoy, fondateur-collaborateur | 1899 | Gallica (bnf.fr), Histoire particulière des villes, bourgs et principaux du Béarn, abbé Bonnecaze, p. 343.
[34] CAUE 64, L’habitat traditionnel en Béarn des gaves-Soubestre, p.3.
[35] Idem., p. 2.
[36] Idem., p. 6.
[37] Jean Loubergé, op,cit., p. 86.
[38] Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Pyrénées-Atlantiques : Vic-Bilh, Morlaàs et Montanérès (cantons de Garlin, Lembeye, Thèze, Morlaàs, Montaner), Direction du patrimoine du ministère de la Culture, de la Communication, des Grands travaux et du Bicentenaire, Collectif, p. 50.
[39] Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Pyrénées-Atlantiques : Vic-Bilh, Morlaàs et Montanérès (cantons de Garlin, Lembeye, Thèze, Morlaàs, Montaner), Direction du patrimoine du ministère de la Culture, de la Communication, des Grands travaux et du Bicentenaire, Collectif, p. 53.
[40] Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Pyrénées-Atlantiques : Vic-Bilh, Morlaàs et Montanérès (cantons de Garlin, Lembeye, Thèze, Morlaàs, Montaner), Direction du patrimoine du ministère de la Culture, de la Communication, des Grands travaux et du Bicentenaire, Collectif, p. 59.
[41] Jean Cazaurang, les maisons béarnaises, op.cit., p 47.
[42] Anglade André, Vic-Bilh, le vieux pays, Editions Gascogne, 2001, p.61-67.
[43] L’habitat traditionnel en Vic-Bilh et Montanérès », CAUE 64.
[44] Jean Loubergé, La maison rurale, op.cit., p. 83-84.
[45] Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Pyrénées-Atlantiques : Vic-Bilh, Morlaàs et Montanérès (cantons de Garlin, Lembeye, Thèze, Morlaàs, Montaner), Direction du patrimoine du ministère de la Culture, de la Communication, des Grands travaux et du Bicentenaire, Collectif, p. 54.
[46] Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Pyrénées-Atlantiques : Vic-Bilh, Morlaàs et Montanérès (cantons de Garlin, Lembeye, Thèze, Morlaàs, Montaner), Direction du patrimoine du ministère de la Culture, de la Communication, des Grands travaux et du Bicentenaire, Collectif, p. 55.
[47] Jean Loubergé, La maison rurale, op. cit., p. 55.
[48] Idem., p. 49.
[49] Jean Loubergé, Villages et maisons rurales dans la vallée moyenne du gave de Pau, Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 29, fascicule 1, 1958, pp. 21-50.
[50] BOUCHÉ Christian, Maisons de Batbielle , Le Festin, n°50, Été 2004, pp. 50-57.
[51] Études historiques et religieuses du Diocèse de Bayonne : comprenant les anciens diocèses de Bayonne, Lescar, Oloron et la partie basque et béarnaise de l'ancien diocèse de Dax / M. l'abbé V. Dubarat, directeur ; M. l'abbé P. Haristoy, fondateur-collaborateur | 1899 | Gallica (bnf.fr), Histoire particulière des villes, bourgs et principaux du Béarn, abbé Bonnecaze, p. 475.
[52] Jean Loubergé, La maison rurale, op. cit., p. 50.
[53] Voyage d’un Bordelais en Béarn et en Labourd (juin-juillet 1765), publié et annoté par Paul Courteault, G. Lescher-Moutoué, Imprimeur, Pau, 1910, p. 14.
-
Par Michel64a le 10 Juillet 2024 à 17:14
Pendant longtemps, la maison traditionnelle rurale pouvait être édifiée par le propriétaire et sa famille aidés par les voisins par esprit de solidarité, surtout dans la campagne. Construire une maison coûtait cher, alors les paysans se procuraient les matériaux qui se trouvaient à proximité, Le plan du bâti était généralement simple, souvent constitué d'une seule pièce multifonctionnelle (faisant office de cuisine, de salle à manger et de chambre) ou de deux pièces. L'édification est rapide, mais elle revêt deux inconvénients, la proximité et l'inconfort auxquelles on peut adjoindre le manque d'hygiène. Si certaines maisons du village apparaissent relativement grandes, la plupart sont petites.
Puis, par la suite, le plan se complexifie, les exigences du commanditaire, liées aux différents styles qui se succèdent, deviennent plus importants. Les artisans, les ouvriers spécialisés sont davantage sollicités.
Le maçon, le tailleur de pierre, le carrier, pour ce qui concerne la construction des murs globalement sont les artisans parmi les plus importants des localités. On persiste à récupérer, pour une question de prix, les matériaux les plus près des lieux des édifications (pierre, galet, sable, chaux, bois…). Mais d'autres corps de métiers sont également sollicités.
Pour l'édification d'une belle bâtisse, le commanditaire (ou maître d'ouvrage, soit le financeur et donneur d'ordre) se doit alors d'organiser le chantier. Il fait appel à un maître d’œuvre (qui coordonne les actions des ouvriers et qui s'assure de la réalisation des travaux) et à un architecte qui mènera les travaux à l'aide d'artisans et d'ouvriers. Si le chantier s’avère peu important, la coordination en revient le plus souvent au maître maçon. Le propriétaire se doit fréquemment d’assurer l’approvisionnement du chantier en matériaux tels le sable, la chaux…
L’Encyclopédie de Diderot précise en ce qui concerne le maçon que son «… principal ouvrage…est de préparer le mortier, d’élever les murailles depuis le fondement jusqu’à la cime, avec les retraites & les à-plombs nécessaires, de former les voûtes, & d’employer les pierres qu’on lui donne. »
A part l’édification d’une maison, les autres tâches sont multiples. Le maçon peut être amené par exemple à dresser des murs de clôture… Le maçon (massou) en Béarn est le « métier le plus représenté dans le village béarnais » 1.
En 1709, les jurats de Monein, réalisant une enquête auprès de chaque maison concernant les grains, rencense plusieurs maçons.2
J.J. Cazaurang rajoute qu’il travaille équipe, assisté souvent par un ou deux compagnons. A qui il faut adjoindre les manœuvres.
Ses outils sont cités dans l’Encyclopédie de Diderot : « …la ligne, la regle, le compas, la toise & le pié, le niveau, l’équerre, le plomb, la hachette, le marteau, le déceintroir, la pince, le ciseau, le riflar, la truelle, la truelle brétée, l’auge, le sceau, le balai, la pelle, le tamis, le panier, le rabot, l’oiseau, la brouette, le bar, la pioche & le pic. »
Le tailleur de pierre, d’après la même encyclopédie, sert à tailler et à couper les pierres. Il est lié au maçon vu qu’à l’époque, il était admis qu’une « pierre taillée d’équerre (cayrou) puisse supporter le monde entier. »1
Le charpentier, outre la mise en place des charpentes, des toitures de bardeaux, peut réaliser à la demande des outils agricoles tels qu'un araire, une vis de pressoir… Les jours d’intempéries sont dévolus souvent à la préparation du chantier qui reprendra lors des beaux jours. Ces travaux consistent, par exemple, à retailler les bois pour lattes…J. J. Cazaurang précise que le samedi était consacré « pour husteya », s’il n’était pas sollicité ailleurs. Alors, cette journée lui permettait de réaliser des petits travaux de bois, des réparations d'outils et autres…3 Le charpentier utilise un établi (banc-bustè) composé d’un étau en bois à large machoire. Artisan, souvent le charpentier aspire aussi à détenir un terrain ce qui explique qu’ils soient alors inscrits dans les registres de la taille.
Quant au menuisier, il réalise les huisseries, les meubles. A la différence du charpentier qui œuvre le plus souvent en équipe et à l’extérieur - soumis aux aléas climatiques - le menuisier travaille seul, à l’intérieur.
A ces métiers cités, on peut ajouter également le cimentier qui mélange le sable et la chaux pour réaliser le mortier ou tout autre liant, le scieur de long qui débite les pièces de bois comme les poutres, les planches. Mais aussi le sculpteur, le forgeron qui confectionne les pièces métalliques comme les gonds des portes... Chaque localité détenait son haure qui travaillait à l’aide d’une enclume (engludi). Par exemple, la localité de Monein recensait plusieurs forgerons, vu la nécessité aussi, dans un milieu agricole, de réparer tous les instruments. Marie-Victoire Duval précise que chaque forge était tenue de payer « un « capliure » comme la maison de leur propriétaire dont ils étaient souvent indépendants ». Elle rajoute que les forgerons détenaient dans la majeure partie « quelques arpents de terre qu’ils devaient cultiver ou faire cultiver ». 4
Les artisans et ses outils
Les outils cités plus haut et nommés par l’Encyclopédie de Diderot sont successivement (certaines illustrations indiquées sont tirées du manuel de Claude-Jacques Toussaint du XIXe vu qu’elles sont absentes dans celle de Diderot)
Auge : « …espece de boîte non couverte, construite de chêne, de forme quarré-longue, dont le fond plus étroit que l’ouverture forme des talus inclinés en-dedans, & donne la facilité à l’ouvrier de ramasser le plâtre qui est gaché dedans, pour l’employer à la main & à la truelle. » (Fig. 138 Encycl. Diderot ; fig. 8 manuel de C-J Toussaint)
Illustration tirée de l'Encyclopédie de Diderot
Illustration tirée de l'encyclopédie du XIXème du Manuel du maçon-plâtrier... de Claude-Jacques Toussaint
Balai : « …en general, instrument destiné principalement à ramasser des ordures éparses, & à en nettoyer les corps ou les lieux… »
Bar : « …espece de civiere avec laquelle des hommes portent des pierres ordinairement de peu de grosseur. Les ouvriers qui portent le bar se nomment bardeurs…Le bar est composé de deux longues pieces de bois équarries & assemblées parallelement par quatre ou six traverses de deux piés de long ou environ. Ces traverses n’occupent que le milieu des pieces équarries, où elles forment un fond ou une grille sur laquelle on pose les fardeaux ; le reste des pieces équarries qui demeure isolé va en diminuant, est arrondi, se termine par une tête formant une coche ou un arrêt en-dessous, & sert de manche ou bras des deux côtés de la grille ou du fond. L’arrêt de la coche retient les bretelles des bardeurs, & les empêche de s’échapper des bras. Quand les poids sont lourds, deux ou quatre maneuvres se mettent aux bras, & deux autres passent encore un levier sous la grille : ces derniers s’appellent arbalétriers. Pour garantir les arrêtes & autres formes délicates des pierres taillées ou sculptées, de l’impression des traverses, on couvre la grille de nattes. Ces nattes s’appellent torches. (Fig. 141 et 142 Encycl. Diderot)
Bretée (truelle) : «… sorte de truelle particuliere qui a des dents, & qui sert aux maçons pour nettoyer le plâtre, lorsque le mur est enduit. »
Brouette : « …petite machine faite en forme de charrette, qui n’a qu’une roue, & que celui qui s’en sert pousse devant soi par le moyen de deux especes de timons soûtenus d’un côté par l’essieu de la roue, & de l’autre par les mains de celui qui conduit la machine, qui pour cet effet se met au milieu. » (Fig. 135 Encycl. Diderot)
Ciseau : « …outil de fer, acéré, long, de la forme d’un clou sans tête, applati & tranchant par le bout. Il sert à commencer le lit ou la taille de la pierre. »
Compas : « …instrument de Mathématique1, dont on se sert pour décrire des cercles & mesurer des lignes, &c….Le compas ordinaire est composé de deux jambes ou branches de laiton, de fer, ou de quelque autre métal, pointues par en-bas, & jointes en-haut par un rivet, sur lequel elles se meuvent comme sur un centre. » (fig. 17 manuel de C-J Toussaint manuel )
Déceintroir : « …espece de marteau à deux taillans tournés diversement, dont les Maçons se servent soit pour équarriser les trous commencés avec le têtu, soit pour écarter les joints des pierres dans les démolitions. »
Equerre : « … instrument fait de bois ou de métal, qui sert à tracer & mesurer des angles droits, comme LEM..Elle est composée de deux regles ou jambes, qui sont jointes ou attachées perpendiculairement sur l’extrémité l’une de l’autre. Quand les deux branches sont mobiles à un point, on l’appelle biveau ou fausse équerre. » (Fig. 5 et 6, manuel de C-J Toussaint )
Hachette : « …instrument à l’usage d’un grand nombre d’ouvriers ; c’est ainsi que le diminutif le désigne une petite hache. Les Charpentiers en ont une à marteau, dont ils se servent pour ajuster des pieces de bois. Les Tonneliers, les Charpentiers, les Couvreurs, les Mâçons ont aussi leur hachette. Les Mâçons se servent d’un des bouts pour équarrier, & de l’autre pour placer le moilon ou la pierre. A la hachette du Mâçon, au lieu de panne, il y a un tranchant large de deux pouces & demi : cet outil s’aciere comme le marteau. »
Ligne : « …petite cordelette ou ficelle, dont ils se servent pour élever les murs droits, à plomb, & de même épaisseur dans leur longueur. » On peut citer aussi la ligne à plomb.
Marteau : « …instrument de fer, de la même forme à-peu-près que les marteaux ordinaires ; il en differe en ce que les pannes ou extrémités de la tête sont brettelées ou dentées. C’est de cet outil dont on se sert pour tailler la pierre ; on le nomme plus communément hache. »
Niveau : « …instrument propre à tirer une ligne parallele à l’horison, & à la continuer à volonté, ce qui sert à trouver la différence de hauteur de deux endroits, lorsqu’il s’agit de conduire de l’eau de l’un à l’autre, de dessécher des marais, &c. ce mot vient du latin libella, verge ou fléau d’une balance, laquelle pour être juste doit se tenir horisontalement. »
Oiseau : « …espece de demi-auget composé de planches légeres, arrondies par une extrémité, & jointes en équerre par l’autre, dont celle d’en-bas est posée horisontalement sur deux morceux de bois en forme de bras assez longs ; & celle d’en-haut est attachée à deux autres petits bâtons, qui tombent d’aplomb sur chacun des bras. C’est sur cette petite machine que de jeunes manœuvres, qu’on nomme goujats, portent sur leurs épaules le mortier aux maçons & limosins, lorsque le service ne se peut faire à la pelle. »
Panier (anse de) : «…arcade est faite en anse de panier, lorsque le dessus est un peu abaissé, & qu’elle n’est pas faite en plein ceintre, c’est-à-dire qu’elle est en demi-ellipse sur le grand diametre. »
Palette un peu creusée en-dedans, & convexe en-dehors pour la facilité du service. »
Pelle : « …instrument de bois, propre à divers artisans & ouvriers…La pelle des mâçons, paveurs, jardiniers & autres tels artisans & manouvriers, a le manche rond & la palette un peu creusée en-dedans, & convexe en-dehors pour la facilité du service. (Fig. 132 Encycl. Diderot)
Pic : « …instrument de fer un peu courbé, pointu, & acéré, avec un long manche de bois qui sert aux mâçons & terrassiers à ouvrir la terre, ou à démolir les vieux bâtimens. Les Carriers s’en servent aussi pour déraciner & découvrir les pierres dont ils veulent trouver le blanc. Cet outil ne differe de la pioche pointue, qu’en ce que le fer en est plus long, plus fort, & mieux acéré » (Fig. 7 manuel de C-J Toussaint )
Pié : « …mesure prise sur la longueur du pié humain, qui est différent selon les lieux. On appelle aussi pié un instrument en forme de petite regle, qui a la longueur de cette mesure, & sur laquelle ses parties sont gravées. »
Pince : « … gros levier de fer rond, de quatre piés de long & de deux piés de diametre,coupé d’un côté en biseau, pour lui donner plus de prise & d’entrée dans les joints des pierres, ou autres matieres, qu’il sert à remuer, à disjoindre, & à démolir. Il y a aussi des petites pinces qui servent seulement à mettre en place des ouvrages de menuiserie, de charpente, ou ceux des marbriers & des tailleurs de pierre. Les pinces qu’on appelle piés de chevres, sont courbées & refendues par le bout ; en sorte qu’elles ont assez la figure du pié de l’animal dont elles ont pris le nom. Plusieurs ouvriers se servent de la pince, entr’autres les mâçons, charpentiers, paveurs, tailleurs de pierre, carriers, &c. »
Pioche : « …outil de fer avec un long manche de bois qui sert aux Terrassiers, Carriers & Maçons, pour remuer la terre, tirer des pierres, sapper, démolir, &c. Il y en a de plusieurs sortes : les unes dont le fer a deux côtés, comme un marteau, & un œil au milieu pour l’emmancher ; chaque extrémité de cette pioche est pointue. D’autres sortes de pioches s’emmanchent par le bout du fer : toutes deux sont un peu courbes ; mais l’une est pointue comme le pic, & l’autre qu’on nomme feuille de sauge, a le bout large & tranchant. »
Plomb (ligne à): « …se dit en terme d’ouvrier, d’une ligne perpendiculaire, il l’appelle ainsi, parce qu’il la trace ordinairement par le moyen d’un plomb…Les mâçons & limosins appellent lignes, une petite cordelette ou ficelle, dont ils se servent pour élever les murs droits, à plomb, & de même épaisseur dans leur longueur. (Fig. 120 Encycl. Diderot ; fig. 13 manuel de C-J Toussaint )
Rabot : « … instrument dont se servent les Maçons, Limousins, Paveurs, &c. pour éteindre la chaux, & pour la courroyer avec le ciment ou le sable qu’ils emploient au lieu de plâtre dans plusieurs de leurs ouvrages ; c’est un billot de bois de huit à dix pouces de longueur & de deux ou trois pouces de grosseur, emmanché par le milieu d’une longue perche. »
Règle (à mouchette) : « …. mouchette, terme de Maçon, c’est une longue regle de bois, le long de l’un des côtés de laquelle est poussée avec le rabot, une espece de moulure. Elle sert aux maçons à faire des mouchettes, c’est-à-dire, cette espece de quart de rond enfoncé, qui est au-dessous d’une plinthe. Outre cette regle, ces ouvriers en ont plusieurs autres de diverseslongueurs & épaisseurs. Celles qui servent à faire les feuillures des portes, des croisées, ont un pouce & demi d’équarrissage ; celles qu’ils emploient à prendre leur niveau, sont les plus longues de toutes. Ils ont aussi ce qu’ils appellent un plomb à regle, qui est une ficelle chargée d’un petit plomb par un des bouts, & attachée par l’autre au haut d’une regle, sur laquelle est tracée une ligne perpendiculaire. Savary. (D. J.)
Riflard : « …morceau de fer en forme de ciseau, très-large par en-bas, & un peu rabattu en chamfrein, il a des dents, ce qui fait qu’on l’appelle communément riflard breté ; son manche est de bois, & il se pousse à la main, il y en a de plusieurs grandeurs.
Sceau (ou seau) : « en terme de Boisselier1 ; ustensile de ménage ; c’est un vaisseau fait de bois appellé merin, relié de cercle de fer ordinairement, & servant à puiser de l’eau, & à la conserver quelquefois dans les maisons. »
Toise : « …mesure de différente grandeur, selon les lieux ou elle est en usage ; celle de Paris, dont on fait usage en quelques autres villes du royaume, est de six piés de roi. Son étalon ou mesure originale est au châtelet de Paris ; c’est pourquoi on l’appelle toise du châtelet. On donne aussi le nom de toise à l’instrument avec lequel on mesure. Selon M. Ménage, le mot toise vient du latin tesa, dérivé de tensus, étendu. »
Truelle : « …outil de fer poli, ou de cuivre, emmanché dans une poignée de bois, qui sert à un maçon pour rendre unis les enduits de plâtre frais, & à prendre le mortier dans le baquet. Il y a des truelles triangulaires, dont deux côtés sont tranchans pour grater & nettoyer les enduits de plâtre au sas, & dont l’autre côté est breté ou brételé, c’est-à-dire a de petites hoches en maniere de scie, pour faire des brétures, gravures, ou raies qui imitent celles de la pierre de taille en badigeonnant. » (Fig. 125 à 127 Encycl. Diderot ; fig. 1 et 2 manuel de C-J Toussaint )
L’outil, le tamis n’est pas défini par l’Encyclopédie de Diderot. Le Dictionnaire de l’Académie Française (3e édition, datée de 1740) mentionne que le tamis est une : « …Espèce de sas qui sert à passer des matières pulvérisées, ou des liqueurs épaisses. Tamis fin, délié. Gros tamis. Passer au tamis, par le tamis. »
De la liste dressée plus haut, on peut ajouter aussi ces mots : le maillet, la houe, la hotte et le têtu.
Si on se réfère encore à l’Encyclopédie de Diderot, cette dernière définit successivement.
Hotte : « …panier d’osier, ou même de bois, étroit par en bas, large par en haut, qu’on fixe sur les épaules avec des bretelles où les bras sont passés, & qui sert à porter différentes choses. Le côté qui touche aux épaules est plat ; l’autre est arrondi. Cet instrument sert aux jardiniers, aux fruitiers, aux vendangeurs. Il y en a de serrées qu’on appelle batais ; il y en a d’ardoisées, de gauderonnées, de poissées, selon les différens usages auxquels elles sont destinées. » (Fig. 134 Encycl. Diderot)
Houe : « …instrument dont on se sert pour labourer les vignes & les terres lorsqu’on ne peut employer la charrue. » Définition vague que l’on peut préciser en ajoutant celle donnée par l’Encyclopédie de l’Académie française (édition 1740) : « Instrument de fer large & recourbé, qui a un manche de bois, & avec lequel on remue la terre en la tirant vers soi. » (Fig. 121 à 123 Encycl. Diderot)
Maillet : « …espece de gros marteau de bois fort en usage parmi les artisans qui travaillent au ciseau ; les Sculpteurs, Maçons, Tailleurs de pierres & Marbriers s’en servent ; il est ordinairement de forme ronde ; ceux des Charpentiers, Menuisiers, sont de forme quarrée. » (fig. 112 Encycl. Diderot)
Têtu : outil de maçon qui sert à démolir les anciens ouvrages de maçonnerie. C’est une espece de gros marteau, dont la tête qui est fort large par un bout, se termine en pointe par l’au-tre extrémité ; le manche qui est de bois est long & fort à proportion, ordinairement de plus de vingt pouces de longueur. Le têtu à arrête, qui sert aussi aux maçons pour la démolition des bâtimens, est propre à briser & rompre les pierres qui sont trop dures, & qui resistent au têtu commun ; c’est une espece de masse de fer, dont les deux bouts, qui chacun se séparent en deux coins, en forme de dents, sont tranchans & fort acerés; il n’a guere que huit à dix pouces de longueur, mais il est fort épais ; son manche est plus long qu’au têtu ordinaire, pour lui donner plus de coup. Le têtu à limosin, qu’on nomme aussi un gurlet, tient des deux têtus dont on vient de parler ; il a la tête fendue d’un côté, comme le têtu à arrête, & est pointu de l’autre, comme le têtu commun. (D. J.) (Fig. 3 manuel de C-J Toussaint )
Claude Jacques Toussaint rajoute d’autres outils utilisés par les maçons : boulins, écoperches, cables, cableaux, cordages, vingtaines, grues, cabestans, moufles, poulies, diables, camions, pinces, poinçons, masses, bouchardes. 5
L’Encyclopédie de Diderot définit les mots suivants :
Boulin : « pieces de bois posées horisontalement & scellées par un bout dans les murs, & par l’autre bout attachées avec des cordages à d’autres pieces de bois posées à plomb, sur lesquelles on met des planches pour échafauder une face de bâtiment. Nous appellons en François trous de boulins, les trous qui restent des échaffaudages, & Vitruve les nomme columbaria. »
Camion : « c’est une espece de petite voiture ou petit haquet, monté sur quatre petites roues, faites d’un seul morceau de bois chacune, sur laquelle on traine des fardeaux pesans & difficiles à manier. Le camion est à l’usage de plusieurs ouvriers. »
Ecoperche : « piece de bois avec une poulie qu’on ajoûte au bec d’une grue ou d’un engin, pour lui donner plus de volée. On nomme aussi écoperche toutes pieces de bois de brin qui servent à porter les échafauts. Les plus petites écoperches se nomment boulins. »
Grue : « Machine en usage dans la construction des bâtimens, pour élever des pierres & autres grands fardeaux. M. Perrault dans ses notes sur Vitruve, prétend que la grue est le corbeau des anciens. La grue des modernes est composée de plusieurs pieces, dont la principale est un arbre élevé perpendiculairement, & terminé en poinçon par le haut : cet arbre est garni par le milieu de huit pieces de bois posées en croix, & soûtenu de huit bras ou liens en contre-fiche, qui s’assemblent vers le haut de l’arbre, & y sont joints avec tenon & mortoise. La piece de bois qui porte & qui sert à élever les fardeaux, s’appelle échelier ou rancher ; elle est garnie de chevilles ou ranches, & posée sur un pivot de fer qui est au bout du poinçon de l’arbre : il est assemblé avec plusieurs moises à des liens montans. Il y a des pieces de bois que l’on nomme soûpentes, attachées à la grande moise d’en-bas & à l’échelier, & qui servent à porter la roue & le treuil, autour duquel se devide le cable. Le cable passe dans des poulies qui sont au bout des moises, & à l’extrémité de l’échelier. Tout le corps de la grue, c’est-à-dire, l’échelier, les moises, les liens montans, les soûpentes, la roue & le treuil, tourne sur le pivot autour de l’arbre pour placer les fardeaux où l’on veut. Chambers. A proprement parler, la grue est un composé du treuil & de la poulie : ainsi pour connoître l’effet de cette machine & sa force, il ne faut qu’y appliquer ce que nous dirons de ces deux machines. »
Moufle : « barres de fer à l’extrémité desquelles on a pratiqué des yeux. On contient ces barres par des clavettes qui passent dans les yeux. Les pieces auxquelles on applique des mouffles sont contenues dans l’état qu’on leur veut. C’est par cette raison qu’on moufle les cuves, & les murs, lorsqu’ils tendent à s’écarter. Il faut distinguer trois parties dans la moufle double, deux yeux l’un au-dessus de l’autre, entre lesquels il y a un espace suffisant pour recevoir l’autre extrémité de la moufle, qui est par cette raison en fourche ; la partie qui n’a qu’un œil & qui se place dans la fourche, & la clavette qui lie le tout & forme la moufle complette. Pour faire une moufle on prend une barre de fer plat que l’on coupe de la longueur convenable ; on la fend où l’ouvrier pratique l’œil ; on plie la partie fendue en deux, & l’on soude le bout plié avec le reste de la barre, observant de donner à l’œil autant d’espace qu’en exige la clavette, & d’ouvrir la fourche assez pour recevoir l’autre partie de la moufle. Cela fait, on prend une autre barre, on l’étrécit par le bout ; on lui donne, en l’étrécissant, la figure qui convient à l’ouverture de la moufle ; on place cette partie comme la premiere ; on la soude avec la premiere barre : cela fait on forge la clavette, & la moufle est finie. »
Pince : « gros levier de fer rond, de quatre piés de long & de deux piés de diametre,coupé d’un côté en biseau, pour lui donner plus de prise & d’entrée dans les joints des pierres, ou autres matieres, qu’il sert à remuer, à disjoindre, & à démolir. Il y a aussi des petites pinces qui servent seulement à mettre en place des ouvrages de menuiserie, de charpente, ou ceux des marbriers & des tailleurs de pierre. Les pinces qu’on appelle piés de chevres, sont courbées & refendues par le bout ; en sorte qu’elles ont assez la figure du pié de l’animal dont elles ont pris le nom. Plusieurs ouvriers se servent de la pince, entr’autres les mâçons, charpentiers, paveurs, tailleurs de pierre, carriers, &c. Ce sont les taillandiers qui font & qui vendent les pinces, quand elles sont grosses ; les petites se font par les serruriers : il s’en trouve aussi dans les boutiques de quincailliers. »
Poulie : « est une des cinq principales machines dont on traite dans la Statique. Elle consiste en une petite roue, qui est creusée dans sa circonférence, & qui tourne autour d’un clou ou axe placé à son centre ; on s’en sert pour élever des poids par le moyen d’une corde, qu’on place & qu’on fait glisser dans la rainure de la circonférence… l’usage de la poulie est principalement de changer une direction verticale en horizontale, ou une direction qui devroit être de bas en haut, en une direction de haut en bas ; & réciproquement. »
Vingtaine : « Les Maçons appellent ainsi un petit cordage qui sert à conduire les pierres qu’ils élevent avec des engins pour mettre sur le tas. Il est attaché à la pierre ; & lorsqu’on tire le gros cable, un ouvrier tient le bout de la vingtaine pour l’éloigner des échaffauds & des murailles, & pour qu’il se pose juste sur l’endroit où il est destiné. »
Référence:
1- J.J. Cazaurang, Pasteurs et paysans béarnais, au village, les métiers, éditions Cairn, 2002, p. 85.
2- Archives communales de Monein, HH1.
3- J.J. Cazaurang, Pasteurs et paysans béarnais, au village, les métiers, éditions Cairn, 2002, p. 68.
4- Marie-Victoire Duval, Monein, une communauté du Béarn au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, SAI – BIARRITZ, 1991, p. 219.
Bibliographie :
Claude-Jacques Toussaint : Manuel du maçon-plâtrier, du carreleur, du couvreur et du paveur - , A la librairie encyclopédique de Roret , Paris, 1834.
-
Par Michel64a le 10 Juillet 2024 à 17:03
La couverture
L’Encyclopédie de Diderot décrit la couverture comme suit :
« la partie extérieure d’un bâtiment la plus élevée, qui défend toutes les intérieures des injures de l’air, & qui est soutenue de tout côté sur des bois appuyés d’un bout sur les murs de la maison, & de l’autre aux arc-boutés ou assemblés, soit ensemble soit avec d’autres bois qui font partie de la charpente. On couvre les maisons ou de plomb, ou d’ardoise, ou de tuile, ou de bardeau, ou de chaume. Plus la matiere est pesante, plus le toit doit être bas ; pour l’ardoise, on peut donner au toit une hauteur égale à sa largeur. Pour la tuile, la hauteur n’en peut être que les deux tiers ou tout au plus les trois quarts de la largeur. S’il y a des croupes ou boîtes de toit qui ne soient point bâties en pignon, mais couvertes en penchant comme le reste du comble, il faut tenir ces croupes plus droites que les autres couvertures. Autrefois on ne faisoit que des couvertures droites, hautes, & boîtes de toit qui ne soient point bâties en pignon, mais couvertes en penchant comme le reste du comble, il faut tenir ces croupes plus droites que les autres couvertures. Autrefois on ne faisoit que des couvertures droites, hautes, & n’ayant de chaque côté qu’une pente terminée en pointe au comble. Ces toits avoient des avantages, mais ils occasionnoient trop de dépense en tuile, en ardoise, en charpente, &c. & ils renfermoient trop peu d’espace ; on les a donc abandonnés pour les mansardes. Le toiser de la couverture n’a rien de difficile, les dimensions étant données ; mais il est quelquefois dangereux de les prendre sur le toit. Quand on les a, il faut supposer la couverture plane, & ajoûter au produit pour le battelement un pié quarré ; pour la pente un pié quarré ; pour le posement de gouttiereun pié quarré ; pour une vûe de faîture six piés ; pour un œil de bœuf commun dix-huit piés ; pour les lucarnes, demi-toise ou toise, selon leur forme. Il n’est pas difficile de savoir ce qu’il doit entrer d’ardoise ou de tuile dans une couverture, les dimensions de l’ardoise étant données, l’étendue de la couverture, & la quantité de pureau ; ce qu’on a toûjours. On appelle couverture à la mi-voie, celle où l’on a tenu les tuiles moins serrées que dans la couverture ordinaire. Cette maniere de couvrir convient à tous les atteliers où il faut ménager une issue à la fumée ou à des vapeurs incommodes ou nuisibles. »
Le Béarn, baigné par le climat océanique, est couvert par des toitures en fortes pentes afin d’éviter les infiltrations qui pourraient mettre à mal la charpente. Les faibles pentes, dans les zones montagneuses françaises, répondent à la recherche d’une certaine isolation de type thermique procurée par la neige par les habitants.
On a voulu expliquer les toitures aiguës en Béarn par le souci de se préserver des risques liés à la neige (poids…). Or, les chutes de neige sont moins nombreuses sur la plaine, les régions du Vic-Bihl et du Saubestre… Il est à noter que les pentes les plus fortes des toitures en Béarn se localisent dans la zone géographique d’Orthez où les précipitations neigeuses sont moins conséquentes que dans les vallées montagnardes. Plusieurs facteurs sont invoqués par J. Loubergé : l’importance de la romanisation, « la plus ou moins longue durée des couvertures de chaume, qui imposaient une forte pente…, la puissance plus ou moins grande de la végétation forestière donnant des fûts et des branches maîtresses de grande taille pour une charpente en hauteur…, la forte influence que les populations montagnardes ont exercée sur la plaine, grâce aux voies de transhumance qu’elles contrôlaient, et aussi l’unité politique très forte de la vicomté… » [1]
Les différents terroirs qui composent le Béarn sont différenciés par leurs particularités tant au niveau architectural qu’au niveau de la couverture plus spécifiquement. Les milieux, les faire valoir, les innovations et les modes sont importants pour comprendre la toiture et, notamment, la charpente. Sa lecture est éloquente pour la période qui nous intéresse, plus particulièrement. Au XVIIème, la charpente à « chevron-portant-fermes est courante », tandis qu’au XVIIIème la « jambe de force fait son apparition ». [2]
Dans le même ouvrage, il est écrit que la figure qui domine dans le Béarn est le rectangle, à l’opposé du Pays Basque où c’est le carré. Pour le rectangle, des avantages lui sont liés : « un linéaire de fondations et de murs porteurs plus économiques…, sa capacité à introduire plus facilement la lumière naturelle à l’intérieur du bâti. »
Abordons la toiture constituée de matériaux d’origine végétale tels la paille, le bardeau de bois. A l’époque, en France, ce sont les matériaux les plus utilisés. Ce sont des produits issus de l’agriculture en majorité, donc financièrement peu couteux.
1) Pour ce qui concerne la couverture de paille, appelée le chaume, un voyageur bordelais, en juin-juillet 1765, nous a laissé une description dressée à Lestelle. « On commence cette sorte de couverture par le bas de la charpente… et la paille est coupée au ras si ras dans cette partie qu’un de ses tuyaux ne passe l’autre. Cette première rangée est à demi recouverte par une seconde et de même jusqu’au faite, où la paille, bien saisie par une de ses extrémités et formant une petite gerbe, est partagée sur l’un et l’autre côté de la charpente et sert à recouvrir les petits faisceaux de la couche inférieure ? cette sorte de couvertures à toute épreuve préservent l’intérieur des maisons non seulement de la pluie, mais de toutes les influences même de l’air extérieur. » [3]
Techniquement, globalement, on « procédait par cousudes (bandes larges de 50 cm à peu près). Les liens étaient enchaînées les uns aux autres, que l’on alignait en en frappant l’extrémité à l’aide d’un tassoir de bois… tenu de la main droite. On réalisait sur une grange d’une quinzaine de mètres de long 2 à 3 cousudes par jour. Les liens étaient en paille de seigle, le reste parfois en paille de blé, coupée à la faucille et battue à la main sur une table de manière à la conserver intacte sur la plus grande longueur possible. La paille était ensuite peignée.» [4]
Pierre Bidart et Gérard Collomb, pour leur part, précisent que « les bottes sont posées sur un lattis peu serré, avec un faible recouvrement des bottes entre-elles; chaque rang est maintenu plaqué contre le lattis par de longues perches courantes, placées dans un plan parallèle aux lattes, et fixées à celles-ci par des chevilles de bois, ou par un fil de fer attaché aux chevrons de rive. Le faîtage est également en paille, repliée à cheval sur les deux versants et maintenue par deux perches longitudinales liées ensemble par des chevilles ou des liens... la couverture en chaume est associée fréquemment à une forme particulière donnée aux murs pignons : leur partie supérieure non couverte par le toit à redent, chacun supportant une large ardoise ou une pierre plate qui protège la maçonnerie des eaux. Une des fonctions de ces pignons à redent semble être de protéger les rives du toit de chaume contre le vent, le débordement des ardoises couvrant les gradins assurant l'étanchéité du point de contact entre la couverture et la maçonnerie. » [5]
Historiquement, les cultures céréalières ont été adoptées dès l’époque néolithique et ceci notamment dans les plaines. Rappelons, qu’aux alentours de 10 000 ans, le paysage se modifie du fait des modifications climatiques. En Béarn, à partir de 4 000 AVJC les hommes alors cultivent, par conséquent, des cultures céréalières panifiables (avec des outils de pierre polie, ils défrichent) et pratiquent l’élevage, comme par exemples le mouton, le cheval, le bœuf, le porc…, le chien qu’il utilise pour l’aider à surveiller le troupeau. L’homme devient progressivement sédentaire et quitte son état de nomade. Il organise l’espace dans lequel il vit à l’aide des camps et des villages qu’il édifie. L’archéologie a mis au jour des restes de villages fortifiés comme à Bougarber, Asson.
En France, la paille de seigle est le matériau le plus usité. Cette couverture peut durer une vingtaine d’années (Duhamel du Monceau mentionne 12 ou 15 ans « sans avoir de réparations considérables ») et permet une isolation correcte contre le froid et la chaleur, de plus elle protège bien des précipitations. Selon Duhamel du Monceau, elle a l’avantage « d’épargner beaucoup sur la dépense de la charpente ». D’autres qualités sont à adjoindre à cette description, sa souplesse, sa flexibilité, sa longueur. La pente de la couverture est très raide ce qui évite le danger de la stagnation et de l’infiltration des eaux de pluie. Lorsque l’herbe et la mousse apparaissent, il est temps de réparer ; cela se nomme le « manteau ». Cela consiste à remplacer le chaume abîmé par du neuf. Le même auteur écrit qu’elle ne convient point pour les fermes car elles sont trop sujettes alors aux incendies et aux dégradations provoquées par les volailles, les pigeons, les fouines, les rats. Enfin, il cite des chiffres : « Quand les paysans ramassent eux-mêmes le chaume, il ne leur en coûte que la moitié du prix ordinaire pour le faire employer par les Couvreurs ; en conséquence, si l’on paye à ceux-ci 14 livres par millier, il ne leur en coûte alors que 7 livres. » [6]
Il est à noter que dans les zones climatiques océaniques, on utilisait aussi du genêt ou de la bruyère.
La couverture de chaume ne couvre pas seulement la campagne, on la trouve également dans la ville, bien que les autorités aient cherché, en ce qui la concerne, à limiter son usage. A Lille, les échevins prennent la décision, en 1527, de le prohiber. Mais comme elle n’est guère trop bien suivie, on émettra deux bans en 1566 et 1569. A Jarnages, dans la Creuze, il faut attendre 1785 pour que le Parlement royal interdise l’utilisation de la paille.
Le risque d’incendie est plus important en ville qu’à la campagne. Il y avait d'autres inconvénients. Outre le fait que l'alternance d'été sec et d'hiver humide faisait pourrir le chaume, ce dernier se révélait être un nid à frelons, de souris...
Pour information, voici ce que l’Encyclopédie de Diderot décrit au sujet de la couverture des toits en chaume :
« A la campagne, on couvre de chaume ou de paille de seigle non battue au fleau : après que les faîtes & soûfaîtes sont posés, on y attache avec des gros osiers ou des baguettes de coudriers &c… de grandes perches de chêne, à trois piés de distance ; on lie ces perches avec de plus petites qu’on met en-travers, & l’on applique là-dessus le chaume ou la paille qu’on fixe avec de bons liens. Plus ces liens sont serrés & le chaume pressé & égal, mieux la couverture est faite. Il y a des couvertures de jonc & de roseaux. Quelquefois on gache la paille avec de la terre & du mortier. »
Les toits de chaume sont réalisés le plus souvent par des paysans et non des artisans. Ils ont acquis de l’expérience.
2) Autre matériau organique, le bois, celui-ci est façonné pour réaliser des planchettes qu’on nomme bardeau (arretge).
Il présente plusieurs avantages, son poids relativement léger pour le transport et la pression exercée sur la charpente, sa bonne isolation.
Duhamel du Monceau précise qu’elles sont 12 à 14 pouces de longueur et que leur largeur « varie ». Si elles ont été « fendues dans les forêts, on les fait dresser & réduire à 4 ou 5 lignes d’épaisseur par des Tonneliers, qui se servent pour cela d’une doloire ; on fait aussi du bardeau avec des douves de vieilles futailles : quand le bardeau a été ainsi travaillé, les Couvreurs l’emploient ; ils le clouent sur la latte comme l’ardoise. Mais pour tailler proprement le bardeau & le mettre de largeur, les Couvreurs se servent d’une hachette, ils le percent avec une vrille pour y placer le clou, sans quoi le bardeau pourrait se fendre; ces petites planches s’emploient de la même maniere que les ardoises, & font une couverture très-propre… le bardeau résiste mieux aux coups de vent que l’ardoise ; mais l’eau s’amasse contre le re couvrement, & fait pourrir le bardeau assez promptement, à moins qu’il ne soit fait de cœur de chêne de la meilleur qualité : la légèreté de son poids est un des principaux avantages de cette couverture. » [7]
D’autres théoriciens du XVIIIe siècle affirment que le chaume est plus dangereux que le bardeau en ce qui concerne les incendies.
Pour sa conception, on peut ajouter que le couvreur fend habituellement une bille de bois (chêne, châtaignier ou sapin selon les zones) d’un mètre en quatre quartiers, soit avec des coins soit avec un départoir, eux-mêmes découpés en trois ou quatre quartiers en épaisseurs de 15 à 18 mn, toujours avec un départoir sur une bille de bois. La réalisation de 100 bardeaux - l’équivalent d’un mètre carré - peut s’effectuer en 4 heures. Attention à ne pas respecter le fil du bois ou à laisser des nœuds ! Moisissure, humidité pourront raccourcir la durée de la toiture. Le bardeau peut-être retourné, ce qui accroît sa longévité. On peut l’utiliser sur toutes sortes de toiture puisqu’il s’adapte parfaitement (dôme, clocher…). Sa couleur gris-argent n’est pas désagréable à l’œil, il résiste à la grêle. En ce qui concerne leur pose, on dispose les bardeaux à joints croisés, pour un toit de 45° le recouvrement se fait des deux tiers généralement.
Toutefois, l’incendie reste le danger primordial. L’historien Nicolas de Bordenave nous a laissé un témoignage de l’incendie qui ravagea sa ville résidentielle, Nay, le 14 mai 1543. Il précise que les « batimens qui estoient faits de bois de sapins et couverts de bardeau de fau » (hêtre, de fagus), ce qui explique que le lendemain, après trois heures d’embrasement, il ne reste de la localité et de ses faubourgs que « charbon,, brasier ne cendres ». En ce qui concerne l’origine, il écrit : « Bodin a voulu rendre quelque chose naturelle de ce feu ; quelques autres ont escrit qu’il estoit provenu du ciel, mais il est certain qu’un petit garçon, qui encores aujourdhuy vivant, par inadvertance, comme il cerchoit un esteuf sous le lict, y mit feu avec une chandelle… »[8]
J.J. Cazaurang, étudiant les lattis des couvertures, des treillis du poulailler, note que l’on les confectionne « avec des gaules refendues du châtaignier. En montagne, on utilisait le hêtre… ». [9]
L’usage des bardeaux est attesté encore dans la couverture de moulins dans le Vic-Bihl et même sur l’église de Sainte-Foy de Morlaàs. En effet, le registre de délibérations de la cité mentionne, le 4 octobre 1787, que la toiture du bâtiment est encore couverte de bardeaux. A Sendets, en 1779, pour réparer la toiture du presbytère, un devis marque qu’il est nécessaire d’acheter 8 000 bardeaux à 16 livres les mille.
3) Les causes de l’abandon du chaume et du bardeau, alors dominants avant le XVIIIe siècle.
J. Cazaurang [10] émet une hypothèse pour expliquer les améliorations : ce serait par le biais du matériau des murs. Notamment par l’usage des cailloux roulés dans les vallées comportant des terrasses alluviales qui offraient à « bon compte » les éléments de construction. Il l’explique par la généralisation d’un progrès technique, la chaux hydraulique « qui permet d’obtenir le mortier de qualité nécessaire ». Il rajoute que les bardeaux et le chaume seront encore utilisés jusqu’au début du XIXe siècle. En effet, si dans le « Mémorial Béarnais ou feuille d’annonces du département des Basses-Pyrénées » du vendredi 8 janvier 1819 (supplément du vendredi 25 décembre 1818), nous possédons une description d’un ensemble de bâtiments mis en vente à Pau et se localisant «rue Marca et Tigny », démontrant une preuve de l’évolution. Les corps de logis sont alors constitués de « murs de pierre chaux et sable, et couverts d’ardoises ».[11] D’un autre côté, à Moumy, une saisie fait état « D’une maison bâtie à chaux et sable , couverte le devant en bardeaux, le derrière en tuiles, bardeaux et chaume, et le faîte en tuiles, dans laquelle il y a four, au dessous duquel est une petite loge pour les oies. Une grange construite à chaux et sable et en torchis, couverte en chaume et le faîte en tuiles. »[12] Ceci montre la mixité des matériaux utilisés. Mais il existe encore des maisons couvertes de bardeaux comme celle qui a été saisie à Lucq : « Une maison construite avec des murs à chaux et sable, couverte de bardeaux… » [13]
Ces bardeaux et la paille seront supplantés par l’ardoise et la tuile. Le même auteur attribue cette évolution à plusieurs causes : la hausse du niveau de vie, « la facilité accrue des communications et charrois » permettant aussi de baisser le nombre des incendies.
En règle générale, dans les zones montagneuses et les régions de forêts, on use davantage de bardeaux. Les toits d’ardoise sont majoritaires dans les vallées montagneuses, tandis que les tuiles plates dominent surtout dans les régions de Soumoulou, Lescar et Navarrenx (Vic-Bilh, ribeyres et coteaux).
4) Ardoise
Le passage entre les couvertures organiques et les couvertures minérales se réalise progressivement. Le remplacement du chaume par l'ardoise s'est réalisé en conservant la majeure partie de la charpente existante. Néanmoins, comme l'écrivent Pierre Bidard et Gérard Collomb, on a reconstruit « une charpente à pannes sur pignons, avec une ou deux fermes intermédiaires, qui recouvre la partie supérieure du mur pignon que le chaume laissait à découvert. » [14]
L’ardoise est synonyme de couverture dite « noble », puisqu’elle se trouve plutôt sur les châteaux, les églises… surtout couvrant les clochers, les tours rondes. A ne pas la confondre avec la lauze de schiste. L’ardoise apparaît moins épaisse. Elle se présente comme un schiste argileux résistant, constitué de plusieurs couches.
L’ardoise (ou lauze) provient des Pyrénées (vallée d’Ossau à Geteu, Gère-Balesten, Louvie-Soubiron, Eaux-Bonnes, vallée d’Aspe à Bedous). De longueur irrégulière, d’une épaisseur atteignant parfois 1 cm, ce qui la rendait robuste, le m2 supporte une vingtaine de kgs.
La dimension des ardoises se définit par l’écartement de la base aux trous d’attache. Une numérotation s’établissait alors de 4 à 8 pouces.
Elle prédomine au sud d’une ligne délimitée par les localités de Thèze et de Lembeye. Le couvreur, avant la pose, se sert d’un gabarit nommé « escantilh » en bois qu’il a lui-même fabriqué souvent. Les parties trop longues sont retaillées à l’aide d’un marteau comportant une tête pour enfoncer les clous ou pointeaux et un tranchant (l’assette) et de l’enclume de couvreur. La pose se fait selon un ordre particulier : on débute par le bas en disposant de grandes ardoises (pour éviter le glissement de la charge neigeuse) et on finit par de petites sur le haut. Elles se chevauchent sur un tiers de leur hauteur, ceci afin de garder l’étanchéité. Par contre, on remet de grandes ardoises sur le faîte, la « cérimane » pour permettre d’éviter l’arrachement par leur poids. Si le chaume a une espérance de vie de 50 ans, l’ardoise peut durer jusqu’à 80 ans, voire 100 ans. Leur résistance est démontrée lors des orages, de la chute de la grêle et, même, lors des gels, vu leur porosité moindre.
Ces ardoises sont fixées par des chevilles de bois (chêne, buis, sapin, acacia).
L’ardoise couvre surtout le sud de la province. Elle s’imposera davantage au XIXe siècle et remplacera, de ce fait, les couvertures en bardeau ou en chaume. On avance, pour cela, deux causes majeures. La première, l’usage d’un matériau réputé et, l’autre, la pression exercée par les assurances en fixant des contrats plus onéreux vu le risque plus important d’incendie.
Duhamel du Monceau fait l’éloge de ce matériau. Les ardoises seraient « impénétrables à la pluie, & elles durent plus long-temps. Elles ont encore l’avantage de ne point charger les charpentes… ». Par contre, il mentionne les inconvénients : « les grands vents les soulèvent quelquefois, & même qu’ils les emportent, sur-tout quand on emploie de l’ardoise trop mince, ou de mauvaise qualité ; car il y en a telle qui s’attendrit à la pluie, & qui pourrit sur les bâtiments. »[15]
Son prix est bien entendu plus abordable si une carrière se trouve à proximité, on peut alors les choisir plus épaisses qui « durent autant que les charpentes sur lesquelles elles sont posées » lorsqu’elles sont « bien employées ». Le même auteur prévient qu’il ne faut point utiliser des ardoises trop fines, car « elles ne résistent point au clou quand le vent les soulève ; d’ailleurs elles se rompent, parce qu’elles n’ont pas assez de consistance pour résister au poids des échelles, ou des cordes nouées du Couvreur. » Il précise qu’il est nécessaire d’avoir trois cent dix-huit ardoises pour obtenir une toise (1,949 m).
Avant de couvrir la charpente, le couvreur se doit de donner à l’ardoise une forme plus régulière en utilisant un billot de bois, une enclume et un marteau. Cette enclume est transportée avec lui sur la charpente s’il doit retailler l’ardoise, pour cela, il la cale sur un chevron. Le trou qui permet d’introduire le clou se réalise par le biais du marteau. Pour la pose, Duhamel du Monceau décrit les mouvements du Couvreur, « … on met toujours en dessus la face de l’ardoise où la coupe est en chanfrein & égrignotée ; on les attache à la latte avec deux ou trois clous, dont les têtes doivent être recouvertes par les ardoises supérieures ; & que pour les files soient régulièrement droites, on fait à chaque rang un trait avec un cordeau pour marquer l’endroit où les ardoises doivent aboutir ; & quand il fait trop de vent , on trace avec une regle un trait blanc, & on arrange les ardoises comme on le voit… ».[16]
On peut ajouter à cette description que le couvreur utilise un gabarit en bois nommé « escantilh » lors de la taille de l’ardoise. Le faîte (« cérimane ») est couvert d’ardoises beaucoup plus grandes et, afin qu’elles adhèrent bien, on enfonce des clous à tête large et plate.
A côté de l’ardoise, autre couverture minérale, la lauze. Sa nature diffère des gisements, tel le schiste, le flysch… En ce qui concerne la pente de la toiture, outre le flysch, les autres catégories peuvent être posées sur de faibles inclinaisons. Comme matériau, la lauze offre des avantages certains comme sa robustesse, sa stabilité.
5) La tuile (ou téoule)
Si la zone est constituée d’un sol glaiseux, la tuile est aisément produite, on la cuit. Il est nécessaire de bien la cuire sinon elle rompt puisqu’elle a une consistance « tendre » et entraînera des conséquences fâcheuses lorsqu’elle s’imbibera d’eau lors des pluies provoquant son effritement. D’après Duhamel du Monceau, il est nécessaire que le couvreur obtienne effet sonore lorsqu’il la frappe avec un marteau, lui indiquant alors à la fois qu’elle est cuite et qu’elle est fêlée. [17]
De forme plate et rectangulaire généralement, appelée tuile picon mais qui, selon la région où on l’utilise, est découpée dans sa partie inférieure.
La tuile plate est accrochée – comme l’ardoise - à des lattes, soit à des chevilles de bois soit à des picots ou crochets de terre cuite moulée servant à les caler contre les lattes. Ces picots sont conçus simplement par l’artisan qui par son pouce le modèle en produisant un amas de terre.
Si la tuile est uniquement accrochée, elle peut lors de grands vents se détacher et tomber. On utilise aussi du mortier afin de lier des tuiles bombées.
Elle est conçue dans la province du fait de la présence abondante des matériaux nécessaires à sa fabrication, l’argile et le bois. On cite comme ateliers produisant ces tuiles ceux de Bugnein, de Vieillenave, de Susmiou.
Mais, elle offre l’inconvénient de peser près d’un kg. Si le m2 d’ardoises pèse une vingtaine de kilogrammes, celui de tuiles une soixantaine.
Par exemple, autour de Lembeye, on la dessine en forme de doubles festons, quant aux environs de Salies-de-Béarn et d’Orthez, on lui donne un dessin d’écailles de poisson. [18]
Les couvertures de tuiles s’observent surtout dans le nord du Béarn. Dans le Nord du Vic-Bilh et du Montanérès, c’est la couverture dominante. La tuile est concurrencée par le bardeau jusqu’au XVIIème siècle, notamment à Lembeye.
En ce qui concerne les tuiles, on en distingue généralement deux catégories. Les tuiles creuses (ou romaines…) nécessitent une faible pente, de l’ordre de 30°. On en trouve, par exemple, au Nord-Est du Montanérès. Elles permettent alors d’élargir les maisons dans leur largeur et d’offrir au spectateur une façade en pignon (mur dont la partie supérieure prend la forme d'un triangle).
La tuile creuse est aussi utilisée pour le faîtage de couverture en tuiles plates, mais également dans la toiture des appentis.
L’autre catégorie, la tuile picon (ou plate), détermine, à l’opposé, la présence une toiture comportant une forte pente de l’ordre de 45°, ce qui oblige de bâtir des constructions avec des largeurs moindres et d’exhiber une façade en gouttereau (bord inférieur du toit d’où l’eau de pluie se déverse).
On pose les tuiles sur un lattis, on prend soin de recouvrir aux deux tiers. Sur le coyau, on place une planche à plat permettant un débordement du toit de 10 à 15 centimètres.[19]
En ce qui concerne les pignons à gradins, on explique en partie leur origine par la présence de la neige. Du fait de son poids, il est indispensable de la dégager en partie, bien qu’elle revête un avantage au niveau d’isolation comme cela a été écrit plus haut. Ce type de pignon permet plus aisément sur le toit, d’enlever la neige et, bien entendu, de pouvoir réparer la toiture. Outre cette utilité, il offre un aspect décoratif non négligeable tel que nous le présente la façade d’une maison à Oloron datant de 1601.
Voici ce que l’Encyclopédie de Diderot note au sujet de la couverture en tuile :
« Quand on couvre de tuile, on place les chevrons à deux piés ou seize pouces au plus de distance. Le millier de tuile du grand moule, fait sept toises de couverture. Ces tuiles ont treize pouces de long, huit de large, & quatre pouces trois lignes de pureau ; on appelle de ce nom, la portion de tuile qui reste découverte quand elle est en place. La grandeur des tuiles du petit moule est communément de neuf à dix pouces de long, sur six de large, & trois pouces & demi de pureau. Les tuiles rondes, ou creuses, ou en s couchée, demandent un toit extrèmement plat. Il y a de l’ardoise de 11 pouces de long sur 6 à 7 de large, & 2 lignes d’épais ; c’est la quarrée forte. La quarrée fine a 12 à 13 pouces de large sur une ligne d’épais. Le millier fait 4 toises de couverture, en lui donnant 3 pouces & demi de pureau ; en la ménageant bien, elle peut former jusqu’à quatre toises & demie. Le bardeau, ou ces petits ais qu’on substitue à la tuile, ne charge pas les maisons ; on les appelle aissis ou aissantes. On les employe communément aux hangards. Il faut qu’ils soient sans aubier. Si on en fait des toits de maison, il ne sera pas nécessaire que la charpente soit forte. Il n’y faudra pas épargner le clou, non plus qu’à l’ardoise. Il durera plus long tems si on le peint à l’huile… On accroche la tuile à la latte ; on y cloue l’ardoise après l’avoir percée d’un coup de marteau ; c’est pour cela qu’on remarque à la tuile une encrénure en-dessous. Le pureau est plus grand ou plus petit selon la distance des lattes. Voilà en quoi consiste tout l’ouvrage de couvreur, qui demande plus de hardiesse & de probité que d’adresse. La latte est attachée sur les chevrons. Comme il est quelquefois difficile de vérifier l’ouvrage de couvreur, il n’a pas de peine à tromper. Il peut compter plus de tuile ou d’ardoise qu’il n’en employe. Il peut employer de mauvaise latte & de la tuile mal façonnée ; il peut disposer la neuve de maniere qu’elle soit mêlée avec la vieille, ou qu’elle lui serve de cadre. Il n’y a que la stipulation avant que l’ouvrage commence, & un examen attentif après que l’ouvrage est achevé, qui puisse mettre à couvert de la tromperie.»
Il est à noter que les textes sont vagues dans la désignation. En effet, le mot « teule » peut signaler soit la brique, soit la tuile.
Avant-toits
Des décorations agrémentent les toitures telles les génoises, les frises et les corniches.
Dans la Charte architecturale et paysagère (Pays d'art et d'histoire, Pyrénées béarnaises)[20], on lit : « La transition entre le débord du toit et l'arase se fait par une passe de toit. Le débord de toit peut simplement reposer sur des chevrons qui peuvent parfois être enfermés dans un coffre de planches. Plus généralement, la transition entre la façade et le toit est assurée par une corniche en bois, en pierre de taille ou en briques maçonnées et enduites. Dans les architectures les plus nobles, le profil est soigné : denticules, bois sculpté, dessin de la pierre, plâtre mouluré. » De citer les zones auxquelles on peut les apercevoir : le « piémont oloronnais en contact avec le pays de Navarrenx offre quelques exemples de passes de toit traitées en génoises dans lesquelles le maçon fait alterner les rangs de tuiles plates et de tuiles canal. »
La génoise est une frise composée de tuiles rondes superposées que l’on fixe avec du mortier et que l’on dispose en débord du mur. Son utilité n’est pas aucunement décorative puisqu’elle remplace la gouttière et écarte les eaux des pluies qui coulent du toit. Dans l’étude nommée « L’habitat traditionnel en Béarn des Gaves-Soubestre »[21], on lit qu’il est « fréquent que des lignes de denticules [suite de petits cubes agencés en lignes horizontales]… de terre cuite, s’insèrent entre les rangs de tuiles pour en souligner l’effet décoratif. » Il est également écrit que « Souvent la génoise est soulignée d’un bandeau formé d’une surépaisseur d’enduit, ou plus simplement d’un badigeon. Cette frise peut être animée de motifs soignés évoquant les rondeurs des tuiles creuses. » Ce type de décoration est présent aux environs de Salies-de-Béarn, Orthez, Arthez-de-Béarn et Navarrenx dans ce que l’on nomme le Béarn des Gaves-Soubestre. Egalement, la corniche génoise soutient l’avant-toit protégé par des tuiles dans le nord de la province. Néanmoins, elle est présente dans la zone du sud de Pau jusqu’à Pontacq. Dans une autre étude[22], on précise que « Cette corniche qui soutient les pieds de chevrons, contribue à protéger le mur en écartant les ruissellements des eaux de pluie. La génoise joue un rôle essentiel dans la décoration, déroulant un feston qui anime la tête du mur d’effets d’ombre et de lumière. Il est à noter que la génoise enveloppe la lucarne-fronton, qui se trouve ainsi fermement liée au mur. »
Génoise décorant l'avant-toit de l'abbaye laïque de Tarsacq.
Les corniches, on le voit, présentent des variétés de décoration. Certaines, comme le montre CAUE 64 par des illustrations, sont enduites avec du plâtre avec un décor rapporté de rinceaux, d'autres sont en bois ouvragés avec des modillons constitués d'une planche moulurée, des denticules et des rosettes. Des corniches apprêtent plusieurs rangs de matériaux tels un rang de briques plates, un rang de tuileaux, un rang de tuiles canal et des denticules. [23]
Des débords de toit sur console affichent des éléments d'assemblages de bois : une poutre en console, une jambe de force, une panne sablière et un chevron élégie. Une panne sablière (poutre) est placée horizontalement à la base du versant de toiture. Le chevron élégi est un chevron élimé à l'extrémité,
La charpente
Le charpentier revêt en Béarn une importance certaine. J.J. Cazaurang mentionne qu'il faisait partie « avec le forgeron, le tailleur, le maçon, des mestieraous, ceux qui ont un métier, qui ne sont ni pasteurs, ni cultivateurs. Plus aisés que les métayers ou les journaliers agricoles dont beaucoup d'entre eux étaient issus, ils l'étaient moins que ceux qui avaient de qué, « de quoi », c'est-à-dire un fonds de terre. Le paiement de leurs services dépendait beaucoup des conditions de travail : il avait lieu au forfait, à la tâche (prets heyt), ou à la journée (journau). Ce dernier mode était le plus usité... » [24]
Par rapport à celles existantes dans les régions avoisinantes (Landes, Gers, Pays Basque), la charpente béarnaise se caractérise par ses fortes pentes avoisinant les 45°). L’inclinaison de la pente est attachée au matériau de la toiture. L’usage de la tuile (plate) et de l’ardoise nécessite un versant important. Ce dernier offre au propriétaire le bénéfice de comble conséquente.
Globalement, les toitures béarnaises se décomposent en deux catégories. Celle à bâtière ou à deux pans ou celle à croupes ou quatre pans.
Dans la première catégorie, le gain en espace est de l’ordre de vingt pour cent.
Sur les murs, on pose des grosses poutres qui permettent de soutenir un plancher qui sert de grenier. La charpente, elle-même, est composée de fermes. Jean Loubergé[25] précise que les grosses poutres constituent les entraits (ou tirants), tandis que « les arbalétriers se fixent par embrèvement à leurs extrémités. Quant aux sablières elles surmontent ces poutres auxquelles elles sont fortement assujetties par des clous forgés, et ce sont elles qui soutiennent les chevrons de la toiture. » Ce type de toiture correspond à une charpente dite simple. Le même auteur distingue une autre, à entrait retroussé, « bien adapté à la forte pente du toit. » Selon lui, la charpente à croupe est très répandue vu que les toits béarnais « sont sous le vent à quatre eaux. » Il précise alors que du « sommet de la dernière ferme s’écartent deux arêtiers qui y sont fixés par de gros clous ; ils soutiennent la croupe et quand celle-ci est complète, une demi-ferme (dite demi ferme de croupe) la soutient en son centre. Dans le cas des toits à quatre eaux, les sablières qui surmontent les murs et supportent les chevrons sont assemblés entre elles à mi-bois et en queue d’aronde, ce qui permet de soulager la poussée de la charpente sur les murs. La pente de la croupe est généralement supérieure à celle des longs pans de la toiture. »
Les deux pentes, lorsqu’elles sont reliées par des pièces de bois mises assez haut, permettent d’offrir beaucoup d’espace, ce qui explique la présence de greniers, notamment dans les granges et d’emplacement pour loger les domestiques notamment dans le Vic-Bilh.
Pierre Bidart et Gérard Collomb, analysant les charpentes à chevrons formant ferme, les qualifient d' « archaïques » vu qu'elles couvraient déjà les « grands bâtiments médiévaux ». Voilà intégralement ce qu'ils écrivent à leur sujet :
« Ces charpentes ne comportent pas de pannes ni d'arbalétriers, le poids du toit étant supporté directement par des chevrons disposés tous les 50 à 80 centimètres. Ces chevrons sont assemblés à mi-bois à leur extrémité supérieure, sans faîtière, et reposent à leur extrémité inférieure sur une sablière prise dans la maçonnerie du sommet des murs gouttereaux. Chaque paire de chevrons est triangulée par un faux-entrait, placé assez haut ; le contreventement de l'ensemble est assuré par un ou deux longs rondins ou pièces équarries chevillés sous chaque chevron et disposés obliquement dans le plan des rampants. Dans les charpentes de ce type, la poussée des deux versants du toit sur les murs gouttereaux est considérable, aussi les sablières sont-elles le plus souvent assemblées avec un entrait formant contre chaque pignon. On peut penser aussi que les poutres qui portent le plancher de l'étage, qui sont solidement engagés dans les murs gouttereaux et qui les traversent complètement, contribuent à la solidité de la maçonnerie et compensent en partie cette poussée. Malgré ces précautions, le risque reste grand, dans cette zone des Pyrénées soumise à de fréquentes secousses tellurique, de voir s'écarter les murs gouttereaux, que l'on doit fréquemment maintenir dans les grands bâtiments par des tirants métalliques retenus par des ancres de chaînage. Lorsque les versants du toit ont une surface plus importante, et que la longueur des chevrons augmente, on assemble un ou deux entraits supplémentaires par paire de chevrons, afin de les soulager en leur milieu. Toutefois l'affaissement à long terme des versants du toit paraît être un risque pour ce type de charpente, aux chevrons généralement de trop faible équarrissage pour le travail qu'ils subissent, ce qui donne aux vieux toits béarnais leur aspect légèrement concave, très caractéristique, accentué encore par l'adoucissement de la pente due à la présence d'un coyau. Cette pièce est en effet indispensable pour permettre la couverture de l'extrémité supérieure des murs, dans la mesure où la sablière qui reçoit les chevrons est placée près de la face interne des murs pour profiter plus efficacement de leur résistance à l'écartement. » En montagne, dans les hautes vallées béarnaises ou bigourdanes, les charpentes sont le plus souvent réalisées selon le même principe, mais tous les efforts des charpentiers paraissent alors s’appliquer à trouver des solutions pour limiter le risque que fait courir à la toiture le poids d'une couche de neige parfois abondante, et à renforcer la solidité des charpentes ; équarissage plus important des chevrons ou maintien de la sablière par plusieurs tirants disposés dans sa longueur, et sans doute cette contrainte explique-t-elle pour une part l'apparition plus fréquente que dans l'avant-pays de charpentes sur blochet et jambe de force, assurant une meilleure répartition de la poussée des chevrons sur les murs ». [26]
Jean Loubargé rajoute que le bois de chêne était très répandu notamment dans le « bas pays » vu que sa croissance jouit de bonnes conditions. Le plus souvent, le bois était abattu le plus près possible de l’endroit où on l’utilisait vu l’importance d’eau contenue dans l’arbre (400 kg dans un m3 de bois de chêne) gênant son transport. Il était « coupé en lune descendante, ou « lune vieille », c’est-à-dire après la pleine lune (c’était le contraire pour la coupe du bois de chauffage). Afin d’éviter que les insectes soient attirés par la sève et pondent leurs œufs, on choisit de couper les arbres lorsque la sève ne circule pas des racines aux feuilles, donc lors de la période nommée « morte ». Un an était nécessaire afin que la perte d’eau se réalise (juste quelques degrés d’hydrométrie sont nécessaires pour éviter que des fentes apparaissent ultérieurement soit 20%), il n’était pas question de le laisser choir sur le sol, car il risquait de pourrir au contact de l’humidité. De plus, il est à noter que la fibre est respectée.
Les autres essences, autres que le chêne et le châtaigner, comme le sapin et le merisier sont utilisées. J.J. Cazaurang rappelle que des spécimens vieux de deux ou trois cents ans ont résisté à des attaques d’insectes xylophages. Cette résistance serait due à la « manière et à l’époque de l’abattage que les anciens savaient calculer.
Autres éléments, les coyaux, « petites pièces de bois qui, fixées sur les chevrons à une certaine distance de la base de ceux-ci, s’en écartent et débordent le mur sur l’extérieur duquel, elles reposent. Les coyaux adoucissent la pente de la partie inférieure du toit » donnant à la toiture « un certain charme ». Les coyaux ont l’inconvénient d’utiliser davantage de bois, ce qui ne gêne pas les zones densément boisées, mais handicape les autres.
Pour les charpentes à fermes chevrons, le coyau est un embellissement familier, alors que si le toit est continu, il peut jouer le rôle de protection d'une galerie.
Pour le chevillage, très utilisé dans les assemblages de pièces, on utilisait également le bois de chêne, et aussi l’acacia à partir du XVIIIe siècle, date de son expansion dans la région. » [27]
En ce qui concerne les charpentes des granges, elles sont élaborées en demi-croupe au droit du mur pignon. « Cette disposition permet de percer au sommet du mur le outeau ou la claire voie qui favorise le séchage des récoltes ou du fourrage stockés dans le fenil. » [28]
Trois photographies d'une charpente d'un bâtiment agricole à Las Claverie.
Les éléments d'une charpente, source : Wikipédia, article: charpente.
Les lucarnes
Les toitures, par l’importante surface des combles qu’elles offrent, conviennent pour abriter des greniers dans les maisons afin de ranger, de stocker (sorte de débarras) ou, dans les granges, de loger du fourrage, des grains… Dans les deux cas, il est nécessaire de prévoir que l’humidité et la pourriture ne s’installent pas. A cette fin, des ouvertures sont établies pour permettre d’aérer et d’éclairer ces parties, ce sont les lucarnes. Leurs dimensions, leurs nombres et leurs formes diffèrent. Communément, un faîtage à deux pentes suffit pour les lucarnes fenêtres, ce que l'on nomme aussi lucarne en bâtière.
Dans un souci esthétique, ce faîtage est agrémenté d’un versant nommé croupe, généralement triangulaire (croupe droite) ou arrondie (croupe arrondie). La lucarne peut être aménagée sur la façade dans un fronton maçonné. Ce type se trouve globalement dans le Nord du Béarn où on trouve, comme à Arzacq, des lucarnes à capucines (croupe arrondie présentant une capuche de moine). Dans le Vic-Bilh et le Montanérès, la lucarne-fronton est placée « à l’aplomb de la porte d’entrée » et souligne « l’axe de la façade ». [29]
Lucarne à capucine aménagée sur une toiture d'un bâtiment agricole à Las Claverie.
Toujours dans un souci ornemental, on multiplie leur nombre afin d’offrir une vue agréable à la toiture.
La lucarne avec sa toiture couvrante a le mérite d'amoindrir la chaleur produite par le soleil en été et ainsi limiter la température sous les combles.
En ce qui concerne les granges et les étables, elles font également office de portes pour permettre de stocker les marchandises. Souvent, les matériaux de construction diffèrent : à la base, la pierre domine alors que le faîtage est en bois.
Dans le Haut-Béarn, les granges détiennent une ouverture en pignon sous le toit, elle a une forme de demi-lune. Son rôle est de permettre l’aération de la salle et de ventiler le foin. N’oublions pas que la zone est humide.
Les bardages
Ce que l’on nomme bardage correspond généralement à une protection provisoire autour d’un ouvrage d’art. Pour ce qui nous intéresse, il est souvent constitué de planches que l’on habille parfois les façades de bâtiments, par conséquent un revêtement.
Le mot « bard » est un objet du XIIIème siècle composé de lames de bois assemblées pour transporter des matériaux lourds.
On pose ces bardages verticalement afin de protéger la bâtisse de l’eau de pluie. La largeur des planches avoisine 15 cm, lors de leur pose, on prend soin de les mettre bord à bord et de couvrir les jointures par de minces lattes. L’armature des bardages est également fréquemment en bois, les deux sont liés par des clous. L’ossature s’appuie soit sur une poutre, soit sur un plancher.Les galeries
Pour ce qui nous concerne, c’est un passage de service, relativement étroit et en surplomb. Les arcatures sont portées par des colonnes ou des poteaux. On les positionne le plus souvent aux côtés sud ou est, particulièrement sur une façade secondaire. Leur usage consiste soit à desservir les pièces soit à stocker des récoltes.
Des galeries sont édifiées en encorbellement et reposent sur des jambes de force, des corbeaux les supportent alors. Il existe un autre type de galeries, des poteaux les supportant. Ces dits poteaux reposent sur des socles en pierre afin d'éviter de subir toute infiltration d'eau.
Les murs
Les béarnais ruraux, comme quasiment tous les paysans français, édifiaient seuls ou avec l’aide de la collectivité pour y parvenir plus aisément (financièrement, matériellement…).
Les fondations étaient peu profondes généralement, mais cela dépendait de la qualité du terrain. Un mètre est la règle, s’il est nécessaire qu’on creuse davantage. On s’arrange pour élargir plutôt les fondations et la largeur des murs, de l’ordre de 0,50 m. Ces 0,50 à 0,55 m correspondent à l’ancienne coudée. La norme est d’incurver le centre des fondations pour y couler du mortier, puis on dispose, par exemple, les galets dessus en prenant soin de les « immerger » et de les séparer les uns des autres.
La réalisation de murs épais répond au besoin de se passer « d’organes de raidissement autres que les chaînes d’angles ». Ces dernières sont « constituées de gros blocs qui ne sont taillés que sur trois faces, sont en grès ou en calcaire… il arrive que les constructeurs… aient fait l’économie de ces éléments… les murs ont une hauteur moyenne de 3,60 m à 4 m dans les maisons à rez-de-chaussée, et de 5,80 m à 6,60 m dans les maisons à étage », ceci particulièrement dans le Vic-Bihl et le Montanérès. [30]
Les maisons des trois vallées montagnardes béarnaises ont été construites très majoritairement en pierre depuis très loin dans le passé, ce n’est pas le cas des maisons du bas pays, faites durant longtemps avec des matériaux dits périssables (bois, chaume…).
La terre crue.
Considérée comme un matériau moins durable, elle sera néanmoins utilisée durant des siècles sous forme d’adobe, de pisé ou de torchis.
Dans l'Aquitaine, elle a été le matériau dominant dans une zone qui s'étendait du Haut Armagnac au plateau de Lannemezan. [31]
Pour ce qui concerne la terre, elle représente avec le galet, le matériau le plus usité pour le gros œuvre.
Elle permettait d'édifier des bâtiments de trois niveaux si on utilisait la technique du pisé « banché », les murs étaient larges de 50 à 70 cm,
En ce qui concerne l’adobe, on peut la définir comme de l’argile séchée que l’on a mélangée avec de l’eau et un liant comme de la paille, on obtient alors des blocs ou des briques que l’on sèche au soleil. On l’étaye par des armatures de bois et on l’utilise fréquemment pour dresser les murs de faible épaisseur des granges. Afin d’éviter que l’humidité occasionne des dégâts sur la base des murs, ces derniers sont dressés sur un solin de maçonnerie. On alterne, par exemple, des assises de galets et des briques crues.[32]
Quant au pisé, c’est de l’argile légèrement humide (J.J. Cazaurang précise : … tapie, … fait de terre tassée, avec le sable et séchée »[33]) que l’on coule dans des moules de bois ou entre des branches. Pour Claude-Jacques Toussaint,[34] ce matériau est utilisé pour les « constructions de peu d’importance et des bâtimens ruraux » surtout dans les régions du sud de la France. Mais il conçoit que son usage serait possible pour des constructions « moyennes » si on opère « quelques amalgames et d’un plus grand soin dans sa confection. » Pour le même auteur, la terre doit être graveleuse et peu mouillée.
On compacte la terre dans un coffrage par le biais d’une dame. Ce coffrage est de taille réduite ce qui permet de le déplacer lors de l’édification du mur. Le coffrage doit être solide pour tasser le mélange. Tasser permet d'éviter toute poche d'air. Le mur a une largeur supérieure à 50 cm vu que le damage de la terre à l’intérieur du mur s’avérerait problématique. Les banches (panneaux de coffrage) sont garnies de terre par couche d’une épaisseur avoisinant les 10 à 25 cm. On décoffre lorsqu’on sent que la banchée est achevée, même si la terre reste encore humide vu que la teneur en eau doit avoisiner les 10 %. Si la terre est trop mouillée, elle risque de s'écouler au travers du coffrage. A l’opposé, si elle n’est pas assez humide, la terre ne se lie guère. Dans l'ouvrage cité plus haut, « Les Pays aquitains », les auteurs font mention de « coffrage démontable de quatre mètres de long environ, sur un mètre de hauteur ». De plus, ils précisent que le tassage sur les angles se pratiquait avec un pilon avec un côté pointu. En conséquence, on monte les murs petit à petit afin de les laisser sécher suffisamment.
Lorsque l’enduit est absent ou en partie apparent, les murs de pisé dressés à l’aide du banchage sont visibles à l’œil nu.
Si la technique de confection des murs de pisé est a priori économique, sa lenteur peut être jugée comme un frein. Dans la région de Thèze, on lui préfèrera l’adobe, ou la brique crue.
Enfin, pour ce qui concerne le torchis, on peut le définir comme de l’argile mélangée avec des fibres végétales comme de la paille hachée ou du foin coupé que l’on utilise pour garnir l’armature de poteaux liés par des lattes. J.J. Cazaurang écrit : « Mêlée à des végétaux, herbes séchées, paille, plus tard épis de maïs vidés des grains, soutenue par une armature de petits rondins ou par un lattis, elle fut le composant principal du torchis (coulounat, tampat, passa-canat) formant parfois des murs de soutien et beaucoup plus souvent des cloisons de séparation. »[35]
Fréquemment, on privilégie la paille de blé ou le chaume, « groupée en minces faisceaux et torsadée autour de liteaux maintenus dans les poteaux du pan-de-bois… mais on trouve également des branchages minces et des feuilles maintenus par des lattis. »32
Les avantages de la terre crue sont la rapidité de réalisation, un coût moins élevé (extraite sur place) et une facilité d’exécution qui explique que les propriétaires eux-mêmes pouvaient s’y atteler. Une mare naît sur l’emplacement de l’extraction de la terre. A la fin du XVIIème siècle, on mentionne à Lembeye que près de la moitié des maisons sont réalisées avec du torchis.
Claude-Jacques Toussaint mentionne que « La terre grasse seule, détrempée, sert de mortier pour lier les moellons des constructions rurales, et parfaitement des clôtures ; quand on y ajoute une petite quantité de chaux, ce mortier devient assez solide. » [36]
Par expérience, on sait que la terre crue sous toutes ses formes est un matériau fragile, ce qui explique que la protège par un enduit. Mais ce dernier a l’inconvénient de mal adhérer. Ce qui explique que l’on privilégie son usage pour la confection des granges. Le torchis, par exemple, est utilisé pour les cloisons d’intérieur.33
La pierre (peyre).
La pierre est le matériau de construction qui confère à son propriétaire le plus de prestige, mais qui s’avère également le plus onéreux. Ceci explique que ce sont les gens fortunés qui entreprennent l’édification de maisons avec ce dit matériau. Par conséquent, outre l’Etat, ce sont des gens issus de la noblesse, du clergé ou de la bourgeoisie qui sont les commanditaires.
J.J. Cazaurang [37] cite les grands centres d’extraction : « Arudy, Gabas, Izeste, Laruns, Louvie-Juzon, Louvie-Soubiron, Lurbe, Arette pour le calcaire gris ; Arros-Nay, Bosdarros, Cassaber, Orthez pour le calcaire blanc ».
Il est à signaler à ce propos qu’à l’époque on ouvrait aisément de nouvelles carrières selon les besoins.
Généralement, pour édifier un mur, on dresse deux parements de pierre de taille qui enserrent un blocage constitué également de rejets de pierres. Si le mur est relativement haut, comme on en trouve dans les villes, on réduit la largeur au fur et à mesure qu’on l’élève ceci en écartant tout blocage. Pour les édifices militaires, il va de soi que l’architecte prévoit d’augmenter les moellons de blocage.
Pour les murs en pierre que l’on trouve surtout en montagne et dans les « portions de colline ». Si la pierre calcaire est rare dans les « grandes vallées » et dans la plupart des collines », ce n’est pas le cas de l’argile. Les murs reposent sur des fondations, comme cela a été écrit précédemment, peu profondes. Les gisements sont dans l’ensemble locaux.
Globalement, elle servait parfois à la construction de cheminées, d'encadrement des portes et des fenêtres, remplaçant alors les linteaux et les jambages en bois (en l’occurrence, on usait des pierres tendres afin de mieux les façonner) ou de fondations. On la retrouve également en forme de boules au-dessus des piliers des portails. Le souci de la pierre béarnaise apparaît lorsqu’elle est employée dans certains usages comme dans les portes à faux du procédé en ronde bosse.
On se met à utiliser les galets roulés provenant des lits des gaves, des ruisseaux ou de gravières, et on remplace le chaume soit par les tuiles, soit par l'ardoise selon la localisation, par exemple le nord du Béarn pour la tuile, car éloigné de la montagne. On emploie plus fréquemment la pierre taillée pour les encadrements de fenêtres. En montagne, on utilise des galets et les pierres de carrières cassées tandis que sur les coteaux, on se sert de moellons de calcaire blanchâtre que l’on taille de manière sommaire pour bâtir les murs.
Selon J. J. Cazaurang la pierre « dure et façonnable en gros moellons, néoulous, peut s’ordonner à plat, de niveau, en liaison, cette disposition est mise en place. Elle nécessite peu de mortier, à la limite de la maçonnerie à sec. » Ce type de procédé se trouve dans les vallées montagnardes. Par contre, la « pierre à cassure irrégulière entre dans l’érection des murs en opus incertum sans être ordonnée et avec un minimum de liant. » Son usage est avéré « en montagne, … le long des coteaux entre les deux gaves, de Gan à l’est de Salies-de-Béarn à l’ouest. » [38]
Toujours, selon le même auteur, ces murs sont en « en moellons pris dans un mortier dans un mortier composé de chaux naturelle et de sable terreux. Les moellons sont des pierrailles de forme plus ou moins régulière, sauf dans le soubassement pour lequel on choisit de préférence des blocs à surface grossièrement horizontale ».
Quant aux chaînages d’angle, ils sont réalisés avec des « moellons plats de grandes dimensions » ou avec des « pierres de taille » croisées dans le but d’occasionner un point bien assuré au niveau de l’agencement.[39]
Mais il s’avère qu’ils sont peu nombreux, comme d’ailleurs les encadrements d’ouverture réalisés plutôt en bois.
Chronologiquement, il apparaît que c’est par la confection des murs qu’une évolution de l’usage des matériaux s’affirme.
Les galets (calhaüs,arrebots) sont des matériaux très présents en Béarn (formés par les rivières, les gaves, lors de l’ancien emplacement de la mer). Jean Loubargé précise qu’il est très répandu dans les « grandes vallées (il affleure dans les saligues) que dans les terrasses et collines argileuses où il n’est jamais à grande profondeur. »
Leur usage dans la confection des murs s’explique, par conséquent, par leur avantage financier. Leur aspect arrondi et lisse contraint le constructeur à utiliser du mortier pour lier les galets. Leur utilisation est attestée à partir du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Auparavant, les maisons sont bâties avec d’autres matériaux plus communs comme la terre et le bois. Vu la quantité de galets extraits des gaves, il arrivait que des procès soient intentés par les propriétaires riverains, mais aussi entre des particuliers et les seigneurs qui utilisaient également ce matériau dans la construction ou la réfection de leurs châteaux ou manoirs. Le seigneur de Saint-Dos est cité en exemple, car il fut sanctionné en 1728 pour une exploitation jugée excessive. En effet, Jean de Majendie, soucieux de restaurer ce château, en majorité de style Renaissance, le fit avec des galets du gave, ce qui occasionna un procès perpétré par les jurats d’Auterrive. Le seigneur qui perdit l’affaire dut verser 400 livres d’amende.
Les galets sont utilisés dès la confection des fondations comme on l’a vu plus haut. Ils permettent une meilleure stabilité.
Dans l’édification du mur, ils doivent être disposés selon un alignement en hauteur. Cette mise en œuvre de rangs de galets s’explique par la qualité du mortier et sa consistance. S’il est trop fluide, les galets glissent sur lui et tombent. De plus, il tarde davantage à sécher.
Or, avant le XVIIIe siècle le mortier utilisé dans la campagne béarnaise n’est pas de bonne qualité vu que la chaux utilisée est le résultat d’une mauvaise préparation dans les fours à calcination existants de conception rudimentaire. Actuellement, dans les Landes, cinq fours à chaux datant du XVIIIème siècle ont subsisté, dont celui d’Oeyregave qui faisait vivre près de 200 personnes, et ce, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Ce qui explique que seuls les individus fortunés étaient à même de se procurer des matériaux de plus grande qualité avant le XVIIIème siècle. De plus, comme l’écrit Jean Loubargé, la chaux hydraulique, qui se développe à partir du XVIIème siècle, permet au mortier de sécher plus vite (deux jours) permettant ainsi d’utiliser des galets roulés et de bâtir des maisons moins onéreuses lors des XVIIIème et XIXème siècles.
Plusieurs types de dispositions existent.
Alignés en « feuille de fougère » ou en épi ou encore en « arête de poisson », les galets reposent sur une couche de mortier. Les rangées sont disposées de manière oblique et en sens inverse les unes des autres.
Deux photographies d'une maison à Bugnein, rue Fougère: mur de galets en feuilles de fougère.
Il est possible aussi de mélanger les galets à des morceaux de roches plates nommées lavasses.
Les galets peuvent également être assemblés à l’aide de torchis comme cela se produit dans le Vic-Bilh. Il est par ailleurs possible d’ajouter que dans cette région du Béarn (dans la partie nord du Béarn globalement) où on alternait aussi les rangs des galets en les inclinant dans un sens avec un autre complètement opposé, on les séparait par un bandeau de briques plates pour rétablir l’arase à intervalles réguliers.
Dans la fiche technique éditée par CAUE 64 on peut lire « Les galets sont posés de manière à éviter l’alignement vertical des joints qui provoquerait une fissuration (coup de sabre)… Enfermée entre les deux faces extérieures, cette garniture mortier/éclats de galet se fait sans souci d’ordre (la fourrure).[40]
Léon Godefroy, au XVIIe siècle, décrit Pau et notamment la façon de construire les maisons. Voilà ce qu'il écrit : « La manière dont on les bâtit est de cailloux qui se prennent dans le gave, lesquels on unit par ensemble avec du mortier, et les coins des maisons étant achevés, on les laisse quelques années à l'air, ce qui les fait mieux porter et puis on les crépit. » [41]
La brique
Les Romains l’introduisent en Béarn, on observe particulièrement son usage aux châteaux de Morlanne et de Pau (tour de Montaner) par exemple. Comme nous le rappelle J.J. Cazaurang si on la retrouve dans des bâtiments à caractère militaire comme ceux que l’on vient de mentionner, on l’observe aussi sous « une forme de médiocre qualité et de moindre taille, avec le nom de sarrou, on la voit dans les assises, les voussoirs, noyée dans le mortier de l’opus incertum en complément de la pierre, dans les constructions civiles et religieuses, principalement urbaines. » [42] Il rajoute que dans les contrées béarnaises où la pierre est relativement absente comme le Montanérès et le Vic-Bilhl, elle est « fréquemment utilisée en dalles pour le revêtement des sols des rez-de-chaussée habités. Il en est sans décor, mais il en est aussi qui porte un motif (étoile, oiseau, cercles, etc). » [43]
Pour sa réalisation, les Romains (particulièrement Vitruve) conseillaient d’opter pour les saisons intermédiaires (printemps et automnes) pour que le séchage s’effectue correctement, davantage qu’au moment de l’été. Car lors de cette saison, un rétrécissement et un fendillement peuvent se provoquer à la suite d’un mauvais séchage.
En apparence, la brique cuite est épaisse de 3 cm approximativement. Point de dimensions types.
Les autres matériaux comme la chaux de mortier sont composés pendant longtemps dans des fours de fortune, par la suite, on chercha à davantage utiliser les calcaires les plus réputés comme ceux d’Arudy ou Orthez…J.J. Cazaurang précise que « les calcaires de la partie du Béarn au sud de la vallée du gave de Pau se sont prêtés sans difficulté à la cuisson et à la construction « à chaux et sable », indice de solidité. » 41 Le sable, lui, est abondant dans le Béarn le long des gaves et les sablières de grande renommée étaient la propriété de plusieurs riverains. La qualité et la solidité de l’habitat dépendaient du sable. Pour réaliser une maçonnerie correcte, le mortier devait correspondre à l'expression "à chaux et à sable."
En ce qui concerne la fabrication de la chaux vive (oxyde de calcium), des Béarnais s’y attelaient pour leur usage personnel. Un trou dans le sol suffit, on y introduit des morceaux de pierre calcaire. Sinon, on passait commande à des professionnels utilisant des fours.
Normalement, les proportions de sable et de chaux sont trois brouettes de sable pour un sac de chaux. On obtient alors un mortier fin (moins solide que celui du mortier de ciment) mais qui a permis à des constructions telles que les châteaux de résister près de mille ans.
Certains documents attestent, que pour réaliser du mortier, on mélange du sable, de la terre et du crottin, notamment de cheval.
Comment se présente un four à chaux ? Schématiquement, il se présente comme un gros pot en brique comportant à la fois une ouverture au sommet et à la base. L’artisan introduit du petit bois au fond du four et il comble tout le reste de l’intérieur par du charbon et de la pierre à chaux en couches alternatives.
Par conséquent, pour la fabrication de la chaux, il est nécessaire d’avoir une carrière de pierres calcaires et une forêt dans les environs. Même si les gisements ne sont guère trop éloignés, le transport par chars à bœufs depuis la carrière ou de la forêt est à prévoir. Bien entendu, de la capacité du four découle le nombre de chars. Et ce four est implanté si possible près d’un carrefour des axes menant auxdits gisements afin de réduire les coûts de livraison, ou du moins aux abords d’un chemin.
Il existait, en Béarn, deux grands centres de production de la chaux : Orthez et Montaut. Dans celui-ci, les fours sont fixes, souvent de taille avoisinant les 3 m de diamètre et les 4 m de hauteur. On usait de la pierre non calcaire - elle n’aurait pas résisté à la chaleur - pour les murs, en forme cylindrique, et réfractaire pour la voûte (les plus longues, nommées les « ligues »). Afin d’économiser un mur de fond et assurer une plus grande résistance à la charge, on l’implantait contre la pente. Les propriétaires veillaient à les placer non loin de leurs habitations. Les carrières sont de deux sortes, privées (généralement des propriétés d’agriculteurs, leur assurant ainsi un revenu complémentaire) ou communales. Pour l’exemple, prenons une fournée de 30 chars de pierres calcaires, le procédé de fabrication de la chaux consiste à disposer les pierres calcaires dans la chambre de combustion (une journée de travail) et de la chauffer durant une semaine approximativement, jours et nuits. Les chaufourniers observent la fumée qui doit être blanche. Au bout de la semaine, la combustion se termine, le haut du four est brûlé par les flammes. Pour la vérification, on extrait une pierre avec des pincettes et on l’asperge d’eau. Si elle se fend après avoir bouillonnée, elle est cuite. Autre moyen de contrôle, lorsque la voûte s’écroule, les pierres se sont transformées en chaux. A ce moment-là, on obstrue la porte du four avec une motte de terre et on protège son sommet de la pluie. Quelques jours après son refroidissement (trois jours généralement), on l’extrait. On obtient alors de la chaux hydraulique naturelle contenant de l’hydrocyde de calcium (ca(OH)2) ou « chaux éteinte » et de la silice (siO2).
Le travail est pénible vu qu’il s’effectue à n’importe quel temps et saison.
A Montaut, il est encore possible d’observer des restes de fours à chaux sur la route en direction de la carrière de la Castéra.
On distingue globalement deux catégories de sable, celui de rivière (bonne qualité) et de carrière (moins bonne qualité). En ce qui concerne les galets, distinction est faite entre ceux que l’on considère de qualité inférieure, ceux que l’on trouve dans la terre, tandis que ceux que l’on extrait dans les cours d’eau sont qualifiés de supérieurs. Jean Loubargé différencie les galets selon la couleur : gris foncé vu la composition de silex ou de quartzite (le plus apprécié), jaunâtre correspondant généralement au grès détenu, mais peu utilisé, car il s’effrite. [44]
Autre possibilité pour obtenir du liant entre les galets, surtout dans les sols argileux, on extrait du sol de la combe comme cela se faisait dans le Vic-Bilh. Le propriétaire du lieu profitait ainsi du bassin obtenu pour y faire barboter ses canards dans cette mare improvisée.
En ce qui concerne les fondations, elles sont peu profondes puisqu’en général si on creuse on touche rapidement la roche dans maints endroits, notamment en montagne car la maçonnerie résiste par sa masse et qu’elle procurerait davantage de travail. Dans le Vic-Bihl et le Montanérès, il est d’usage de faire des fondations pour les maisons de 60 à 70 cm de profondeur, de même qu’en largeur. « Parfois une assise de briques ou d’ardoises est intercalée entre la fondation et le mur pour garantir celui-ci de l’humidité. » [45]
Par contre, si on ne tient pas trop compte de la compacité du liant et des matériaux trop poreux, on se trouve rapidement confronté à un problème grave, celui des remontées par capillarité qui rend les maisons humides et forcément malsaines.
Il existe une ordonnance prise le 29 octobre 1685 relative aux fondations des bâtiments. [46]:
« Tous les murs en fondation depuis le bon et solide fond jusqu'au rez-de-chaussée des rues ou Cours, seront construits avec moellons et libages de bonne qualité, bien ébouzinés ; les lots et joints piqués et élevés d'arrase et liaison jusqu'au rez-de-chaussée, lesquels murs en fondation seront maçonnés avec chaux et sable, et d'épaisseur suffisante pour l'élévation qu'il y aura dessus, observant d'y mettre des parpins et boutisses le plus qu'il se pourra. Il est pareillement ordonné que le mortier soit fait et composé de bon sable graveleux, dans lequel le mortier entrera les deux tiers de sable et l'autre un tiers de chaux éteinte.
Les murs qui seront élevés au-dessous du rez-de-chaussée avec moellons et mortier de chaux et sable, seront de pareille qualité que ceux des fondations ci-dessus, en y observant les retraites ou empattements au rez-de-chaussée ainsi qu'il est d'usage.
Ainsi le mur de fondation qui aura deux pieds (soixante-cinq centimètres) d'épaisseur, portera au rez-de-chaussée un mur de dix-huit pouces (quarante-neuf centimètres), lequel sera posé au milieu de l'épaisseur du premier, de manière à laisser déborder celui-ci de trois pouces (quatre-vingt-dix-huit millimètres) de chaque côté. Il ne sera fait ni construit de gros murs en fondation maçonnés avec plâtre.
Quant aux murs que l'on construira avec moellons et plâtre au-dessus du rez-de-chaussée, on observera de même de piquer et tailler les moellons par assises mortiers de chaux et sable, vulgairement appelés de limozinerie, dont le plâtre que l'on emploiera à la construction desdits murs sera passé au crible ou panier. Défense d'en user autrement à l'avenir, à peine d'amende contre les ouvriers contrevenants, et de démolition de leurs ouvrages.
Et, pour plus grande solidité auxdits murs élevés en plâtre au-dessus du rez-de-chaussée, on posera au dessus dudit rez-de-chaussée une ou deux assises de pierre de bonne qualité, et principalement aux murs de pignon. »[47]
Dans « le fond des vallées, sur les gravières sensibles aux infiltrations lors de la crue des eaux » comme le note J.J. Cazaurang, il est nécessaire de réaliser des fondations plus profondes. Le même auteur constate que les caves ne sont pas nombreuses en Béarn et que les sous-sols n’ont pas été davantage affouillés, notamment sur les pentes des coteaux du Vic-Bilh.[48]
Le crépi qui se généralisera à partir du XIXe permettra à la fois d’imperméabiliser les maisons, mais aussi, malheureusement, de faire disparaître de la vue les pierres ou galets apparents.
La disposition de l’appareil de maçonnerie des maisons à la fin de l’Ancien Régime en Béarn présente plusieurs types, par exemple la disposition oblique, en échiquier ou en feuille de fougère… Le maçon pose en oblique sur du mortier une rangée de cailloux de même gabarit et de forme allongée, et ce, sur les deux faces extérieures puis il complète encore avec du mortier, puis il comble l’intérieur de ces deux rangées de murs extérieurs par un mélange de mortier et de cailloux sans se préoccuper de l’esthétique. Il va de soi que l’on réserve les plus beaux galets pour le parement extérieur lorsqu’il est prévu de s’abstenir de crépir.
Les petits galets sont destinés à combler l’espace entre les parements intérieurs et extérieurs. Ils sont nommés « sourroulhe ». Jean Loubargé ajoute que « pour assurer l’horizontalité des lits de galets mais aussi pour limiter la création de lézardes… », on incluait dans l’édification du mur des rangées de briques car « une rangée de briques horizontales faisait toute l’épaisseur du mur ». Ou alors, « on mettait à intervalles réguliers, des lits de galets plus gros, en position croisée… »[49] De plus, en ce qui concerne les chaînes d’angles, elles sont réalisées par des « grandes briques, de plaques horizontales de grès ou de pierres de taille. »
Pour l’encadrement des ouvertures, le maçon les réalise de concert avec le mur.
La disposition des galets en « feuilles de fougères » est davantage le lot des fermes riches. Si elle offre à l’observateur une vision agréable à l’œil d’une structure décorative harmonieuse, elle n’a pas qu’un but esthétique, elle permet, en effet, de fixer plus le mortier.
Les dangers de ce type de matériau étaient l’apparition de lézardes verticales, d’écartèlement des parements si l’édification avait été plus ou moins bâclée.
Un balcon est ajouté parfois, on le nomme « l’arrayou ». Il est positionné, dans le Vic-Bilh par exemple, à l’arrière du bâtiment. Il peut servir à faire sécher le linge, la récolte (maïs par exemple… On emploie du chêne ou du châtaigner, matériaux que l’on emploie dans l’édification des galeries de bois à l’étage, vu les qualités qu’on leur prête, c’est-à-dire leur longévité et leur endurance à l’humidité. Elles aussi sont établies au sud ou à l’est afin de sécher les récoltes, mais également dans le but de desservir les pièces.
Le sable
Il existe trois catégories de sable dans la confection du mortier. D’abord, celui que l’on extrait des plaines et des carrières, mais souvent, il est mêlé de terre et, selon Claude-Jacques Toussaint [50], il est nécessaire de connaître la quantité de terre contenue. Dans ce but, on mélange du sable et de l’eau et on doit bien remuer, si l’eau « reste limpide, le sable est pur et très bon dans l’emploi. » Par contre, si l’eau devient « épaisse et bourbeuse », la qualité est dommageable. En fait, d’après l’auteur, le « bon sable » doit « crier et ne rien laisser dans les doigts après la pression ». Ce sable de carrière se prospecte surtout sur les flancs des collines dans lesquelles la roche est friable et dans les zones d’affleurement éocènes.
L’autre catégorie de sable se trouve dans les ravines. Ce sable a été « entraîné des montagnes dans les vallées et dans les ravins par les eaux pluviales ». Il est bon s’il est dégagé de la terre. La dernière sorte de sable est celui en provenance des rivières et constitue le meilleur composant dans la réalisation du mortier. On le recueille dans des « cavités » faites par les hommes, on y entasse des galets et, puis, on le lave. Cette catégorie de sable ne se trouve pas en abondance dans tout le Béarn malgré l’importance des cours d’eaux. Dans certaines parties de la province, ces derniers n’ont pas assez de puissance. Il faut savoir que les seigneurs devaient accorder leur autorisation d’extraction.
Or, en Béarn, ce matériau se trouve plus abondamment près des cours d’eaux dont les gaves et il est extrait soit par des propriétaires qui exploitent leur gisement à des fins mercantiles, soit par des communes. Ces dernières, d’après J.J. Cazaurang, autorisaient des « particuliers ayant des besoins limités, soit à l’affermage par des spécialistes qui en faisaient une ressource, principale ou accessoire. » [51]
La couleur est différente selon les contrées, par exemple le sable aux environs d’Oloron est plus foncé que celui de Pau. Cette différence provient des éléments du charriage des cours d’eau. Quant à celui extrait des carrières est plus jaune.
Le bois
Il est utilisé pour les charpentes, les linteaux des portes, l’encadrement des torchis. J.J. Cazaurang note que pour les linteaux, ceux qui ont peu de moyens financiers se contentent d’un tronc d’arbre - le plus souvent d’un chêne, vu que le châtaigner a l’avantage de jouer le rôle de répulsif vis-à-vis des insecticides, mais qu’il a l’inconvénient d’éclater au lieu d’user de la pierre qui serait taillée par un tailleur professionnel. Par contre, la mise en place de ce dit tronc doit être réalisée par un professionnel. Le même auteur précise que « les travailleurs du bois respectaient la fibre de la pièce pour ne pas lui « couper la force ». Ils refendaient, ils équarrissaient plus qu’ils ne sciaient. Ils assuraient les assemblages par chevilles en bois, remplacées plus tard par les clous, pointes, fiches et boulons de fer. » [52]
Généralement, le chêne est réservé pour les charpentes, les poteaux, les solives… Alors que le châtaigner est davantage débité en planches… Mais cela n’est pas une obligation. [53]
Pour les cloisons, dans le Vic-Bilh et le Montanérès, l’armature est constituée d’un pan-de-bois. Ce dernier est composé de « simples poteaux, rarement découpés par des décharges, dont les intervalles réguliers et rapprochés (30 à 50 cm) ne sont interrompus que par les encadrements des portes de communication. Entre les faces internes de ces poteaux sont fichées des petites pièces de bois, d’équarrissage irrégulier, qui maintiennent en place le hourdis de torchis… Ces pans-de-bois… sont toujours masqués par un enduit qui est le même utilisé pour les murs de maçonnerie, et les diverses pièces de bois sont marquées de petites encoches destinées à accrocher cet enduit. »
Pour ce qui concerne les autres essences (frêne, acacia, buis…), elles servent dans la fabrication d’escaliers, de loquets de porte…
Pas de peintures sur les parties extérieures pour les Béarnais incapables de dépenser davantage pour l’embellissement de leur maison, ils tablaient sur la longévité du matériau. C’est au XIXème siècle que l’on utilisera de l’huile de lin.
Les enduits (perboc, esparberat)
Souvent, les lits réguliers de galets offrent une structure décorative suffisante et restent, par conséquent, apparents. Mais les murs peuvent être enduits d’un crépi, notamment lorsqu’ils sont réalisés avec des moellons.
J.J. Cazaurang mentionne que les enduits extérieurs sont peu présents sur « les murs de montagne où la partie laissée au mortier est faible ».
Aujourd’hui, les propriétaires cherchent plutôt à enlever le mortier de chaux vive qui couvrait les façades dans le but de laisser apparaître soit les moellons, soit les galets pour donner à la structure une connotation plus ancienne. Cela provoque d’ailleurs plutôt des conséquences négatives comme le déséquilibre plastique des murs.
La chaux est le matériau le plus usité pour enduire les murs. Dans le Vic-Bilh, elle est de teinte beige foncé.
Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, en août 1767, constate à Salies-de-Béarn que les murs non appareillés sont élevés à la chaux et au sable coloré : « La terre est forte, profonde, humide et argileuse. On y voit de tous côtés des carrières de sable blanc, jaune et rouge dont on se sert pour élever des murs solides. »[54]
Comme la pierre, physiquement, chauffe plus vite que le liant, cela occasionne une dilatation. Les joints que l’on appose entre les pierres subissent un ravinement lors des pluies. Ce qui explique la nécessité de l’enduit. Les mots crépi et enduit apparaissent en France au début du XVIème siècle. On ne projette pas l’enduit, on l’applique avec une truelle en une couche d’épaisseur voulue. Cette nécessité d’enduire est devenue une obligation, à Paris, suite à l’incendie de Londres, un an auparavant. En théorie, depuis l’Ordonnance de police du 18 août 1667 décrétée par le bureau des finances de la capitale, sous Louis XIV, il est stipulé que les façades à pans de bois doivent être recouvertes de plâtre à chaux. « … Enjoignons aux propriétaires de faire couvrir à l’avenir les pans de bois de latte, clous et plâtre, tant en dedans qu’en dehors, de telle manière qu’ils soient en état de résister au feu, autrement et à faute de ce faire, et en cas de contravention à ce que dessus, seront, lesdits propriétaires et ouvriers qui travailleront auxdits bâtiments, condamnés à cinquante livres d’amende… et les ouvrages abattus et démolis à leurs frais et dépens… »
Le lait de chaux est obtenu avec de la chaux éteinte (hydroxyde de calcium) qui est le résultat d’un mélange d’une chaux vive laissée longtemps à l’air libre et de l’eau. D’ailleurs, ce procédé n’est pas sans risque vu qu’une relative importance de chaleur se dégage alors.
Avant l’époque moderne, les bâtiments que l’on réalise en pierres sèches liées plus ou moins par de l’argile souffrent de l’ « attaque » intrusive des racines de plantes qui s’immiscent dans lesdites argiles ou pierres pouvant disloquer les murs. Les autres types de liant (torchis…) sont également touchés par les intempéries.
La chaux offre plusieurs avantages tel le durcissement « obtenu par obtenu très lentement par carbonation atmosphérique, suivant la réaction : Ca(OH) 2 + C0 2 - » CaC0 3 + H 2 0 Portlandite (chaux éteinte) + gaz carbonique -» Calcite + Eau.)[55]
La chaux est le résultat de la cuisson à une température qui avoisine les 800 et 1000°.
Les enduits à la chaux offrent par conséquent plusieurs avantages : la protection face à toutes sortes de conditions atmosphériques (neige, pluie, vent), la plasticité, la souplesse qui évitent la déformation. Le mur peut respirer, l'humidité est régulée, les pièces intérieures profitent de l'isolation thermique, les mousses, les lichens, les champignons, les parasites sont en partie éliminés par une de ses particularités, être un fongicide.
Dans le livre, « Les pays aquitains », en ce qui concerne les murs de terre, il est fait référence à un enduit préliminaire constitué « de balle de blé mélangée à de la terre », puis l'usage de mortier de chaux pour le second enduit. [56]
Le maçon procède à l’application de l’enduit sur les murs en plusieurs couches, généralement trois. Si la première est plus grossière (« gobetti »), servant davantage à aplanir.
La chaux est utilisée particulièrement liquide vu que l'hydraulicité a le don d'assurer « la cohésion avec toutes les parties de maçonnerie. Le gobetti est appliqué de façon uniforme au jeté de truelle non lissé pour permettre l'accroche de la couche suivante. » [57]
Celles qui suivent deviennent de plus en plus fines. Afin que la seconde adhère mieux, l’artisan donne à la première couche des rayures ou des encoches. Quant à la seconde (corps d'enduit), elle sera plus épurée, moins hydraulique, appliquée à « la règle mais non talochée pour conserver une surface rugueuse », tandis que la dernière servant de finition peut être colorée.
« L'hydraulicité progressive de l'enduit du gobetti à la couche de finition permet à la première couche de durcir plus rapidement pour assurer la cohésion de l'ensemble. Lors de la carbonation, le départ du CO2 forme un chevelu de micro canaux permettant à l'enduit d'évacuer tout au long de sa vie l'humidité et la vapeur d'eau tout en restant étanche à l'air et à la pluie. Au contraire, le durcissement du ciment, qui se fait par cristallisation, offre très rapidement un ensemble totalement étanche et non perméable à la vapeur d'eau. » 57Par conséquent, le durcissement qui s'opère se produit lentement, de plus le mur a la particularité de respirer convenablement. Autre avantage de l'enduit à la chaux, il supporte relativement correctement les distorsions qui provoquent les fissures.
On rappelle que c’est au propriétaire que revenait la charge, le plus fréquemment, l’apport des matériaux. Par conséquent, le transport de la chaux vive était assuré par des charrettes à hautes ridelles. Il ne restait donc alors qu’à la traiter en ajoutant de l’eau.
Lorsque les travaux à réaliser s’avèrent peu importants on se contentait de fours à chaux adéquats.
Les maçons démontrent leur imagination en esquissant sur les enduits des motifs comme des rosaces, des guirlandes…
Ce que l’on nomme badigeon (mot datant de 1676) est un enduit appliqué sans une couche préalable, donc directement sur la façade. Il s’agit le plus souvent de lait de chaux (dit aérienne car faiblement siliceux) que l'on taloche, que l'on lisse et que l’on teinte parfois. Autre avantage, celui d’éviter la poussière. Afin d’offrir un décor plus agréable à l’œil, il n’est pas rare de reproduire une ornementation de faux-appareil.
Généralement, les murs des communs n’étaient pas enduits ou alors « couverts d’un enduit à pierre rase couvrant les joints au ras des têtes de moellons. » 40
Si l’enduit est du mortier, Claude-Jacques Toussaint [58] la considère comme du crépi, il la décrit comme une composition d’un tiers de chaux éteinte et deux tiers de sable, le tout mélangé sans eau. Si le souhait est de réaliser un enduit, l’artisan doit faire une seconde couche en ajoutant du sable fin afin qu’elle soit plus fine.
Il est appliqué sur le mur à l’aide d’une truelle de fer.
Claude Jacques Toussaint précise que les « badigeons colorés sont composés d’une laitance de chaux dans laquelle on introduit une certaine dose soit d’ocre jaune, d’ocre rouge ou de charbon pilé ; on y ajoute quelquefois un peu d’alun pour le rendre plus solide… » [59]
Le badigeon blanc se fait à la « chaux vive, et se pose à la brosse ou au balai »
Pour la réalisation, l’artisan opère de haut en bas, avant de descendre et d’ôter l’échafaudage.
Les échafaudages
Les empous sont construits le plus souvent en bois par des charpentiers. J.J. Cazaurang nous écrit qu’ils utilisaient « les longues perches des arbres résineux locaux ligaturés avec soin sans que la fibre en soit rompue par entaille ou toute autre blessure ». [60] Lorsque le poids des matériaux sont trop lourds pour les porter sur le dos, on emploie les carruches, c’est-à-dire des poulies ou alors en usant des rouleaux et des leviers (ihebadés) pour les mouvoir.
Ils sont démontés lorsque le bâtiment est achevé ; on conserve alors le bois qui servira lors d’autres chantiers vu son prix important. Comme on peut le voir encore dans les églises béarnaises du Moyen Age (ex : Lescar), on les montait par le biais des trous de boulin creusés sur les façades. Les éléments sont de forme ronde, pour les assembler on utilise des cordes.
[1] J. Loubergé, la géographie des maisons rurales en Béarn, Revue de Pau et du Béarn, 1973, p. 213.
[2] Aspects de l ‘Architecture en Béarn, Actes du colloque d’Arzacq organisé par la Fédération des oeuvres laïques des Pyrénées Atlantiques, Editions Ségur, 2000, p. 18.
[3] Voyage d’un Bordelais en Béarn et en Labourd (Juin-Juillet 1765), publié et annoté par Paul Courteault, O. Lescher-Moutoué, imprimeur, Pau, 1910, p. 14.
[4] Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Pyrénées-Atlantiques : Vic-Bilh, Morlaàs et Montanérès (cantons de Garlin, Lembeye, Thèze, Morlaàs, Montaner), Direction du patrimoine du ministère de la Culture, de la Communication, des Grands travaux et du Bicentenaire, Collectif, p. 65.
[5] Pierre Bidart et Gérard Collomb , Pays aquitains, Paris, Berger-Levrault, 1984, coll : L'architecturale rurale en France », p. 33.
[6] Duhamel du Monceau, Art du Couvreur, 1766, p. 2, Art du couvreur, par M. Duhamel Du Monceau | Gallica (bnf.fr)
[7] Duhamel du Monceau, Art du Couvreur, 1766, p. 41, Art du couvreur, par M. Duhamel Du Monceau | Gallica (bnf.fr)
[8] Histoire de Bearn et Navarre / par Nicolas de Bordenave,... ; publ. pour la première fois, sur le ms. original pour la Société de l'histoire de France par Paul Raymond | Gallica (bnf.fr,), 45-46.
[9] J.J. Cazaurang, Maisons béarnaises, Musée béarnais, Pau, 1978, tome 2, p. 19.
[10] Idem., tome 1, p, 23.
[11] Mémorial béarnais | 1818-12-25 | Gallica (bnf.fr) , p 9, ou Arch. Com. de Pau Ee 1600.
[12] Mémorial béarnais | 1818-12-25 | Gallica (bnf.fr) , p 14, ou Arch. Com. de Pau Ee 1600.
[13] Idem., p. 15.
[14] Pierre Bidard et Gérard Collomb, op. cit, p, 34.
[15] Duhamel du Monceau, op. cit, p.25.
[16] Idem., p. 29.
[17] Idem., p.11.
[18] J.J. Cazaurang, op. cit., tome 1, p. 17.
[19] Pierre Bidart et Gérard Collomb, op. cit., p.35.
[20] Charte architecturale et paysagère (Pays d'art et d'histoire, Pyrénées béarnaises), CAUE 64, p. 110.
[21] L’habitat traditionnel en Béarn des Gaves-Soubestre, CAUE 64, p. 6.
[22] L’habitat traditionnel en Vic-Bilh et Montanérès, CAUE 64, p. 6.
[23] Charte Architecturale et paysagère (Pays d'Art et d'Histoire, Pyrénées Béarnaises), CAUE 64 p, 111.
[24] J.J. Cazaurang, Toits d'ardoises, Revue régionaliste des Pyrénées, juillet 1961.
[25] Jean Loubergé, La maison rurale en BEARN, Les cahiers de construction traditionnelle, Contribution à un inventaire régional, Editions Créer, révision en 2014 par EDICENTRE, p. 26.
[26] Pierre Bidart et Gérard Collomb, op. cit, p. 31.
[27] Jean Loubergé, La maison rurale en BEARN, op. cit., p 26-27.
[28] Charte architecturale et paysagère, (Pays d'Art et d'Histoire, Pyrénées béarnaises), CAUD 64,
p, 112.
[29] L’habitat traditionnel en Vic-Bilh et Montanérès, CAUE, p. 5.
[30] Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Pyrénées-Atlantiques : Vic-Bilh, Morlaàs et Montanérès (cantons de Garlin, Lembeye, Thèze, Morlaàs, Montaner), Direction du patrimoine du ministère de la Culture, de la Communication, des Grands travaux et du Bicentenaire, Collectif, p. 66.
[31] Pierre Bidart, Gérard Collomb, op. cit., p. 29.
[32] Idem., p. 63.
[33] J.J. Cazaurang, Maisons béarnaises, tome 2, p. 15.
[34] Jean-Claude Toussaint, Nouveau manuel complet du maçon-plâtrier, du carreleur et du paveur, A la librairie encyclopédique de Roret, Paris, 1834, p. 41.
[35] J.J. Cazaurang, op. cit., tome 2, p. 15.
[36] J. C. Toussaint, op. cit., p. 38.
[37] J.J. Cazaurang, op. cit., tome2, p. 13.
[38] Idem., p. 22 et 23.
[39] Jean Loubergé, La maison rurale en Béarn, op. cit., p. 21.
[40] https://www.pyrenees-parcnational.fr/sites/pyrenees-parcnational.fr/files/available_docs/fiche-02-maconnerie_en_galets_bd_0.pdfCAUE 64 (maçonnerie en galets, fiche technique 2).
[41] Léon Godefroy, Voyages de Léon Godefroy en Gascogne, Bigorre et Béarn, 1644-1646, publiés et annotés par Louis Batcave. Impr, de Vignancour, Pau, 1899.
[42] J.J. Cazaurang, Maisons béarnaises, op. cit., tome 2, p. 15.
[43] Idem., p. 16.
[44] Jean Loubergé, op. cit., p 22.
[45] Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Pyrénées-Atlantiques : Vic-Bilh, Morlaàs et Montanérès (cantons de Garlin, Lembeye, Thèze, Morlaàs, Montaner), Direction du patrimoine du ministère de la Culture, de la Communication, des Grands travaux et du Bicentenaire, Collectif, p. 66.
[46] Extrait du jugement du maître général des bâtiments de Paris, sur les murs en fondation, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5495432b/texteBrut, lois du bâtiment 64-65
[47] Définition d’ébousiner ou ébouziner selon Wiktionnaire : öter le bouzin d’une pierre, d’un moilon, c’est-à-dire, cette partie tendre qui tient autant de la terre que de la pierre.
[48] J.J. Cazaurang, Maisons béarnaises, tome 2, p. 26.
[49] Jean Loubergé, op. cit., p 23.
[50] C-J. Toussaint, op. cit., p. 25.
[51] J.J. Cazaurang, Maisons béarnaises, tome 2, p. 18.
[52] J.J. Cazaurang, Maisons béarnaises, tome 2, p. 19.
[53] Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Pyrénées-Atlantiques : Vic-Bilh, Morlaàs et Montanérès (cantons de Garlin, Lembeye, Thèze, Morlaàs, Montaner), Direction du patrimoine du ministère de la Culture, de la Communication, des Grands travaux et du Bicentenaire, Collectif, p. 64.
[54] Tucco-Chala Pierre, Voyage de M.de Malesherbes dans le Sud-Ouest, le regard d'un homme exceptionnel sur l'Aquitaine du XVIIIè siècle, Editions Cairn, 2013.
[55] La chaux à travers les âges, François-Xavier DELOYE Chef de la section Chimie analytique Service Chimie Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, BULLETIN DES LABORATOIRES DES PONTS ET CHAUSSÉES - 201 - JANVIER-FÉVRIER 1996 - NIT 4000, p. 95.
[56] Pierre Bidart et Gérard Collomb , op. cit., p. 28.
[57] CAUE 64, La Charte architecturale et paysagère, pays d'Art et d'Histoire, Pyrénées Béarnaises, tome 2, p, B8.
[58] C-J. Toussaint, op. cit., p.74.
[59] C-J. Toussaint, op. cit., p. 78.
[60] J.J. Cazaurang, Pasteurs et paysans, au village, les métiers, Editions Cairn, 2002, p. 69.